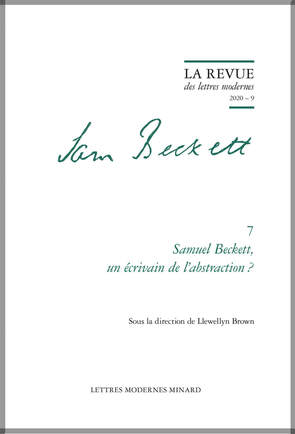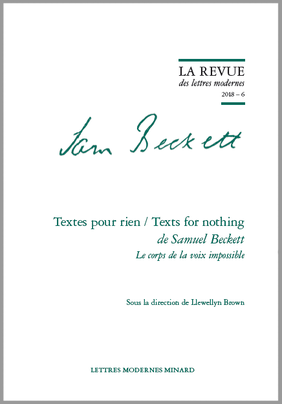Série Samuel Beckett
Dir. Llewellyn Brown (2010)
Samuel Beckett occupe sans doute une place à part au sein de la littérature française, en raison de la spécificité linguistique qui caractérise sa création, dont presque chaque œuvre compte une version “originale” à la fois en français et en anglais. En effet, la diversité des genres que Beckett a pratiqués (poèmes, romans, pièces, films, fictions brèves, œuvres pour la radio ou la télévision) revêt peut-être moins d’importance que la manière dont il a systématiquement transposé ses œuvres d’une langue à l’autre.
Cette orientation bilingue entraîne des conséquences pour le statut de ses écrits, pour leur étude et la manière dont se forment les groupes de chercheurs qui se penchent sur eux. En dépit de l’importance centrale du bilinguisme pour l’œuvre beckettienne, l’immense majorité des publications critiques émane du monde anglo-saxon, où les recherches universitaires sont très organisées et institutionnalisées. Non seulement la partie de l’œuvre composée en anglais s’en trouve-t-elle privilégiée, mais l’on peut regretter la situation paradoxale où l’œuvre se voit célébrer sur le plan international, mais trouve son importance quelque peu relativisée dans le pays où son auteur passa la plus grande partie de sa vie.
Devant ce déséquilibre, les volumes collectifs de la Série Samuel Beckett, inscrite dans la collection « La Revue des lettres modernes », visent à apporter, aux divers échanges existant en France autour de l’œuvre, un matériel et un forum régulier. Si la critique anglophone détermine très largement l’orientation donnée aux études beckettiennes, il demeure qu’un regard spécifiquement français est susceptible d’ouvrir des perspectives de lecture inédites, et qui méritent d’être mises en valeur.
La Série publie des études en langue française mais, dans un souci d’ouverture et d’échange, elle accueille aussi des textes traduits de l’anglais. Les études, se réclamant de diverses approches méthodologiques, portent tant sur les textes en français que sur ceux en anglais. Afin d’assurer une valorisation optimale des travaux auprès des chercheurs à l’étranger, chacune des contributions est accompagnée de son résumé bilingue. Dans l’objectif de faire connaître l’actualité des recherches du monde anglophone auprès d’un public de chercheurs français, des recensions des nombreux travaux paraissant à l’étranger sont réalisées de la manière la plus systématique possible.
Llewellyn Brown
Cette orientation bilingue entraîne des conséquences pour le statut de ses écrits, pour leur étude et la manière dont se forment les groupes de chercheurs qui se penchent sur eux. En dépit de l’importance centrale du bilinguisme pour l’œuvre beckettienne, l’immense majorité des publications critiques émane du monde anglo-saxon, où les recherches universitaires sont très organisées et institutionnalisées. Non seulement la partie de l’œuvre composée en anglais s’en trouve-t-elle privilégiée, mais l’on peut regretter la situation paradoxale où l’œuvre se voit célébrer sur le plan international, mais trouve son importance quelque peu relativisée dans le pays où son auteur passa la plus grande partie de sa vie.
Devant ce déséquilibre, les volumes collectifs de la Série Samuel Beckett, inscrite dans la collection « La Revue des lettres modernes », visent à apporter, aux divers échanges existant en France autour de l’œuvre, un matériel et un forum régulier. Si la critique anglophone détermine très largement l’orientation donnée aux études beckettiennes, il demeure qu’un regard spécifiquement français est susceptible d’ouvrir des perspectives de lecture inédites, et qui méritent d’être mises en valeur.
La Série publie des études en langue française mais, dans un souci d’ouverture et d’échange, elle accueille aussi des textes traduits de l’anglais. Les études, se réclamant de diverses approches méthodologiques, portent tant sur les textes en français que sur ceux en anglais. Afin d’assurer une valorisation optimale des travaux auprès des chercheurs à l’étranger, chacune des contributions est accompagnée de son résumé bilingue. Dans l’objectif de faire connaître l’actualité des recherches du monde anglophone auprès d’un public de chercheurs français, des recensions des nombreux travaux paraissant à l’étranger sont réalisées de la manière la plus systématique possible.
Llewellyn Brown
Samuel Beckett, un écrivain de l'abstraction ?
« Samuel Beckett ; n° 7 »
|
Le terme abstraction revient de manière récurrente sous la plume des critiques beckettiens, étant devenu un lieu commun aux allures d’une évidence qui n’est pas toujours définie ou interrogée. Il est vrai, cependant, que de nombreuses caractéristiques de l’œuvre semblent justifier ce qualificatif : autant dans le théâtre que dans la fiction, les personnages et les lieux paraissent progressivement délestés de toute fonction référentielle. L’objectif du présent recueil consiste à interroger le vocable abstrait, afin d’en déceler la complexité. Les études successives offrent autant d’éclairages mettant à jour la portée de cette notion, en sorte qu’elle n’apparaisse pas simple ou univoque, mais foncièrement problématique : la pertinence de l’idée d’abstraction paraîtra, dans le contexte beckettien, comme étant à la fois confirmée et nuancée, processus au cours duquel elle aura gagné en précision.
The term abstraction is frequently used by critics in Beckett studies, and has become commonplace, appearing as self-evident without always being defined or questioned. It is true however that many characteristics of Beckett's work would seem to justify this description: both in his theatre and in his fiction, characters and places appear to be progressively emptied of any referential function. The aim of the present volume is to question the vocable abstract, in order to discern its complexity. The successive studies shed light and renew the range of meanings included in this notion, so that it no longer appears simple or unequivocal, but fundamentally problematic: the relevance of the idea of abstraction will appear, in the context of Beckett's work, as being both confirmed and nuanced, a process in which it will have gained additional precision. |
Sommaire
Avant-propos, par Llewellyn BROWN
I. CONTINUITÉ ET RUPTURE
1. Samuel Beckett et l’abstraction : réflexions préliminaires, par Llewellyn BROWN
2. Le principe citationnel dans la première œuvre de Samuel Beckett : un abstracteur de surréalessence ?, par Bernard-Olivier POSSE
II. L'IMAGE ET LE VISUEL
3. Les objets dans Mal vu mal dit de Samuel Beckett : l’abstraction, l’affect et l’impossibilité de l’absence, par Arka CHATTOPADHYAY
4. Samuel Beckett, Bram van Velde et les pièces pour la télévision, Eh Joe et Quad I : l’expérience esthétique de l’abstrait, par Julie BÉNARD
5. Beckett réalisateur de l’abstraction ?: examen des œuvres télévisuelles, par Anne-Cécile GUILBARD
III. L'OBSTACLE NON SPÉCULAIRE
6. L’Abstraction beckettienne : forme, informe et dénégation, par Isabelle OST
7. Samuel Beckett, abs/tractions et fixion du sinthome, par Bruno GENESTE
IV. LE CORPS
8. L’abstraction du corps dans les pièces théâtrales et radiophoniques de Samuel Beckett, par Pim VERHULST
9. Cap au pire selon les chorégraphes Maguy Marin et Dominique Dupuy : entre abstraction et concrétisation, par Évelyne CLAVIER
10. Beckett, le souffle et le corps : un « gage de vie », par Llewellyn BROWN
ÉTUDES
The Letters of Samuel Beckett, 1966-1989 : une vie d’écriture, par Éric WESSLER
Jean-Philippe Toussaint, ou comment écrire après Beckett, par Florence BERNARD
COMPTES RENDUS
Llewellyn BROWN. Beckett, Lacan and the Voice (par Sibylle Guipaud) ; Matthew FELDMAN, Erik TONNING et David ADDYMAN (dir.), Samuel Beckett and BBC Radio : A Reassessment (Julie Bénard) ; SBT/A, vol. 28 /2 : “Clinique et poétique du vieillir dans le théâtre de Beckett / Clinics and Poetics: Beckett’s Theatre and Aging” (Llewellyn Brown) ; Mariko HORI TANAKA, Yoshiki TAJIRI et Michiko TSUSHIMA (dir.), Samuel Beckett and Trauma (Llewellyn Brown) ; Trish McTIGHE et David TUCKER (dir.), Staging Samuel Beckett in Great Britain. (Pascale Sardin) ; Trish McTIGHE et David TUCKER (dir.), Staging Samuel Beckett in Ireland and Northern Ireland (Hélène Lecossois) ; Matthieu PROTIN De la page au plateau: Beckett auteur-metteur en scène de son premier théâtre (Marie-Claude Hubert) ; P. J. MURPHY et Nick PAWLIUK (dir.), Beckett in Popular Culture: Essays on a Postmodern Icon (Bernard-Olivier Posse) : Anthony PARASKEVA, Beckett and Cinema (Llewellyn Brown) ; David LLOYD, Beckett’s Thing : Painting and Theatre (Llewellyn Brown) ; Esteban RESTREPO, (Anti)Chambres : les architectures fragiles dans l’œuvre de Samuel Beckett (Lydie Parisse) ; Dirk VAN HULLE, The Making of Samuel Beckett’s “Krapp’s Last Tape” / “La Dernière bande” (Sjef Houppermans) ; Daniel SACK, Samuel Beckett’s “Krapp’s Last Tape” (Sjef Houppermans) ; Bruno CLÉMENT, Beckett (Sjef Houppermans) ; François BRUZZO, Samuel Beckett : landes, rives et rivages en 19 glanures …au nom de la beauté (Michel Bertrand) ; Gilles ERNST, Catholiques et anglicans chez Samuel Beckett : essai sur une contre-ecclésiologie (Rémy Bertaux-d’Orgeville) ; Emilie MORIN, Beckett’s Political Imagination (Llewellyn Brown) ; Leland de la DURANTAYE, Beckett’s Art of Mismaking (Natália Laranjinha) ; Dirk VAN HULLE (dir.), The New Cambridge Companion to Samuel Beckett (Edward Bizub) ; S. E. GONTARSKI, Beckett Matters: Essays on Beckett’s Late Modernism (Edward Bizub) ; Jonathan BOUTLER, Posthuman Space in Samuel Beckett’s Short Prose (Llewellyn Brown) ; Arka CHATTOPADHYAY, Beckett, Lacan and the Mathematical Writing of the Real (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 29/1 : “Endlessness of Ending : Samuel Beckett and Extensions of Mind / Samuel Beckett et les extensions de l’esprit” (Llewellyn Brown) ; Anthony CORDINGLEY, Samuel Beckett’s “How It Is” : Philosophy in Translation (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 28/1 : “Beckett in Conversation, ‘yet again’ / Rencontres avec Beckett, ‘encore’” (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 30/2 : “Beckett Beyond Words / Beckett au-delà des mots” (Llewellyn Brown) ; Solveig HUDHOMME, L’Élaboration du mythe de soi dans l’œuvre de Samuel Beckett (Nadia Louar) ; David KLEINBERG-LEVIN, Beckett’s Words : The Promise of Happiness in a Time of Mourning (Yann Mével) ; Jean-Michel RABATÉ, Think Pig ! : Beckett at the Limit of the Human (Elsa Baroghel).
Commander en ligne ici.
I. CONTINUITÉ ET RUPTURE
1. Samuel Beckett et l’abstraction : réflexions préliminaires, par Llewellyn BROWN
2. Le principe citationnel dans la première œuvre de Samuel Beckett : un abstracteur de surréalessence ?, par Bernard-Olivier POSSE
II. L'IMAGE ET LE VISUEL
3. Les objets dans Mal vu mal dit de Samuel Beckett : l’abstraction, l’affect et l’impossibilité de l’absence, par Arka CHATTOPADHYAY
4. Samuel Beckett, Bram van Velde et les pièces pour la télévision, Eh Joe et Quad I : l’expérience esthétique de l’abstrait, par Julie BÉNARD
5. Beckett réalisateur de l’abstraction ?: examen des œuvres télévisuelles, par Anne-Cécile GUILBARD
III. L'OBSTACLE NON SPÉCULAIRE
6. L’Abstraction beckettienne : forme, informe et dénégation, par Isabelle OST
7. Samuel Beckett, abs/tractions et fixion du sinthome, par Bruno GENESTE
IV. LE CORPS
8. L’abstraction du corps dans les pièces théâtrales et radiophoniques de Samuel Beckett, par Pim VERHULST
9. Cap au pire selon les chorégraphes Maguy Marin et Dominique Dupuy : entre abstraction et concrétisation, par Évelyne CLAVIER
10. Beckett, le souffle et le corps : un « gage de vie », par Llewellyn BROWN
ÉTUDES
The Letters of Samuel Beckett, 1966-1989 : une vie d’écriture, par Éric WESSLER
Jean-Philippe Toussaint, ou comment écrire après Beckett, par Florence BERNARD
COMPTES RENDUS
Llewellyn BROWN. Beckett, Lacan and the Voice (par Sibylle Guipaud) ; Matthew FELDMAN, Erik TONNING et David ADDYMAN (dir.), Samuel Beckett and BBC Radio : A Reassessment (Julie Bénard) ; SBT/A, vol. 28 /2 : “Clinique et poétique du vieillir dans le théâtre de Beckett / Clinics and Poetics: Beckett’s Theatre and Aging” (Llewellyn Brown) ; Mariko HORI TANAKA, Yoshiki TAJIRI et Michiko TSUSHIMA (dir.), Samuel Beckett and Trauma (Llewellyn Brown) ; Trish McTIGHE et David TUCKER (dir.), Staging Samuel Beckett in Great Britain. (Pascale Sardin) ; Trish McTIGHE et David TUCKER (dir.), Staging Samuel Beckett in Ireland and Northern Ireland (Hélène Lecossois) ; Matthieu PROTIN De la page au plateau: Beckett auteur-metteur en scène de son premier théâtre (Marie-Claude Hubert) ; P. J. MURPHY et Nick PAWLIUK (dir.), Beckett in Popular Culture: Essays on a Postmodern Icon (Bernard-Olivier Posse) : Anthony PARASKEVA, Beckett and Cinema (Llewellyn Brown) ; David LLOYD, Beckett’s Thing : Painting and Theatre (Llewellyn Brown) ; Esteban RESTREPO, (Anti)Chambres : les architectures fragiles dans l’œuvre de Samuel Beckett (Lydie Parisse) ; Dirk VAN HULLE, The Making of Samuel Beckett’s “Krapp’s Last Tape” / “La Dernière bande” (Sjef Houppermans) ; Daniel SACK, Samuel Beckett’s “Krapp’s Last Tape” (Sjef Houppermans) ; Bruno CLÉMENT, Beckett (Sjef Houppermans) ; François BRUZZO, Samuel Beckett : landes, rives et rivages en 19 glanures …au nom de la beauté (Michel Bertrand) ; Gilles ERNST, Catholiques et anglicans chez Samuel Beckett : essai sur une contre-ecclésiologie (Rémy Bertaux-d’Orgeville) ; Emilie MORIN, Beckett’s Political Imagination (Llewellyn Brown) ; Leland de la DURANTAYE, Beckett’s Art of Mismaking (Natália Laranjinha) ; Dirk VAN HULLE (dir.), The New Cambridge Companion to Samuel Beckett (Edward Bizub) ; S. E. GONTARSKI, Beckett Matters: Essays on Beckett’s Late Modernism (Edward Bizub) ; Jonathan BOUTLER, Posthuman Space in Samuel Beckett’s Short Prose (Llewellyn Brown) ; Arka CHATTOPADHYAY, Beckett, Lacan and the Mathematical Writing of the Real (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 29/1 : “Endlessness of Ending : Samuel Beckett and Extensions of Mind / Samuel Beckett et les extensions de l’esprit” (Llewellyn Brown) ; Anthony CORDINGLEY, Samuel Beckett’s “How It Is” : Philosophy in Translation (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 28/1 : “Beckett in Conversation, ‘yet again’ / Rencontres avec Beckett, ‘encore’” (Llewellyn Brown) ; SBT/A, vol. 30/2 : “Beckett Beyond Words / Beckett au-delà des mots” (Llewellyn Brown) ; Solveig HUDHOMME, L’Élaboration du mythe de soi dans l’œuvre de Samuel Beckett (Nadia Louar) ; David KLEINBERG-LEVIN, Beckett’s Words : The Promise of Happiness in a Time of Mourning (Yann Mével) ; Jean-Michel RABATÉ, Think Pig ! : Beckett at the Limit of the Human (Elsa Baroghel).
Commander en ligne ici.
“Textes pour rien” / “Texts for Nothing” de Samuel Beckett :
Le corps de la voix impossible
« Samuel Beckett ; n° 6 »
|
Samuel Beckett a pu qualifier Textes pour rien d’« arrière-faix de L’Innommable », et la critique semble s’être alignée sans hésiter sur ce jugement négatif, voyant dans cette œuvre l’expression d’une impasse dans la création beckettienne. Face à ce constat, ce volume – complétant le livre d’annotations qui le précède dans notre Série – vise à affirmer son importance, à en faire entendre la richesse et la beauté, dans l’objectif de susciter un regain d’intérêt pour ce corpus. Celui-ci se distingue par la singularité de son esthétique, représentant aussi un moment d’approfondissement et de renouveau de l’écriture beckettienne. Une lecture du troisième tome des Lettres, et une étude des liens entre Beckett et Lacan complètent ce parcours.
Samuel Beckett once called Texts for Nothing “a bit torn off the placenta of The Unnamable”, and critics seem to have unhesitatingly aligned themselves with this negative judgement, seeing in this work the expression of an impasse in Beckettian creation. Face with such a perception, this volume—complementing the book of annotations that precedes it in our Series—aims to assert its importance, to reveal its wealth and beauty, with the objective of arousing a revival of interest for this corpus. The latter stands out by the uniqueness of its æsthetics, also representing a moment of deepening and renewal of Beckett’s writing. A reading of the third volume of the Letters, and a study of the links between Beckett and Lacan complete this exploration. |
Sommaire
Avant-propos, par Llewellyn BROWN
1. Textes pour rien de Samuel Beckett : place au sein de l’œuvre et enjeux, par Llewellyn BROWN
2. Samuel Beckett : la traduction en anglais de Textes pour rien, par Mark NIXON
II. IDÉES ET CONTEXTES
3. Dénaturer la connaissance dans Textes pour rien de Samuel Beckett, par Anthony UHLMANN
4. Textes pour rien de Samuel Beckett : une lecture christique, par Rémy Bertaux d’ORGEVILLE
5. Une lecture post-apocalyptique du silence dans Textes pour rien de Samuel Beckett, par Mariko Hori TANAKA
6. La quête poétique du récit dans Textes pour rien de Samuel Beckett : “Avoir voix au chapitre”, par Johan FAERBER
III. “RIEN”
7. Va-et-vient et inscription de l’Unheimlich dans Textes pour rien de Samuel Beckett :
trop près, trop loin, c’est trois fois rien, par Sjef HOUPPERMANS
8. Rien et dire chez Samuel Beckett à partir d’une notation de Jacques Lacan : peut-être rien… rien peut-être ?, par Bruno GENESTE
IV. IMAGE
9. Les Églogues “pour rien” de Samuel Beckett : Et in Arcadia ego, par Stéphanie RAVEZ
10. Présence et absence de l’astre solaire dans Textes pour rien : quoi de neuf sans le soleil ?, par Éric WESSLER
11. Le Repentir dans Textes pour rien de Samuel Beckett : un geste entre écriture et peinture, ou comment se reprendre,
par Guillaume GESVRET
12. Avigdor Arikha illustre Textes pour rien de Samuel Beckett : “Dessins pour rien”, par David LLOYD
V. VOIX ET LANGUE
13. La Question du bilinguisme dans Textes pour rien / Texts for Nothing, par Nadia LOUAR
14. Textes pour rien / Texts for Nothing de Samuel Beckett : musicalité et structure, par Llewellyn BROWN
15. Incidence de la voix dans Textes pour rien de Samuel Beckett : un pas rien d’insolitude, par Albert NGUYÊN
ÉTUDES
16. Lacan avec Beckett, par Suzanne DOW
17. The Letters of Samuel Beckett (1957-1965) : la griffe de Beckett : cloué à jamais, toujours entre…, par Edward BIZUB
COMPTES RENDUS
Mary BRYDEN (dir.), Beckett and Animals (par Nadia Louar) ; John CALDER, The Theology of Samuel Beckett (par Edward Bizub) ; Iain BAILEY, Samuel Beckett and the Bible (par Llewellyn Brown) ; Tatiana CHEMI, In the Beginning Was the Pun : Comedy and Humour in Samuel Beckett’s Theatre (par Edward Bizub ) ; Matthew FELDMAN, Erik TONNING et Henry MEAD (dir.), Broadcasting in the Modernist Era, (par Geneviève Chevallier) ; Matthew FELDMAN, Falsifying Beckett : Essays on Archives, Philosophy and Methodology in Beckett Studies (par Matthieu Protin) ; Stanley E. GONTARSKI, Creative Involution : Bergson, Beckett, Deleuze (par Llewellyn Brown) ; Stanley E. GONTARSKI, (dir.), The Edinburgh Companion to Samuel Beckett and the Arts, (par Llewellyn Brown); Geneviève MATHON, et David LAUFFER (dir.), Beckett et la Musique, (par Rémy Bertaux d’Orgeville); Trish McTIGHE, The Haptic Aesthetic in Samuel Beckett’s Drama (par Natália Laranjinha); Martin PAGE, L’Apiculture selon Samuel Beckett (par Claire Lozier) ; David TUCKER, Mark NIXON et Dirk VAN HULLE (dir.), Samuel Beckett Today/aujourd’hui, no. 26, (par Llewellyn Brown) ; Marcin TERESZEWSKI, The Aesthetics of Failure : Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction (par Natália Laranjinha) ; Vincent TROVATO, La Mémoire du temps chez Proust et Beckett (par Michel Bertrand) ; David TUCKER, Samuel Beckett and Arnold Geulincx : Tracing « A Literary Fantasia » (par Edward Bizub) ; Ian MILLER et Kay SOUTER, Beckett and Bion : The (Im)patient Voice in Psychotherapy and Literature (par Llewellyn Brown) ; Dirk VAN HULLE et Shane WELLER, The Making of Samuel Beckett’s “L’Innommable” / “The Unnamable” (par Thomas Hunkeler) ; Dirk VAN HULLE, Modern Manuscripts : the Extended Mind and Creative Undoing from Darwin to Beckett and Beyond (par Edward Bizub) ; Dirk VAN HULLE, et Mark NIXON. Samuel Beckett’s Library (par Stefano Genetti) ; Jan WILM et Mark NIXON (dir.) Samuel Beckett und die deutsche Literatur, (par Florence Godeau); Katharine WORTH, The Irish Drama of Europe from Yeats to Beckett (par Hélène Lecossois).
Commander en ligne ici.
1. Textes pour rien de Samuel Beckett : place au sein de l’œuvre et enjeux, par Llewellyn BROWN
2. Samuel Beckett : la traduction en anglais de Textes pour rien, par Mark NIXON
II. IDÉES ET CONTEXTES
3. Dénaturer la connaissance dans Textes pour rien de Samuel Beckett, par Anthony UHLMANN
4. Textes pour rien de Samuel Beckett : une lecture christique, par Rémy Bertaux d’ORGEVILLE
5. Une lecture post-apocalyptique du silence dans Textes pour rien de Samuel Beckett, par Mariko Hori TANAKA
6. La quête poétique du récit dans Textes pour rien de Samuel Beckett : “Avoir voix au chapitre”, par Johan FAERBER
III. “RIEN”
7. Va-et-vient et inscription de l’Unheimlich dans Textes pour rien de Samuel Beckett :
trop près, trop loin, c’est trois fois rien, par Sjef HOUPPERMANS
8. Rien et dire chez Samuel Beckett à partir d’une notation de Jacques Lacan : peut-être rien… rien peut-être ?, par Bruno GENESTE
IV. IMAGE
9. Les Églogues “pour rien” de Samuel Beckett : Et in Arcadia ego, par Stéphanie RAVEZ
10. Présence et absence de l’astre solaire dans Textes pour rien : quoi de neuf sans le soleil ?, par Éric WESSLER
11. Le Repentir dans Textes pour rien de Samuel Beckett : un geste entre écriture et peinture, ou comment se reprendre,
par Guillaume GESVRET
12. Avigdor Arikha illustre Textes pour rien de Samuel Beckett : “Dessins pour rien”, par David LLOYD
V. VOIX ET LANGUE
13. La Question du bilinguisme dans Textes pour rien / Texts for Nothing, par Nadia LOUAR
14. Textes pour rien / Texts for Nothing de Samuel Beckett : musicalité et structure, par Llewellyn BROWN
15. Incidence de la voix dans Textes pour rien de Samuel Beckett : un pas rien d’insolitude, par Albert NGUYÊN
ÉTUDES
16. Lacan avec Beckett, par Suzanne DOW
17. The Letters of Samuel Beckett (1957-1965) : la griffe de Beckett : cloué à jamais, toujours entre…, par Edward BIZUB
COMPTES RENDUS
Mary BRYDEN (dir.), Beckett and Animals (par Nadia Louar) ; John CALDER, The Theology of Samuel Beckett (par Edward Bizub) ; Iain BAILEY, Samuel Beckett and the Bible (par Llewellyn Brown) ; Tatiana CHEMI, In the Beginning Was the Pun : Comedy and Humour in Samuel Beckett’s Theatre (par Edward Bizub ) ; Matthew FELDMAN, Erik TONNING et Henry MEAD (dir.), Broadcasting in the Modernist Era, (par Geneviève Chevallier) ; Matthew FELDMAN, Falsifying Beckett : Essays on Archives, Philosophy and Methodology in Beckett Studies (par Matthieu Protin) ; Stanley E. GONTARSKI, Creative Involution : Bergson, Beckett, Deleuze (par Llewellyn Brown) ; Stanley E. GONTARSKI, (dir.), The Edinburgh Companion to Samuel Beckett and the Arts, (par Llewellyn Brown); Geneviève MATHON, et David LAUFFER (dir.), Beckett et la Musique, (par Rémy Bertaux d’Orgeville); Trish McTIGHE, The Haptic Aesthetic in Samuel Beckett’s Drama (par Natália Laranjinha); Martin PAGE, L’Apiculture selon Samuel Beckett (par Claire Lozier) ; David TUCKER, Mark NIXON et Dirk VAN HULLE (dir.), Samuel Beckett Today/aujourd’hui, no. 26, (par Llewellyn Brown) ; Marcin TERESZEWSKI, The Aesthetics of Failure : Inexpressibility in Samuel Beckett’s Fiction (par Natália Laranjinha) ; Vincent TROVATO, La Mémoire du temps chez Proust et Beckett (par Michel Bertrand) ; David TUCKER, Samuel Beckett and Arnold Geulincx : Tracing « A Literary Fantasia » (par Edward Bizub) ; Ian MILLER et Kay SOUTER, Beckett and Bion : The (Im)patient Voice in Psychotherapy and Literature (par Llewellyn Brown) ; Dirk VAN HULLE et Shane WELLER, The Making of Samuel Beckett’s “L’Innommable” / “The Unnamable” (par Thomas Hunkeler) ; Dirk VAN HULLE, Modern Manuscripts : the Extended Mind and Creative Undoing from Darwin to Beckett and Beyond (par Edward Bizub) ; Dirk VAN HULLE, et Mark NIXON. Samuel Beckett’s Library (par Stefano Genetti) ; Jan WILM et Mark NIXON (dir.) Samuel Beckett und die deutsche Literatur, (par Florence Godeau); Katharine WORTH, The Irish Drama of Europe from Yeats to Beckett (par Hélène Lecossois).
Commander en ligne ici.
“Textes pour rien” / “Texts for Nothing” : annotations
par Chris Ackerley et Llewellyn Brown
« Samuel Beckett ; n° 5 »
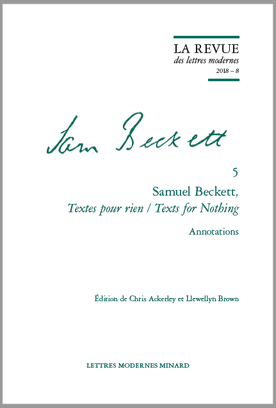
Textes pour rien / Texts for Nothing, de Samuel Beckett, a été relativement négligé par la critique, qui tend à le réduire à l’expression d’une impasse créative. Ce livre – comme les études dans le volume suivant de notre Série – vise à le révéler comme une réussite esthétique. Ces annotations éclairent la structure de l’œuvre, la richesse des allusions intertextuelles ou biographiques, et des échos aux autres œuvres de Beckett. Elles commentent les nuances de ton et des effets de style. S’adressant à un lectorat bilingue, cet ouvrage souligne les divergences entre les deux “versions”, et qui sont révélatrices de certains choix esthétiques de l’auteur. Cette étude est complétée par une bibliographie de la critique en français et en anglais.
Samuel Beckett’s Texts for Nothing has been relatively neglected by critics, who tend to reduce it to the expression of a creative impasse. This book—like the studies in the following volume of our Series—aims to reveal it as an æsthetic success. These annotation shed light on the structure of the work, the wealth of its intertextual or biographical allusions, and echoes of Beckett’s other works. They comment the nuances of tone and stylistic effects. Addressing a bilingual readership, this book emphasises the divergences between the two ‘versions’, and which reveal some of the author’s æsthetic choices. This study is complemented by a bibliography of critical works in French and in English.
Commander en ligne ici.
Samuel Beckett’s Texts for Nothing has been relatively neglected by critics, who tend to reduce it to the expression of a creative impasse. This book—like the studies in the following volume of our Series—aims to reveal it as an æsthetic success. These annotation shed light on the structure of the work, the wealth of its intertextual or biographical allusions, and echoes of Beckett’s other works. They comment the nuances of tone and stylistic effects. Addressing a bilingual readership, this book emphasises the divergences between the two ‘versions’, and which reveal some of the author’s æsthetic choices. This study is complemented by a bibliography of critical works in French and in English.
Commander en ligne ici.
La Violence dans l'œuvre de Samuel Beckett
entre langage et corps
« Samuel Beckett ; n° 4 »
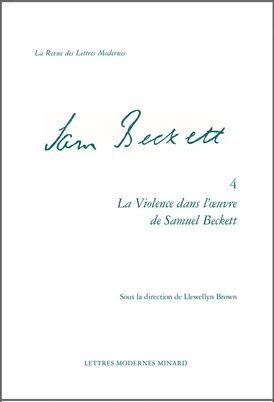
Loin d’habiter les marges de l’œuvre de Beckett, la violence y occupe une place cruciale. Telle est l’hypothèse de ce volume, qui cherche à en définir la nature et les formes. Se manifestant dans des éclats meurtriers survenant entre doubles spéculaires, ou dans des supplices inspirés par Sade, cette violence s’entend comme un effet du langage, qu’elle ne laisse jamais s’apaiser. Le domaine de l’image aussi se trouve menacé de destruction, tant par un regard intrusif que par l’arbitraire des mots. Une étude du deuxième volume des Lettres de Beckett et une chronologie de son voyage en Allemagne complètent cette exploration.
Far from being confined to the margins, violence occupies a crucial place in Beckett’s work. Such is the hypothesis behind this volume, which seeks to define the nature and the forms of this violence. Appearing in murderous outbursts occurring between specular doubles, or in tortures inspired by Sade, violence is understood as an effect of language, and can never be assuaged. The field of the image too is threatened by destruction, both by an intrusive gaze and by the arbitrary nature of words. A study of the second volume of Beckett’s Letters, and a chronology of his trip through Germany complete this exploration.
Lire l'avant-propos ici.
Far from being confined to the margins, violence occupies a crucial place in Beckett’s work. Such is the hypothesis behind this volume, which seeks to define the nature and the forms of this violence. Appearing in murderous outbursts occurring between specular doubles, or in tortures inspired by Sade, violence is understood as an effect of language, and can never be assuaged. The field of the image too is threatened by destruction, both by an intrusive gaze and by the arbitrary nature of words. A study of the second volume of Beckett’s Letters, and a chronology of his trip through Germany complete this exploration.
Lire l'avant-propos ici.
Sommaire
Avant-propos, par Llewellyn BROWN
1. Samuel Beckett et la violence : un parcours de l’œuvre, par Llewellyn BROWN
I. VIOLENCE ET LANGAGE
2. Violence du discours chez Beckett : les voix de “derrière”, par Stéphane BIKIALO
3. Worstward Ho de Samuel Beckett : la violence du logos, par Cécile YAPAUDJIAN-LABAT
4. Samuel Beckett, l’“entre” vivifiant de lalangue et l’hiatus sinthomatique : contrer ces vérités du Surmoi, par Bruno GENESTE
II. VIOLENCE DES COUPLES
5. Doubles imaginaires et violence dans Molloy de Samuel Beckett, par Llewellyn BROWN
6. Violence du Beckett de Bataille : « Le Silence de Molloy », par Claire LOZIER
7. Samuel Beckett et les meurtrissures du corps, par Natália LARANJINHA
8. Violence de l’horizontalité chez Samuel Beckett : la boue, les coups, et plus si affinités, par Michel BERTRAND
9. Comment c’est de Samuel Beckett : le ventriloque à la fourrure, par Anthony CORDINGLEY
10. Samuel Beckett, lecteur de Sade : Comment c’est et Les Cent Vingt Journées de Sodome, par Elsa BAROGHEL
III. VIOLENCE DU REGARD
11. La Violence comme métaphore de l’écriture dans l’œuvre de Beckett, par Éric WESSLER
12. Beckett et la violence du voir : « voir à mort », par Anne-Cécile GUILBARD
13. Une violence invisible du regard chez Beckett : la rupture entre le voyant et le vu, dans l’œuvre ultérieure, par Éri MIYAWAKI
DOCUMENT
14. Chronologie du voyage de Samuel Beckett en Allemagne : 28 septembre 1936 – 2 avril 1937, par Mark NIXON
LECTURE
15. Beckett l’épistolier ou “l’homme-à-la-bêche” : The Letters of Samuel Beckett, t. 2, “1941-1956”, par Garin DOWD
COMPTES RENDUS
Nicolas DOUTEY (éd.), Notes de Beckett sur Geulincx ; Edward BIZUB, Beckett et Descartes dans l’œuf : aux sources de l’œuvre beckettienne, de “Whoroscope” à “Godot” (par Jean-Michel Rabaté) – Matthew FELDMAN et Karim MAMDANI (éds.), Beckett / Philosophy (par Bruno Clément) – Peter FIFIELD, Bryan RADLEY et Lawrence RAINEY (dirs.), Modernism/Modernity, vol. 18, no 4 : “Beckett out of the Archive” (par Stéphanie Ravez) – Marie-Claude HUBERT (dir.), Dictionnaire Beckett (par Llewellyn Brown) – Claire LOZIER, De l’abject et du sublime : Georges Bataille, Jean Genet, Samuel Beckett (par Florence Bernard) – Sinéad MOONEY, A Tongue Not Mine : Beckett and Translation (par Nadia Louar) – Julien PIAT et Philippe WAHL (dirs.), La Prose de Samuel Beckett : configuration et progression discursives (par Philippe Jousset) – Ciaran ROSS, Beckett’s Art of Absence : Rethinking the Void (par Isabelle Ost) – Samuel BECKETT, Echo’s Bones, Mark Nixon (éd.) ; John PILLING, Samuel Beckett’s “More Pricks than Kicks” : In a Strait of Two Wills (par Thomas Hukeler) – Mariko HORI TANAKA, Yoshiki TAJIRI et Michiko TSUSHIMA (dirs.), Samuel Beckett and Pain (par Florence Godeau) – Serpilekin Adeline TERLEMEZ, Le Théâtre innommable de Samuel Beckett (par Michel Bertrand).
Commander en ligne ici.
1. Samuel Beckett et la violence : un parcours de l’œuvre, par Llewellyn BROWN
I. VIOLENCE ET LANGAGE
2. Violence du discours chez Beckett : les voix de “derrière”, par Stéphane BIKIALO
3. Worstward Ho de Samuel Beckett : la violence du logos, par Cécile YAPAUDJIAN-LABAT
4. Samuel Beckett, l’“entre” vivifiant de lalangue et l’hiatus sinthomatique : contrer ces vérités du Surmoi, par Bruno GENESTE
II. VIOLENCE DES COUPLES
5. Doubles imaginaires et violence dans Molloy de Samuel Beckett, par Llewellyn BROWN
6. Violence du Beckett de Bataille : « Le Silence de Molloy », par Claire LOZIER
7. Samuel Beckett et les meurtrissures du corps, par Natália LARANJINHA
8. Violence de l’horizontalité chez Samuel Beckett : la boue, les coups, et plus si affinités, par Michel BERTRAND
9. Comment c’est de Samuel Beckett : le ventriloque à la fourrure, par Anthony CORDINGLEY
10. Samuel Beckett, lecteur de Sade : Comment c’est et Les Cent Vingt Journées de Sodome, par Elsa BAROGHEL
III. VIOLENCE DU REGARD
11. La Violence comme métaphore de l’écriture dans l’œuvre de Beckett, par Éric WESSLER
12. Beckett et la violence du voir : « voir à mort », par Anne-Cécile GUILBARD
13. Une violence invisible du regard chez Beckett : la rupture entre le voyant et le vu, dans l’œuvre ultérieure, par Éri MIYAWAKI
DOCUMENT
14. Chronologie du voyage de Samuel Beckett en Allemagne : 28 septembre 1936 – 2 avril 1937, par Mark NIXON
LECTURE
15. Beckett l’épistolier ou “l’homme-à-la-bêche” : The Letters of Samuel Beckett, t. 2, “1941-1956”, par Garin DOWD
COMPTES RENDUS
Nicolas DOUTEY (éd.), Notes de Beckett sur Geulincx ; Edward BIZUB, Beckett et Descartes dans l’œuf : aux sources de l’œuvre beckettienne, de “Whoroscope” à “Godot” (par Jean-Michel Rabaté) – Matthew FELDMAN et Karim MAMDANI (éds.), Beckett / Philosophy (par Bruno Clément) – Peter FIFIELD, Bryan RADLEY et Lawrence RAINEY (dirs.), Modernism/Modernity, vol. 18, no 4 : “Beckett out of the Archive” (par Stéphanie Ravez) – Marie-Claude HUBERT (dir.), Dictionnaire Beckett (par Llewellyn Brown) – Claire LOZIER, De l’abject et du sublime : Georges Bataille, Jean Genet, Samuel Beckett (par Florence Bernard) – Sinéad MOONEY, A Tongue Not Mine : Beckett and Translation (par Nadia Louar) – Julien PIAT et Philippe WAHL (dirs.), La Prose de Samuel Beckett : configuration et progression discursives (par Philippe Jousset) – Ciaran ROSS, Beckett’s Art of Absence : Rethinking the Void (par Isabelle Ost) – Samuel BECKETT, Echo’s Bones, Mark Nixon (éd.) ; John PILLING, Samuel Beckett’s “More Pricks than Kicks” : In a Strait of Two Wills (par Thomas Hukeler) – Mariko HORI TANAKA, Yoshiki TAJIRI et Michiko TSUSHIMA (dirs.), Samuel Beckett and Pain (par Florence Godeau) – Serpilekin Adeline TERLEMEZ, Le Théâtre innommable de Samuel Beckett (par Michel Bertrand).
Commander en ligne ici.
Les “dramaticules”
« Samuel Beckett ; n° 3 »
|
Moins connu que celui des “grandes” pièces, le dernier théâtre de Samuel Beckett révèle des œuvres finement ciselées et dont la matière est réduite à l’essentiel. C’est un corpus que l’auteur a souvent désigné par le néologisme “dramaticules”. Son unité peut se saisir dans son caractère minimaliste qui, loin d’être un simple choix esthétique, semble témoigner de la volonté d’épouser une rigueur logique, celle-ci n’étant pas étrangère à la scission que Beckett pratique entre le personnage et sa parole, entre le récit et l’espace scénique. Cependant, cette structuration synchronique rencontre des moments de rupture, où le personnage fait entendre sa subjectivité dans un cri, qui apparaît aussi comme un évanouissement.
If the ‘major plays’—Waiting for Godot, Happy Days and Endgame—are now part of the repertoire of stage directors, Beckett’s late theatre is ignored by non-specialists. So this third volume of our Series seeks to reveal the great poetic wealth of these works belonging to Beckett’s maturity, and which we call—following the author—‘dramaticules’. After a reflection on the specificity of this corpus’ and the questions of genre it raises, this volume examines the presence/absence problematics, before studying the primordial place that these plays reserve for the voice. Two further texts deal respectively with the presence of Dante and the translation of Beckett’s plays into Hebrew. |
Sommaire
avant-propos, par Llewellyn Brown
1. Les “Dramaticules” de Samuel Beckett : un “genre” et une forme, par Llewellyn BROWN.
I. EFFETS DE GENRE
2. Le Paradoxe des “dramaticules” “ambigus” : du dramatique au théâtral, par Matthieu PROTIN.
3. Les Vestiges du monologue tragique dans A Piece of Monologue / Solo : la spectropoétique du je(u), par Delphine LEMONNIER-TEXIER
4. Quand Beckett fait son cinéma... au théâtre : une lecture de Solo, par Stéphanie RAVEZ.
II. PRÉSENCE ET ABSENCE
5. Deux expériences de l’espace beckettien : cadres cognitifs, topographies sensorielles, par Céline HERSANT.
6. Texte(s)-fantôme(s) et spectralité dans Not I (Pas moi), Rockaby (Berceuse) et Footfalls (Pas), par Florence GODEAU.
7. That Time / Cette fois de Beckett : une fabrique de “l’usine à temps”, par Mireille BOUSQUET.
III. VOIX
8. Pour une poétique de l’écoute dans Pas moi, Pas et Berceuse : la passion de la parole, par Lea SINOIMERI.
9. Rockaby / Berceuse de Samuel Beckett : un “poème à jouer”, par Llewellyn BROWN.
ÉTUDE
Beckett, lecteur de Dante, par Jean-Pierre FERRINI.
TÉMOIGNAGE
Traduire Beckett en hébreu : naviguer en suivant la carte de la mer Morte, par Shimon LEVY.
V. COMPTES RENDUS
Samuel Beckett 3 : “Les ‘dramaticules’”. Llewellyn BROWN ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2013. Coll. « La Revue des Lettres modernes». ISBN 978-2-256-91173-6. Un volume broché, rogné 19 cm. 334 p.
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
1. Les “Dramaticules” de Samuel Beckett : un “genre” et une forme, par Llewellyn BROWN.
I. EFFETS DE GENRE
2. Le Paradoxe des “dramaticules” “ambigus” : du dramatique au théâtral, par Matthieu PROTIN.
3. Les Vestiges du monologue tragique dans A Piece of Monologue / Solo : la spectropoétique du je(u), par Delphine LEMONNIER-TEXIER
4. Quand Beckett fait son cinéma... au théâtre : une lecture de Solo, par Stéphanie RAVEZ.
II. PRÉSENCE ET ABSENCE
5. Deux expériences de l’espace beckettien : cadres cognitifs, topographies sensorielles, par Céline HERSANT.
6. Texte(s)-fantôme(s) et spectralité dans Not I (Pas moi), Rockaby (Berceuse) et Footfalls (Pas), par Florence GODEAU.
7. That Time / Cette fois de Beckett : une fabrique de “l’usine à temps”, par Mireille BOUSQUET.
III. VOIX
8. Pour une poétique de l’écoute dans Pas moi, Pas et Berceuse : la passion de la parole, par Lea SINOIMERI.
9. Rockaby / Berceuse de Samuel Beckett : un “poème à jouer”, par Llewellyn BROWN.
ÉTUDE
Beckett, lecteur de Dante, par Jean-Pierre FERRINI.
TÉMOIGNAGE
Traduire Beckett en hébreu : naviguer en suivant la carte de la mer Morte, par Shimon LEVY.
V. COMPTES RENDUS
Samuel Beckett 3 : “Les ‘dramaticules’”. Llewellyn BROWN ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2013. Coll. « La Revue des Lettres modernes». ISBN 978-2-256-91173-6. Un volume broché, rogné 19 cm. 334 p.
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
Parole, regard et corps
« Samuel Beckett ; n° 2 »
|
Chez Samuel Beckett, l’écriture articule intimement la dimension esthétique à l’implication subjective du créateur, et dont on peut appréhender les effets esthétiques au sein d’une triangulation structurante. Premièrement, la fonction discriminante du signifiant apparaît sous la forme de la parole articulée, et de la voix qui, sous la forme du silence, l’excède. Ensuite, la question de l’image est indissociable de son rapport avec le revers du visible, sous les espèces du regard. Enfin, le nouage de ces deux faces se confirme à l’endroit même où l’écriture s’éprouve dans l’irréductible matérialité du corps.
In Beckett’s work, writing—in its structural meaning, independently of the medium in which it is realised—intimately articulates the æsthetic dimension with the question of the creator’s subjective implication. In the first volume of this Series (titled L’Ascèse du sujet), we dealt with some aspects of the question of what seems to inform Beckett’s creative impulse. This second volume offers us the possibility of pursuing a closely related theme, but with a change of perspective. The studies here aim to situate certain æsthetic effects within a structuring triangle. Thus we start with the discriminating function of the signifier, in the form of articulated speech, and as a voice which, in the form of silence, exceeds it. The question of the image is then examined, in relation with the gaze that underlies it. Finally, the binding of these two facets is confirmed at the very place where writing is experienced in the irreducible materiality of the body. |
Sommaire
Avant-propos, par Llewellyn Brown
I. LA MUSIQUE ET LE SILENCE
1. Inhumanité trop humaine, ou comment persister à nommer l’innommable, par Julia Siboni
2. Play/Comédie de Beckett : la recherche, toujours recommencée, d’une musique idéale, par Karine Germoni
3. Éléments recyclés dans Words and Music/Paroles et musique, par Chris Ackerley
II. LE REGARD ET LE VISUEL
4. Beckett et les frères van Velde : entre peinture et écriture, par Sjef Houppermans
5. Espace et affect dans les dernières œuvres de Beckett : variations d’échelle, par Guillaume Gesvret
6. Visible et regard chez Beckett : « Le Besoin de voir », par Llewellyn Brown
7. L’Expérience beckettienne du visage : une ascèse ?, par Yann Mével
III. LE CORPS ET SON ESPACE
8. Les Coulisses de l’écriture beckettienne, ou « Le moindre désir de prendre la plume », par Myriam Jeantroux
9. Samuel Beckett : enjeu topologique du sujet, par Marie Jejcic
Comptes rendus des parutions de 2009
CARRIEDO, Lourdes, GUERRERO, Maria Louisa, MÉNDEZ, Carmen & VERICAT, Fabio (dir.) : A vueltas con Beckett (par Anthony Cordingley)– BROWN, Llewellyn : Beckett, les fictions brèves: Voir et dire (par Nadia Louar) – BIGNELL, Jonathan : Beckett On Screen: The Television Plays (par Garin Dowd) – MAUDE, Ulrika : Beckett, Technology and the Body (par Lea Sinoimeri) – MAUDE, Ulrika. and FELDMAN, Matthew, eds. Beckett and Phenomenology (par Suzanne Dow) – MORIN, Emilie : Samuel Beckett and the Problem of Irishness (par Carol J. Murphy) – MURPHY, P. J. : Beckett’s Dedalus: Dialogical Engagements with Joyce in Beckett’s Fiction (par Scarlett Baron) – SARDIN, Pascale : Samuel Beckett et la passion maternelle ou l'hystérie à l'œuvre (par Llewellyn Brown) – TABAN, Carla : Modalités po(ï)étiques de configuration textuelle: le cas de Molloy de Samuel Beckett (par Isabelle Ost) – WESSLER, Éric : La Littérature face à elle-même : L’écriture spéculaire de Samuel Beckett (par Stéphanie Ravez) – WHITE, Kathryn : Beckett and Decay (par Teppei Suzuki).
Samuel Beckett 2 : “Parole, regard et corps”. Llewellyn Brown ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 202 p. ISBN 978-2-256-91165-1.
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
I. LA MUSIQUE ET LE SILENCE
1. Inhumanité trop humaine, ou comment persister à nommer l’innommable, par Julia Siboni
2. Play/Comédie de Beckett : la recherche, toujours recommencée, d’une musique idéale, par Karine Germoni
3. Éléments recyclés dans Words and Music/Paroles et musique, par Chris Ackerley
II. LE REGARD ET LE VISUEL
4. Beckett et les frères van Velde : entre peinture et écriture, par Sjef Houppermans
5. Espace et affect dans les dernières œuvres de Beckett : variations d’échelle, par Guillaume Gesvret
6. Visible et regard chez Beckett : « Le Besoin de voir », par Llewellyn Brown
7. L’Expérience beckettienne du visage : une ascèse ?, par Yann Mével
III. LE CORPS ET SON ESPACE
8. Les Coulisses de l’écriture beckettienne, ou « Le moindre désir de prendre la plume », par Myriam Jeantroux
9. Samuel Beckett : enjeu topologique du sujet, par Marie Jejcic
Comptes rendus des parutions de 2009
CARRIEDO, Lourdes, GUERRERO, Maria Louisa, MÉNDEZ, Carmen & VERICAT, Fabio (dir.) : A vueltas con Beckett (par Anthony Cordingley)– BROWN, Llewellyn : Beckett, les fictions brèves: Voir et dire (par Nadia Louar) – BIGNELL, Jonathan : Beckett On Screen: The Television Plays (par Garin Dowd) – MAUDE, Ulrika : Beckett, Technology and the Body (par Lea Sinoimeri) – MAUDE, Ulrika. and FELDMAN, Matthew, eds. Beckett and Phenomenology (par Suzanne Dow) – MORIN, Emilie : Samuel Beckett and the Problem of Irishness (par Carol J. Murphy) – MURPHY, P. J. : Beckett’s Dedalus: Dialogical Engagements with Joyce in Beckett’s Fiction (par Scarlett Baron) – SARDIN, Pascale : Samuel Beckett et la passion maternelle ou l'hystérie à l'œuvre (par Llewellyn Brown) – TABAN, Carla : Modalités po(ï)étiques de configuration textuelle: le cas de Molloy de Samuel Beckett (par Isabelle Ost) – WESSLER, Éric : La Littérature face à elle-même : L’écriture spéculaire de Samuel Beckett (par Stéphanie Ravez) – WHITE, Kathryn : Beckett and Decay (par Teppei Suzuki).
Samuel Beckett 2 : “Parole, regard et corps”. Llewellyn Brown ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 202 p. ISBN 978-2-256-91165-1.
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
L'Ascèse du sujet
« Samuel Beckett ; n° 1 »
|
L’écriture de Samuel Beckett apparaît comme le produit d’une ascèse, où l’auteur rapetisse son écriture sur les signifiants formant l’os d’une structuration. Le sujet beckettien se définit par sa rencontre avec sa singularité absolue, corrélée à l’impossible dans lequel le désir puise sa substance. Refusant de céder au leurre d’une adéquation possible entre signifiant et signifié, entre le mot et la chose, Beckett fait de son écriture le lieu d’un mal dire. L’expression de ce qui cause le désir de l’écriture en est rendue plus palpable, témoignant d’une adhésion inconditionnelle aux mots dans leur caractère contingent, dans leur nature écornée et ce, sans espoir de se voir récompensé par l’accès à un quelconque savoir.
Samuel Beckett's writing appears as the expression of a creative ascesis, diversely manifested by the will to be free of a corrupted body, to abolish desire or the temptation to put an end to life. These negative processes remain incomplete, marking a point where words can go no further, founding an aesthetics of failure. The effets of repetition and combinatory procedures testify to the presence of the subject of writing confronted with the opaque core of his creation. This theme is explored from the perspectives opened by psychoanalysis, philosophy, genetic analysis, comparative studies and the implications of biligualism. |
Sommaire
Présentation de la Série “Samuel Beckett”, par Llewellyn Brown
avant-propos, par Llewellyn Brown
I. L'ASCÉTISME ET LE CORPS
1. Le Corps en suspens dans la “Trilogie” de Samuel Beckett, par Natália Laranjinha
2. Traité sur le mouvement ascétique chez Beckett et Kazantzakis : garder la pose, par Katerina Kanelli
3. Mutiler le corps pour abolir le désir : « Nonché la speme il desiderio », par Chiara Montini
II. LE DÉSIR PUR D'EN FINIR
4. Cap au pire et le désir d’en avoir fini, par Anthony Uhlmann
5. Beckett, en adaptant Godot : la peine ou pas, par Dirk Van Hulle
III. UN SUJET INEFFAÇABLE
6. Le Monologue de Samuel Beckett sur la mort : « Ne fut jamais d’autres questions », par Franz Kaltenbeck
7. Excavations poétiques dans l’écriture de Samuel Beckett, par Nadia Louar
8. Désir textuel et inscription du sujet chez Samuel Beckett (avec Deleuze et Lacan), par Isabelle Ost
9. Samuel Beckett : du désir au roc de l’existence, par Llewellyn Brown
V. Comptes rendus des parutions de l’année 2008
BRANIGAN, Kevin : Radio Beckett: Musicality in the Radio Plays of Samuel Beckett. (par M. Bousquet) – GROSSMAN, Évelyne : L’Angoisse de penser (par J. Siboni) – MÉVEL, Yann : L’Imaginaire mélancolique de Samuel Beckett, de « Murphy » à « Comment c’est » (par I. Ost) –
OST, Isabelle : Samuel Beckett et Gilles Deleuze: cartographie de deux parcours d’écriture (par J. Siboni) – POTHAST, Ulrich : The Metaphysical Vision: Arthur Schopenhauer’s Philosophy of Art and Life and Samuel Beckett’s Own Way to Make Use of It (par J. Campbell) – VAN HULLE, Dirk : Manuscript Genetics, Joyce’s Know-How, Beckett’s Nohow (par M. Bousquet).
Samuel Beckett 1 : “L’Ascèse du sujet”. Llewellyn Brown ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 202 p. 23 € ISBN 978-2-256-91162-0
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
avant-propos, par Llewellyn Brown
I. L'ASCÉTISME ET LE CORPS
1. Le Corps en suspens dans la “Trilogie” de Samuel Beckett, par Natália Laranjinha
2. Traité sur le mouvement ascétique chez Beckett et Kazantzakis : garder la pose, par Katerina Kanelli
3. Mutiler le corps pour abolir le désir : « Nonché la speme il desiderio », par Chiara Montini
II. LE DÉSIR PUR D'EN FINIR
4. Cap au pire et le désir d’en avoir fini, par Anthony Uhlmann
5. Beckett, en adaptant Godot : la peine ou pas, par Dirk Van Hulle
III. UN SUJET INEFFAÇABLE
6. Le Monologue de Samuel Beckett sur la mort : « Ne fut jamais d’autres questions », par Franz Kaltenbeck
7. Excavations poétiques dans l’écriture de Samuel Beckett, par Nadia Louar
8. Désir textuel et inscription du sujet chez Samuel Beckett (avec Deleuze et Lacan), par Isabelle Ost
9. Samuel Beckett : du désir au roc de l’existence, par Llewellyn Brown
V. Comptes rendus des parutions de l’année 2008
BRANIGAN, Kevin : Radio Beckett: Musicality in the Radio Plays of Samuel Beckett. (par M. Bousquet) – GROSSMAN, Évelyne : L’Angoisse de penser (par J. Siboni) – MÉVEL, Yann : L’Imaginaire mélancolique de Samuel Beckett, de « Murphy » à « Comment c’est » (par I. Ost) –
OST, Isabelle : Samuel Beckett et Gilles Deleuze: cartographie de deux parcours d’écriture (par J. Siboni) – POTHAST, Ulrich : The Metaphysical Vision: Arthur Schopenhauer’s Philosophy of Art and Life and Samuel Beckett’s Own Way to Make Use of It (par J. Campbell) – VAN HULLE, Dirk : Manuscript Genetics, Joyce’s Know-How, Beckett’s Nohow (par M. Bousquet).
Samuel Beckett 1 : “L’Ascèse du sujet”. Llewellyn Brown ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 202 p. 23 € ISBN 978-2-256-91162-0
RÉIMPRESSION
Commander en ligne ici.
Autres titres publiés sur Samuel Beckett
BROWN Llewellyn. Beckett, les fictions brèves : Voir et dire, Caen, Lettres Modernes Minard, Coll. « Bibliothèque des lettres modernes », 46, 2008 (réédition 2021). 235 p. ISBN 978-2-256-91139-2
BROWN, Llewellyn. Samuel Beckett et l'écriture des ruines, de “Mercier et Camier” à “Soubresauts”. Lettres Modernes Minard, Coll. « Archives des lettres modernes », 2020. 285 pages, ISBN 978-2-406-10594-7.
BRUNEL, Pierre (dir.). La Mort de Godot : attente et évanescence au théâtre (Albee, Beckett, Betti, Duras, Hazaz, Lorca, Tchékhov. Paris, Lettres modernes, Coll. « Situation ; 23 », 1970.
COLIN, Marjorie et Yannick HOFFERT (dir.). Culture Godot : “En attendant Godot” de Samuel Beckett et ses inscriptions culturelles. Lettres Modernes Minard, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2022.
FITCH, Brian T. Dimensions, structures et textualité dans la trilogie romanesque de Beckett, Paris, Lettres Modernes Minard, Coll. « Situation » 37, 1977. 208 p. ISBN 2-256-90778-3
GAVARD-PERRET, Jean-Paul. L’Imaginaire paradoxal ou la création absolue dans les œuvres dernières de Samuel Beckett, Paris-Caen, Lettres Modernes Minard, Coll. « Bibliothèque Circé » 3, 2001. 258 p. ISBN 978-2-256-91021-1
GERMONI, Karine, Pascale SARDIN et Llewellyn BROWN (dir.). Le Style de Samuel Beckett au miroir épistolaire, 1929-1989, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2022.
GESVRET, Guillaume. Beckett en échos : rapprochements arts et littérature, Coll. « Bibliothèque des Lettres modernes ; Critique », 2018.
LOUAR, Nadia. Figure(s) du bilinguisme beckettien, Coll. « Archives des Lettres modernes », 2018.
MÉVEL, Yann (dir.). Samuel Beckett et la culture française, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2019.
RICHARD, Charlotte. Poétique du second théâtre beckettien, Coll. « Bibliothèque des Lettres modernes ; Critique », 2021.
BROWN, Llewellyn. Samuel Beckett et l'écriture des ruines, de “Mercier et Camier” à “Soubresauts”. Lettres Modernes Minard, Coll. « Archives des lettres modernes », 2020. 285 pages, ISBN 978-2-406-10594-7.
BRUNEL, Pierre (dir.). La Mort de Godot : attente et évanescence au théâtre (Albee, Beckett, Betti, Duras, Hazaz, Lorca, Tchékhov. Paris, Lettres modernes, Coll. « Situation ; 23 », 1970.
COLIN, Marjorie et Yannick HOFFERT (dir.). Culture Godot : “En attendant Godot” de Samuel Beckett et ses inscriptions culturelles. Lettres Modernes Minard, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2022.
FITCH, Brian T. Dimensions, structures et textualité dans la trilogie romanesque de Beckett, Paris, Lettres Modernes Minard, Coll. « Situation » 37, 1977. 208 p. ISBN 2-256-90778-3
GAVARD-PERRET, Jean-Paul. L’Imaginaire paradoxal ou la création absolue dans les œuvres dernières de Samuel Beckett, Paris-Caen, Lettres Modernes Minard, Coll. « Bibliothèque Circé » 3, 2001. 258 p. ISBN 978-2-256-91021-1
GERMONI, Karine, Pascale SARDIN et Llewellyn BROWN (dir.). Le Style de Samuel Beckett au miroir épistolaire, 1929-1989, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2022.
GESVRET, Guillaume. Beckett en échos : rapprochements arts et littérature, Coll. « Bibliothèque des Lettres modernes ; Critique », 2018.
LOUAR, Nadia. Figure(s) du bilinguisme beckettien, Coll. « Archives des Lettres modernes », 2018.
MÉVEL, Yann (dir.). Samuel Beckett et la culture française, Coll. « Carrefour des Lettres modernes », 2019.
RICHARD, Charlotte. Poétique du second théâtre beckettien, Coll. « Bibliothèque des Lettres modernes ; Critique », 2021.
Voir aussi
BARKO, Ivan et BURGESS, Bruce, La Dynamique des points de vue dans le texte de théâtre : analyses de points de vue (“Le Misanthrope”, “Le Mariage de Figaro”, “Lorenzaccio”, “En attendant Godot”). Lettres Modernes Minard, Coll. « Archives des Lettres modernes », n° 231, 1988.
BLANCKEMAN, Bruno, « Les Filiations ruinées du théâtre de Samuel Beckett ou “l’Oncle incarné” », p. 225-240 in Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines? 1”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 286 p. 28 € ISBN 978-2-256-91138-5.
BRUNEL, Pierre (dir.), La Mort de Godot – attente et évanescence au théâtre — Albee, Beckett, Betti, Duras, Hazaz, Lorca, Tchekhov. « Situations » n° 23, 1970.
CHAUDIER, Stéphane, « L’Innommable de Samuel Beckett, ou les ruines sont une fête », p. 69-90 in Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines? 1”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 286 p. 28 € ISBN 978-2-256-91138-5.
COTTONET-HAGE, Madeleine, « Beckett dans le miroir proustien », p. 139-150 in Marcel Proust 8 : “Lecteurs de Proust au XXe siècle et au début du XXIe. 1”. Joseph Brami ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 260. p. 23 €. ISBN 978-2-256-91155-2
MÉVEL, Yann, « Mille et une nuits. Poétique de la nuit chez Samuel Beckett » , in Le « Nouveau Roman » en questions 7 : “Vers une ruine de l’écriture?”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm.
PARISSE, Lydie. La “parole trouée” — Beckett, Tardieu, Novarina. Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « Archives des lettres modernes » 292. Un volume broché, rogné 19 cm. 160 p. 17 € ISBN 978-2-256-90488-2
BLANCKEMAN, Bruno, « Les Filiations ruinées du théâtre de Samuel Beckett ou “l’Oncle incarné” », p. 225-240 in Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines? 1”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 286 p. 28 € ISBN 978-2-256-91138-5.
BRUNEL, Pierre (dir.), La Mort de Godot – attente et évanescence au théâtre — Albee, Beckett, Betti, Duras, Hazaz, Lorca, Tchekhov. « Situations » n° 23, 1970.
CHAUDIER, Stéphane, « L’Innommable de Samuel Beckett, ou les ruines sont une fête », p. 69-90 in Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines? 1”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 286 p. 28 € ISBN 978-2-256-91138-5.
COTTONET-HAGE, Madeleine, « Beckett dans le miroir proustien », p. 139-150 in Marcel Proust 8 : “Lecteurs de Proust au XXe siècle et au début du XXIe. 1”. Joseph Brami ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 260. p. 23 €. ISBN 978-2-256-91155-2
MÉVEL, Yann, « Mille et une nuits. Poétique de la nuit chez Samuel Beckett » , in Le « Nouveau Roman » en questions 7 : “Vers une ruine de l’écriture?”. Johan Faerber ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm.
PARISSE, Lydie. La “parole trouée” — Beckett, Tardieu, Novarina. Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « Archives des lettres modernes » 292. Un volume broché, rogné 19 cm. 160 p. 17 € ISBN 978-2-256-90488-2
Série fondée et dirigée par Llewellyn BROWN (2010)
dans La Revue des Lettres modernes
dans La Revue des Lettres modernes