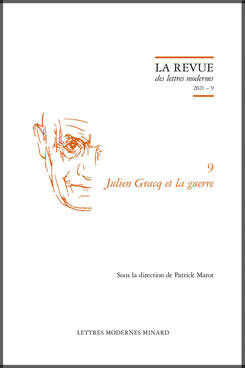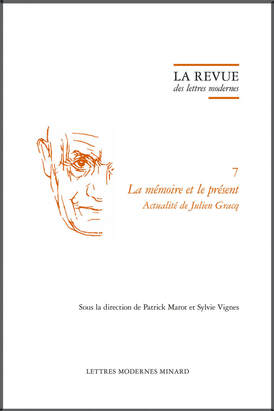Série Julien Gracq
Dir. P. Marot (1991)
L’opportunité de présenter au public une série de recueils critiques consacrés à Julien Gracq semble aujourd’hui indiscutable. La récente publication du premier volume « Gracq » dans la « Bibliothèque de la Pléiade » a été l’occasion d’une célébration dont le retentissement, près de quarante ans après le refus du prix Goncourt, a ouvert à nouveau à un large public une œuvre qui revendiquait surtout l’audience des happy few. Ce virage était en fait prévisible, à en juger par le nombre et le volume croissant des textes critiques consacrés à cet auteur depuis les années Soixante-dix : la comparaison entre les deux bibliographies établies par Peter Hoy à quelque vingt ans d’intervalle est à cet égard éclairante. La faveur dont jouit l’écrivain auprès du public a donc suivi, comme il advient d’ordinaire, l’intérêt croissant porté par les universitaires.
Cette faveur n’est cependant pas exempte d’ambiguïté, comme permet de le constater un regard circulaire sur les articles de presse et les « témoignages » qui se sont multipliés en 1989 : la célébration a parfois tourné à la consécration, avec tous les risques de figement, d’admiration guindée, lointaine ou naïvement enthousiaste que cela peut entraîner. Gracq ne se verrait-il pas mis malgré lui dans la situation qu’il évoquait au début de son André Breton comme « une tentation congénitale de l’artiste » : ce « moment assez dramatique [de sa carrière] où s’invite d’elle-même à souper au coin du feu une statue qui n’est autre que la sienne, dont la poignée de main pétrifie »… ?
Or, c’est précisément là qu’une Série suivie, destinée à explorer son œuvre, prend sa signification la plus authentique. Il ne s’agit pas d’ajouter une pierre supplémentaire au monument — statue, musée ou mausolée ? — mais de proposer ce que l’on pourrait appeler une « pratique vivante » de Julien Gracq. La forme de la Série, qui constitue une formule nouvelle dans l’étude de cet auteur, permettra de compléter de façon à la fois plus souple et plus systématique l’apport précieux des recueils critiques déjà parus sur ce sujet — citons en particulier le numéro spécial de la revue Marginales (Bruxelles 1970), le « Cahier de L’Herne » publié en 1972 sous la direction de Jean-Louis Leutrat et les Actes du colloque international d’Angers tenu en 1981, en attendant ceux du colloque organisé à Cerisy en août 1991. Ainsi pourra être comblé le fossé — retard ou décalage — qui se creuse entre un public cultivé mais n’ayant pas le loisir de se tenir informé de travaux souvent destinés à un public restreint de spécialistes, et une critique dont le progrès et l’élargissement peut se lire rétrospectivement à l’occasion de ces recueils isolés. Une Série sera en cela à même de rendre compte sur un mode plus synthétique et plus largement ouvert d’une recherche devenue dense et foisonnante, désireuse de dépasser les enquêtes thématiques auxquelles on a trop longtemps entendu restreindre l’analyse. Au-delà de cette indispensable fonction « vulgarisatrice », la présente entreprise a évidemment à cœur — et en cela serait atteint l’un de ses objectifs les plus légitimes — d’accomplir de nouvelles avancées critiques qui puissent témoigner de la pleine actualité de Julien Gracq.
On doit à l’honnêteté de préciser que le principe de cette Série n’a pas l’aval de l’écrivain, peu soucieux de donner prise à la sollicitude universitaire et médiatique dont il fait particulièrement l’objet ces dernières années. La critique gracquienne se trouve de fait, et depuis longtemps, dans une situation assez difficile : l’écrivain, dans ses essais, a souvent évoqué la critique littéraire en termes peu amènes, l’accusant de se livrer à « une tâche de vivisection peu ragoûtante », ou encore (plus classiquement) de dessécher son objet et d’en manquer par là même la substance. De ces reproches il est difficile de faire purement et simplement fi, et cela d’autant plus que l’auteur — quelles que soient sa discrétion et sa délicatesse — pèse du poids de l’auctor, autorité et garant. Il n’est évidemment pas question pour autant de se laisser paralyser par cette sévérité ni de se soumettre aveuglément aux indications qu’il propose quant à ce que devrait être la critique — si salutaires et même fécondes soient-elles (elles le sont souvent). S’il est une souscription qui soit impérieuse à cet égard, c’est dans la méfiance envers tout systématisme et toute appartenance d’école : « Que dire à ces gens qui, croyant posséder une clef, n’ont de cesse qu’ils aient disposé votre œuvre en forme de serrure? » Sans doute convient-il à tout le moins de ne pas oublier cette moquerie légitime et souvent citée de l’auteur de Lettrines; il ne serait pourtant pas moins pernicieux de rester à l’écart des avancées théoriques et méthodologiques de ces dernières années, avancées dont les audaces — largement assimilées aujourd’hui il est vrai — ont précisément trouvé en Gracq un juge redoutablement éclairé, sceptique et volontiers acide : l’analyse des textes ne peut en effet éviter de devenir une parole du ressassement que si elle s’inscrit à la fois comme proximité et comme écart au regard de leurs signes et de leurs implicites — «infidèle fidélité » dont on sait depuis Hölderlin qu’elle est la condition même d’une vivante relation.
Patrick MAROT
Cette faveur n’est cependant pas exempte d’ambiguïté, comme permet de le constater un regard circulaire sur les articles de presse et les « témoignages » qui se sont multipliés en 1989 : la célébration a parfois tourné à la consécration, avec tous les risques de figement, d’admiration guindée, lointaine ou naïvement enthousiaste que cela peut entraîner. Gracq ne se verrait-il pas mis malgré lui dans la situation qu’il évoquait au début de son André Breton comme « une tentation congénitale de l’artiste » : ce « moment assez dramatique [de sa carrière] où s’invite d’elle-même à souper au coin du feu une statue qui n’est autre que la sienne, dont la poignée de main pétrifie »… ?
Or, c’est précisément là qu’une Série suivie, destinée à explorer son œuvre, prend sa signification la plus authentique. Il ne s’agit pas d’ajouter une pierre supplémentaire au monument — statue, musée ou mausolée ? — mais de proposer ce que l’on pourrait appeler une « pratique vivante » de Julien Gracq. La forme de la Série, qui constitue une formule nouvelle dans l’étude de cet auteur, permettra de compléter de façon à la fois plus souple et plus systématique l’apport précieux des recueils critiques déjà parus sur ce sujet — citons en particulier le numéro spécial de la revue Marginales (Bruxelles 1970), le « Cahier de L’Herne » publié en 1972 sous la direction de Jean-Louis Leutrat et les Actes du colloque international d’Angers tenu en 1981, en attendant ceux du colloque organisé à Cerisy en août 1991. Ainsi pourra être comblé le fossé — retard ou décalage — qui se creuse entre un public cultivé mais n’ayant pas le loisir de se tenir informé de travaux souvent destinés à un public restreint de spécialistes, et une critique dont le progrès et l’élargissement peut se lire rétrospectivement à l’occasion de ces recueils isolés. Une Série sera en cela à même de rendre compte sur un mode plus synthétique et plus largement ouvert d’une recherche devenue dense et foisonnante, désireuse de dépasser les enquêtes thématiques auxquelles on a trop longtemps entendu restreindre l’analyse. Au-delà de cette indispensable fonction « vulgarisatrice », la présente entreprise a évidemment à cœur — et en cela serait atteint l’un de ses objectifs les plus légitimes — d’accomplir de nouvelles avancées critiques qui puissent témoigner de la pleine actualité de Julien Gracq.
On doit à l’honnêteté de préciser que le principe de cette Série n’a pas l’aval de l’écrivain, peu soucieux de donner prise à la sollicitude universitaire et médiatique dont il fait particulièrement l’objet ces dernières années. La critique gracquienne se trouve de fait, et depuis longtemps, dans une situation assez difficile : l’écrivain, dans ses essais, a souvent évoqué la critique littéraire en termes peu amènes, l’accusant de se livrer à « une tâche de vivisection peu ragoûtante », ou encore (plus classiquement) de dessécher son objet et d’en manquer par là même la substance. De ces reproches il est difficile de faire purement et simplement fi, et cela d’autant plus que l’auteur — quelles que soient sa discrétion et sa délicatesse — pèse du poids de l’auctor, autorité et garant. Il n’est évidemment pas question pour autant de se laisser paralyser par cette sévérité ni de se soumettre aveuglément aux indications qu’il propose quant à ce que devrait être la critique — si salutaires et même fécondes soient-elles (elles le sont souvent). S’il est une souscription qui soit impérieuse à cet égard, c’est dans la méfiance envers tout systématisme et toute appartenance d’école : « Que dire à ces gens qui, croyant posséder une clef, n’ont de cesse qu’ils aient disposé votre œuvre en forme de serrure? » Sans doute convient-il à tout le moins de ne pas oublier cette moquerie légitime et souvent citée de l’auteur de Lettrines; il ne serait pourtant pas moins pernicieux de rester à l’écart des avancées théoriques et méthodologiques de ces dernières années, avancées dont les audaces — largement assimilées aujourd’hui il est vrai — ont précisément trouvé en Gracq un juge redoutablement éclairé, sceptique et volontiers acide : l’analyse des textes ne peut en effet éviter de devenir une parole du ressassement que si elle s’inscrit à la fois comme proximité et comme écart au regard de leurs signes et de leurs implicites — «infidèle fidélité » dont on sait depuis Hölderlin qu’elle est la condition même d’une vivante relation.
Patrick MAROT
Julien Gracq 9 : “Julien Gracq et la guerre”
|
Avant-propos / Foreword, par Patrick MAROT
I. LA DRÔLE DE GUERRE DE LOUIS POIRIER : UN ENGAGEMENT À DISTANCE / LOUIS POIRIER’S PHONY WAR: A REMOTE COMMITMENT 1. Louis Poirier, citoyen-soldat, matricule 1459/1930 (Cholet) / Louis Poirier, citizen-soldier, service number 1459/1930 (Cholet), par Jean-Louis TISSIER 2. De l’ordre militaire à l’ordre littéraire. Sur la dissolution d’un lien constitutif dans Souvenirs de guerre et Récit / From Military Order to Literary Order : On the Dissolution of a Constitutive Link in Souvenirs de guerre and Récit, par Dominique PERRIN 3. Gracq sur fond de guerre / Gracq Against the Background of War, par Michel MURAT 4. Faire corps / Forming a single body, par Philippe BERTHIER 5. Julien Gracq et Claude Simon : deux écrivains dans la débâcle / Julien Gracq and Claude Simon : Two Writers in the Debacle, par Jean-Yves LAURICHESSE |
II. GUERRES RÉELLES, GUERRES FICTIVES / REAL WARS, FICTIONAL WARS
6. Des Manuscrits de guerre aux Terres du couchant : du soldat au guerrier / From Manuscrits de guerre to Les Terres du couchant, From Soldier to Warrior, par Patrick MAROT
7. Guerres-fantômes dans Les Terres du couchant / Ghost Wars in Les Terres du couchant, par Bruno TRITSMANS
8. Le « désarmement » de Gracq (1940-1950) / Gracq’s “Désarmement” (1940–1950), par Atsuko NAGAÏ
9. L’étrange guerre de Julien Gracq / Julien Gracq’s Strange War, par par Hervé MENOU
10. « Dans les affreux wagons de la guerre » : Hauptmotiv ou variation dans Le Rivage des Syrtes, Un Balcon en forêt et La Presquîle ? /
“Dans les affreux wagons de la guerre” : Hauptmotiv or variation in Le Rivage des Syrtes, Un Balcon en forêt, and La Presqu’île ?, par Isabelle Rachel CASTA
III. POÉTIQUES ET MÉTAPHORES DE LA GUERRE / POETICS AND METAPHORS OF WAR
11. « Subsister au cœur du noir » : le sublime de la guerre du Rivage des Syrtes aux Terres du couchant / “Subsister au cœur du noir” : The Sublime of War from Le Rivage des Syrtes to Les Terres du couchant, par par Félicien MAFFRE-MAVIEL
12. Julien Gracq, paysages de guerre, paysages en guerre /Julien Gracq, landscapes of war, landscapes at war, par Yvon LE SCANFF
13. À la guerre comme à la chasse / In war as in hunting, par Denis LABOURET
14. Rafraîchissante apocalypse : une scène guerrière des Terres du couchant comme condensé de réminiscences et d’essence gracquienne /
Refreshing apocalypse : A Martial Scene from Les Terres du couchant as Condensation of Reminiscence and Gracquian Essence, par Sylvie VIGNES
15. Entre film de guerre et film « littéraire » : Un Balcon en forêt de Michel Mitrani /
Between war film and “Littéraire” Film : Michel Mitrani’s Un Balcon en forêt, par Michel VIEGNES
IV. TÉMOIGNAGES / TESTIMONIES
16. La guerre toujours recommencée / Forever War Starting Again, par Jacques BOISLÈVE
17. L’anneau de Béatrix /Béatrix’s Ring, par Dominique RABOURDIN
ANNEXES / APPENDICES
18. Publications originales de Julien Gracq : bibliographie chronologique (1934-2020), second complément / Julien Gracq’s Original Publications : Chronological bibliography (1934–2020), second supplement
19. Productions sonores et cinématographiques : Inventaire chronologique (1959-2016)
Audio and Film Productions : Chronological inventory (1959–2016), par Patrice ROQUEFEUIL
Commander en ligne ici.
6. Des Manuscrits de guerre aux Terres du couchant : du soldat au guerrier / From Manuscrits de guerre to Les Terres du couchant, From Soldier to Warrior, par Patrick MAROT
7. Guerres-fantômes dans Les Terres du couchant / Ghost Wars in Les Terres du couchant, par Bruno TRITSMANS
8. Le « désarmement » de Gracq (1940-1950) / Gracq’s “Désarmement” (1940–1950), par Atsuko NAGAÏ
9. L’étrange guerre de Julien Gracq / Julien Gracq’s Strange War, par par Hervé MENOU
10. « Dans les affreux wagons de la guerre » : Hauptmotiv ou variation dans Le Rivage des Syrtes, Un Balcon en forêt et La Presquîle ? /
“Dans les affreux wagons de la guerre” : Hauptmotiv or variation in Le Rivage des Syrtes, Un Balcon en forêt, and La Presqu’île ?, par Isabelle Rachel CASTA
III. POÉTIQUES ET MÉTAPHORES DE LA GUERRE / POETICS AND METAPHORS OF WAR
11. « Subsister au cœur du noir » : le sublime de la guerre du Rivage des Syrtes aux Terres du couchant / “Subsister au cœur du noir” : The Sublime of War from Le Rivage des Syrtes to Les Terres du couchant, par par Félicien MAFFRE-MAVIEL
12. Julien Gracq, paysages de guerre, paysages en guerre /Julien Gracq, landscapes of war, landscapes at war, par Yvon LE SCANFF
13. À la guerre comme à la chasse / In war as in hunting, par Denis LABOURET
14. Rafraîchissante apocalypse : une scène guerrière des Terres du couchant comme condensé de réminiscences et d’essence gracquienne /
Refreshing apocalypse : A Martial Scene from Les Terres du couchant as Condensation of Reminiscence and Gracquian Essence, par Sylvie VIGNES
15. Entre film de guerre et film « littéraire » : Un Balcon en forêt de Michel Mitrani /
Between war film and “Littéraire” Film : Michel Mitrani’s Un Balcon en forêt, par Michel VIEGNES
IV. TÉMOIGNAGES / TESTIMONIES
16. La guerre toujours recommencée / Forever War Starting Again, par Jacques BOISLÈVE
17. L’anneau de Béatrix /Béatrix’s Ring, par Dominique RABOURDIN
ANNEXES / APPENDICES
18. Publications originales de Julien Gracq : bibliographie chronologique (1934-2020), second complément / Julien Gracq’s Original Publications : Chronological bibliography (1934–2020), second supplement
19. Productions sonores et cinématographiques : Inventaire chronologique (1959-2016)
Audio and Film Productions : Chronological inventory (1959–2016), par Patrice ROQUEFEUIL
Commander en ligne ici.
Julien Gracq 8 : “Julien Gracq et le sacré”

Peu abordée par la critique car bridée par les déclarations d’agnosticisme de l’écrivain, la question du sacré est pourtant centrale dans l’œuvre de Julien Gracq, tant par les très nombreuses références qui la nourrissent que par la caractérisation, ici contextualisée, des enjeux qu’elle confère à la littérature. Les études présentées abordent les différents aspects du sacré gracquien, qu’il s’agisse de son rapport ambigu, mais crucial, à la religion (chrétienne en particulier) et à l’expérience mystique, de sa dimension nietzschéenne et dionysiaque, ou des manifestations esthétiques qui lui sont afférentes. Une étude de la correspondance de Gracq avec Jules Monnerot, un inédit de l’écrivain et un dossier bibliographique, complètent cet ensemble.
SOMMAIRE
1. « Ni avec toi, ni sans toi » : les enjeux de la question du sacré dans l’œuvre de Gracq,
par Patrick MAROT
2. Julien Gracq, le catholicisme et le sacré, par Denis LABOURET
3. Histoire sainte, histoire enceinte, par Philippe BERTHIER
4. « Il y a une divinité en toi » : figures et manifestations de l’inspiration chez Julien Gracq, par Dominique PERRIN
5. Le sacre du courant. Julien Gracq, « acte esthétique » et perception esthétique, par Sylvie VIGNES
6. « Lui-même à lui-même demeure inconnu » : les puissances du mal dans le sacré gracquien, par Isabelle CASTA
7. Sacré dionysiaque et sacré du monde : Gracq et Mandiargues en miroir, par Bruno TRITSMANS
ÉTUDE
8. La correspondance Julien Gracq – Jules Monnerot, par Atsuko NAGAI
INÉDIT
9. « Ouvrez-vous ? » (réponses en face à face de Julien Gracq à un questionnaire), par Dominique RABOURDIN
ANNEXE
Publications originales de Julien Gracq (1934-2015), par Patrice ROQUEFEUIL
Commander en ligne ici
SOMMAIRE
1. « Ni avec toi, ni sans toi » : les enjeux de la question du sacré dans l’œuvre de Gracq,
par Patrick MAROT
2. Julien Gracq, le catholicisme et le sacré, par Denis LABOURET
3. Histoire sainte, histoire enceinte, par Philippe BERTHIER
4. « Il y a une divinité en toi » : figures et manifestations de l’inspiration chez Julien Gracq, par Dominique PERRIN
5. Le sacre du courant. Julien Gracq, « acte esthétique » et perception esthétique, par Sylvie VIGNES
6. « Lui-même à lui-même demeure inconnu » : les puissances du mal dans le sacré gracquien, par Isabelle CASTA
7. Sacré dionysiaque et sacré du monde : Gracq et Mandiargues en miroir, par Bruno TRITSMANS
ÉTUDE
8. La correspondance Julien Gracq – Jules Monnerot, par Atsuko NAGAI
INÉDIT
9. « Ouvrez-vous ? » (réponses en face à face de Julien Gracq à un questionnaire), par Dominique RABOURDIN
ANNEXE
Publications originales de Julien Gracq (1934-2015), par Patrice ROQUEFEUIL
Commander en ligne ici
Julien Gracq 7 : “la mémoire et le présent --
actualité de Julien Gracq”
|
espaces de l’actualisation, figures de l’actualité, par Patrick MAROT et Sylvie VIGNES I. UNE ÉCRITURE « BLASONNÉE » 1. Passé-présent, par Patrick MAROT. 2. La Mémoire comme « pas japonais », par Sylvie VIGNES. 3. Avatars de l’«enceinte fermée» — tensions de la fiction gracquienne, par Cédric CHAUVIN 4. La Forme d’une ville : contrainte et liberté, par Élisabeth CARDONNE-ARLYCK 5. Ville-emblème/ville-archive. Sur La Forme d’une ville et Autour des sept collines, par Jean-Yves LAURICHESSE 6. La « fougère-aigle » : paysage et merveille dans Un Balcon dans la forêt, par Agnès CASTIGLIONE |
II. LIEUX ET DÉTOURS DE LA MÉMOIRE
7. Au fond de la mémoire : les ruines, par André-Alain MORELLO.
8. Sommeil en Flandre et en Ardenne : précipités de la mémoire de mai-juin 1940, par Béatrice DAMAMME-GILBERT.
9. Simon et le souvenir d’enfance : une nostalgie gracquienne, par Guillaume PAJON
10. L’Objet de l’écriture dans Un Balcon en forêt et « La Presqu’île », par Llewellyn BROWN.
11. Et in Roma ego, par Philippe BERTHIER
12. Gracq et le sport, par Denis LABOURET.
III. LE GRAND CHEMIN
13. La Matière «histoire-géographie», par Jean-Yves DEBREUILLE
14. Territorialités gracquiennes, par Carol J. MURPHY.
15. Échanges, circulation, flux, origine, par Hervé MENOU.
16. Fuites et détestations dans Lettrines et Lettrines 2, le “cœur glacial du midi”, par Isabelle CASTA
17. L’Aventure chez Julien Gracq, par Marianne LORENZI.
IV. LA PRÉSENCE ET LA TRACE
18. L’Individuel et le collectif dans «Lautréamont toujours», par Atsuko NAGAÏ
19. La Poïétique de Julien Gracq — épistémologie de la création romanesque et «modernité» de l’écrivain, par Dominique PERRIN.
20. L’Orient, de Jünger à Gracq — savoir magique et géopolitique, par Bruno TRITSMANS.
21. Gracq et Jünger : convergences, par Roland BOURNEUF.
22. La Réception de Julien Gracq dans le monde de langue allemande, par Edgar SALLAGER.
TÉMOIGNAGES
23. “Ricochets de conversation”, par Jacques BOISLÈVE.
24. Le Testament de Julien Gracq, par Dominique RABOURDIN
ANNEXE : Fonds Julien Gracq, par Georges CESBRON.
Julien Gracq 7 : “La Mémoire et le présent — actualité de Julien Gracq” (Colloque international. 28–30 janvier 2010, Université de Toulouse 2-Le Mirail). Patrick Marot et Sylvie Vignes eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 394 p. 32 €ISBN 978-2-256-91153-8
Commander en ligne ici.
7. Au fond de la mémoire : les ruines, par André-Alain MORELLO.
8. Sommeil en Flandre et en Ardenne : précipités de la mémoire de mai-juin 1940, par Béatrice DAMAMME-GILBERT.
9. Simon et le souvenir d’enfance : une nostalgie gracquienne, par Guillaume PAJON
10. L’Objet de l’écriture dans Un Balcon en forêt et « La Presqu’île », par Llewellyn BROWN.
11. Et in Roma ego, par Philippe BERTHIER
12. Gracq et le sport, par Denis LABOURET.
III. LE GRAND CHEMIN
13. La Matière «histoire-géographie», par Jean-Yves DEBREUILLE
14. Territorialités gracquiennes, par Carol J. MURPHY.
15. Échanges, circulation, flux, origine, par Hervé MENOU.
16. Fuites et détestations dans Lettrines et Lettrines 2, le “cœur glacial du midi”, par Isabelle CASTA
17. L’Aventure chez Julien Gracq, par Marianne LORENZI.
IV. LA PRÉSENCE ET LA TRACE
18. L’Individuel et le collectif dans «Lautréamont toujours», par Atsuko NAGAÏ
19. La Poïétique de Julien Gracq — épistémologie de la création romanesque et «modernité» de l’écrivain, par Dominique PERRIN.
20. L’Orient, de Jünger à Gracq — savoir magique et géopolitique, par Bruno TRITSMANS.
21. Gracq et Jünger : convergences, par Roland BOURNEUF.
22. La Réception de Julien Gracq dans le monde de langue allemande, par Edgar SALLAGER.
TÉMOIGNAGES
23. “Ricochets de conversation”, par Jacques BOISLÈVE.
24. Le Testament de Julien Gracq, par Dominique RABOURDIN
ANNEXE : Fonds Julien Gracq, par Georges CESBRON.
Julien Gracq 7 : “La Mémoire et le présent — actualité de Julien Gracq” (Colloque international. 28–30 janvier 2010, Université de Toulouse 2-Le Mirail). Patrick Marot et Sylvie Vignes eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 394 p. 32 €ISBN 978-2-256-91153-8
Commander en ligne ici.
Julien Gracq 6 :
“les tensions de l’écriture — adieu au romanesque, persistance de la fiction”
flottements d’état civil, par Patrick Marot
1. Romans et fragments paysagers : de quelques modulations de l’«enceinte fermée», par Michèle MONBALLIN
2. Sinuosité, tensions et accidents de parcours dans les chemins de Lettrines, par Béatrice DAMAMME-GILBERT.
3. Des “géographies imaginaires” à la “mythologie routière” dans l’écriture de Julien Gracq : écarts et échos, par Sylvie VIGNES-MOTTET
4. Cartographies et broderies — parcours croisés (Malaurie–Gracq–Mialon), par Bruno TRITSMANS
5. Statuts et fonctions de la référence épique chez Julien Gracq, par Cédric CHAUVIN.
6. Julien Gracq off limits, par Adrien GÜR
7. “Fines transcendam” de la transgression à la frontière dans l’œuvre de Gracq, par Patrick MAROT.
8. Julien Gracq et sa contribution aux périodiques, par Atsuko NAGAÏ
Julien Gracq 6 : “Les Tensions de l’écriture — adieu au romanesque, persistance de la fiction”. Patrick Marot ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 268 p. 24 € ISBN 978-2-256-91131-6
Julien Gracq 5 : “Les Dernières fictions Un Balcon en forêt, La Presqu’île”
après le roman, par Patrick MAROT
1. L’Envers de la littérature contemporaine, par Michel MURAT.
2. Tension narrative et réversibilité dans Un Balcon en forêt et La Presqu’île, par Patrick MAROT.
3. Un Balcon en forêt, quelques aspects des décrochages du réel, par Michèle MONBALLIN.
4. La Désertion par les mots — l’impossible référence et la réception parodique du vocabulaire de la guerre dans Un Balcon en forêt,
par Jérôme CABOT.
5. L’entre-deux dans Un Balcon en forêt, par Béatrice DAMAMME-GILBERT.
6. Un Balcon en forêt, une brèche vers l’enfance ?, par Sylvie VIGNES.
7. Regards sur l’horizon — distances lointaines — Un Balcon en forêt, «La Presqu’île», par Hervé MENOU.
8. Retour vers le futur ou le routard élémentaire — « La Route », par Philippe BERTHIER.
9. Le Vagabondage automobile dans « La Presqu’île », par Jean-Yves LAURICHESSE.
10. Météores gracquiens dans La Presqu’île, par Bruno TRITSMANS.
11. La Presqu’île et la répétition, par Élisabeth CARDONNE-ARLYCK.
12. Jeux de références croisées dans « Le Roi Cophetua », par Anne-Yvonne JULIEN.
13. Profil perdu — perte et consentement dans « Le Roi Cophetua» , par Dominique RABATÉ.
Julien Gracq 5 : “Les Dernières fictions Un Balcon en forêt, La Presqu’île. 2007. 258 p. 16 €. ISBN 978-2-256-91122-4
1. L’Envers de la littérature contemporaine, par Michel MURAT.
2. Tension narrative et réversibilité dans Un Balcon en forêt et La Presqu’île, par Patrick MAROT.
3. Un Balcon en forêt, quelques aspects des décrochages du réel, par Michèle MONBALLIN.
4. La Désertion par les mots — l’impossible référence et la réception parodique du vocabulaire de la guerre dans Un Balcon en forêt,
par Jérôme CABOT.
5. L’entre-deux dans Un Balcon en forêt, par Béatrice DAMAMME-GILBERT.
6. Un Balcon en forêt, une brèche vers l’enfance ?, par Sylvie VIGNES.
7. Regards sur l’horizon — distances lointaines — Un Balcon en forêt, «La Presqu’île», par Hervé MENOU.
8. Retour vers le futur ou le routard élémentaire — « La Route », par Philippe BERTHIER.
9. Le Vagabondage automobile dans « La Presqu’île », par Jean-Yves LAURICHESSE.
10. Météores gracquiens dans La Presqu’île, par Bruno TRITSMANS.
11. La Presqu’île et la répétition, par Élisabeth CARDONNE-ARLYCK.
12. Jeux de références croisées dans « Le Roi Cophetua », par Anne-Yvonne JULIEN.
13. Profil perdu — perte et consentement dans « Le Roi Cophetua» , par Dominique RABATÉ.
Julien Gracq 5 : “Les Dernières fictions Un Balcon en forêt, La Presqu’île. 2007. 258 p. 16 €. ISBN 978-2-256-91122-4
Julien Gracq 4 : “Références et présences littéraires”
un “répertoire de femmes fatales”…, par Patrick MAROT
1. «L’Épais terreau de la littérature» : sur la poétique et l’esthétique des références littéraires dans les fictions romanesques,
par Patrick MAROT.
2. Plaisir, circulation et appropriation : de Gracq lecteur au lecteur de Gracq, par Béatrice DAMAMME- GILBERT.
3. «De l’âme appliquée sur de l’âme — et tirant » : présence de Rimbaud dans l’œuvre non romanesque de Gracq, par Sylvie VIGNES.
4. Reflets d’André Breton dans l’œil de Julien Gracq, par Juliette CERF.
5. Julien Gracq et Jules Monnerot, par Atsuko NAGAI.
6. Au château d’Argol et le bricolage intertextuel : Hegel, la Bible, Faust et le Graal, par Jérôme CABOT.
7. Énigme et intertextualité dans Un Beau ténébreux, par Aurélien HUPÉ.
8. «Trente gorges» : Le Rivage des Syrtes à l’épreuve de l’hypothèse mystique, par Jean SAROCCHI.
9. Palimpsestes mythiques dans Liberté grande, par Bruno TRITSMANS.
10. Vacances romaines, par Michel MURAT.
Julien Gracq 4 : “Références et présences littéraires”. 2004. 282 p. 23 €. ISBN 978-2-256-91073-9
1. «L’Épais terreau de la littérature» : sur la poétique et l’esthétique des références littéraires dans les fictions romanesques,
par Patrick MAROT.
2. Plaisir, circulation et appropriation : de Gracq lecteur au lecteur de Gracq, par Béatrice DAMAMME- GILBERT.
3. «De l’âme appliquée sur de l’âme — et tirant » : présence de Rimbaud dans l’œuvre non romanesque de Gracq, par Sylvie VIGNES.
4. Reflets d’André Breton dans l’œil de Julien Gracq, par Juliette CERF.
5. Julien Gracq et Jules Monnerot, par Atsuko NAGAI.
6. Au château d’Argol et le bricolage intertextuel : Hegel, la Bible, Faust et le Graal, par Jérôme CABOT.
7. Énigme et intertextualité dans Un Beau ténébreux, par Aurélien HUPÉ.
8. «Trente gorges» : Le Rivage des Syrtes à l’épreuve de l’hypothèse mystique, par Jean SAROCCHI.
9. Palimpsestes mythiques dans Liberté grande, par Bruno TRITSMANS.
10. Vacances romaines, par Michel MURAT.
Julien Gracq 4 : “Références et présences littéraires”. 2004. 282 p. 23 €. ISBN 978-2-256-91073-9
Julien Gracq 3 : “Temps, Histoire, souvenir”
quelques paradoxes du temps gracquien. par Patrick MAROT
TEMPS, HISTOIRE, SOUVENIR :
1. Mémoire, survivance et mouvance dans les récits de Gracq, par Kim JI-YOUNG.
2. Desseins et déclin du temps dans les trois premiers romans de Gracq, par Isabelle HUSSON-CASTA.
3. Les Eaux étroites : aux sources de la « haute mémoire », par Anne-Marie AMIOT.
4. Mémoire d’avenir et d’ailleurs, par Jean BELLEMIN-NOËL.
5. Le Retour de l’Histoire, par Carol MURPHY.
6. « L’Esprit-de- l’Histoire » : parallélisme et mise à distance dans le discours autobiographique gracquien, par Hervé MENOU.
7. Gracq : fiction et Histoire, par Jean BESSIÈRE.
ÉTUDE : Quelques aspects polémiques du André Breton de Gracq, par Atsuko NAGAÏ.
Julien Gracq 3 : “Temps, Histoire, souvenir”. 1998. 208 p. 23,50 €. ISBN 978-2-256-90984-9
TEMPS, HISTOIRE, SOUVENIR :
1. Mémoire, survivance et mouvance dans les récits de Gracq, par Kim JI-YOUNG.
2. Desseins et déclin du temps dans les trois premiers romans de Gracq, par Isabelle HUSSON-CASTA.
3. Les Eaux étroites : aux sources de la « haute mémoire », par Anne-Marie AMIOT.
4. Mémoire d’avenir et d’ailleurs, par Jean BELLEMIN-NOËL.
5. Le Retour de l’Histoire, par Carol MURPHY.
6. « L’Esprit-de- l’Histoire » : parallélisme et mise à distance dans le discours autobiographique gracquien, par Hervé MENOU.
7. Gracq : fiction et Histoire, par Jean BESSIÈRE.
ÉTUDE : Quelques aspects polémiques du André Breton de Gracq, par Atsuko NAGAÏ.
Julien Gracq 3 : “Temps, Histoire, souvenir”. 1998. 208 p. 23,50 €. ISBN 978-2-256-90984-9
Julien Gracq 2 : “Un Écrivain moderne (Cerisy, 1991)”
la littérature incarnée, par Michel MURAT
1. Gracq est-il un moderne ?, par Antoine COMPAGNON.
2. Écriture, lecture, signature, par Michel JARRETY.
3. Lectrice de Gracq, par Élisabeth CARDONNE-ARLYCK.
4. Bonnes lectures et mauvais lieux, par Jacques DUPONT.
5. Au bord de l’Èvre : reflets d’Arnheim dans Les Eaux étroites, par Carol MURPHY.
6. Nantes, dis-moi qui te hante, par Françoise CALIN.
7. Les Guetteurs de l’horizon, par Michel COLLOT.
8. « Prose pour l’étrangère » : du récit poétique au poème en prose, par Ruth AMOSSY.
9. « La Terre habitable » : quatre vignettes préfiguratives, par Michèle MONBALLIN.
10. Julien Gracq phénoménologue ?, par Patrick NÉE.
11. Mythe et écriture du roman, par Patrick MAROT.
12. Le Tableau dans la crypte, par Bernard VOUILLOUX.
Julien Gracq 2 : “Un Écrivain moderne (Cerisy, 1991)”. Michel Murat ed. 1994. 224 p. 25,90 €. ISBN 978-2-256-90932-0
1. Gracq est-il un moderne ?, par Antoine COMPAGNON.
2. Écriture, lecture, signature, par Michel JARRETY.
3. Lectrice de Gracq, par Élisabeth CARDONNE-ARLYCK.
4. Bonnes lectures et mauvais lieux, par Jacques DUPONT.
5. Au bord de l’Èvre : reflets d’Arnheim dans Les Eaux étroites, par Carol MURPHY.
6. Nantes, dis-moi qui te hante, par Françoise CALIN.
7. Les Guetteurs de l’horizon, par Michel COLLOT.
8. « Prose pour l’étrangère » : du récit poétique au poème en prose, par Ruth AMOSSY.
9. « La Terre habitable » : quatre vignettes préfiguratives, par Michèle MONBALLIN.
10. Julien Gracq phénoménologue ?, par Patrick NÉE.
11. Mythe et écriture du roman, par Patrick MAROT.
12. Le Tableau dans la crypte, par Bernard VOUILLOUX.
Julien Gracq 2 : “Un Écrivain moderne (Cerisy, 1991)”. Michel Murat ed. 1994. 224 p. 25,90 €. ISBN 978-2-256-90932-0
Julien Gracq 1 : “Une Écriture en abyme”
avant-propos, par Patrick MAROT
1. Écritures de la matière chez Julien Gracq, par Bruno TRITSMANS.
2. Le Style au miroir — remarques sur le rituel énonciatif dans Un Beau ténébreux, par Dominique MAINGUENEAU.
3. Écriture et connaissance — signes du féminin dans Un Beau ténébreux, par Isabelle HUSSON-CASTA.
4. La Genèse ininterrompue — symbolisme et dynamique connotative dans trois récits de Julien Gracq, par Jean-Yves MAGDELAINE.
5. Entre l’embellie et l’embolie — Julien Gracq, une poétique de l’emblème, par Laurent BAZIN.
6. Plénitude et effacement de l’écriture gracquienne, par Patrick MAROT.
7. Julien Gracq : l’autoreprésentation de l’écriture et la parenthèse de la fiction, par Jean BESSIÈRE.
Fonds gracquien des thèses et des mémoires (Université d’Angers), par Georges CESBRON.
La « Bibliographie Gracq », par Peter C. HOY.
Julien Gracq 1 : “Une Écriture en abyme”. 1991. iv + 212 p. 21,60 €. ISBN 978-2-256-90895-8
1. Écritures de la matière chez Julien Gracq, par Bruno TRITSMANS.
2. Le Style au miroir — remarques sur le rituel énonciatif dans Un Beau ténébreux, par Dominique MAINGUENEAU.
3. Écriture et connaissance — signes du féminin dans Un Beau ténébreux, par Isabelle HUSSON-CASTA.
4. La Genèse ininterrompue — symbolisme et dynamique connotative dans trois récits de Julien Gracq, par Jean-Yves MAGDELAINE.
5. Entre l’embellie et l’embolie — Julien Gracq, une poétique de l’emblème, par Laurent BAZIN.
6. Plénitude et effacement de l’écriture gracquienne, par Patrick MAROT.
7. Julien Gracq : l’autoreprésentation de l’écriture et la parenthèse de la fiction, par Jean BESSIÈRE.
Fonds gracquien des thèses et des mémoires (Université d’Angers), par Georges CESBRON.
La « Bibliographie Gracq », par Peter C. HOY.
Julien Gracq 1 : “Une Écriture en abyme”. 1991. iv + 212 p. 21,60 €. ISBN 978-2-256-90895-8
Autres titres consacrés à Julien Gracq
MAROT, Patrick. La Forme du passé — écriture du temps et poétique du fragment chez Julien Gracq. 1999. 222 p. Coll. « Bibliothèque des lettres modernes » 42. 34,30 € ISBN 978-2-256-91002-9 (réimpression 2021).
PEYRONIE, André. La Pierre de scandale du “Château d’Argol” de Julien Gracq. 1972. 64 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 133. 7,60 €. ISBN 978-2-256-90324-3
CARDONNE-ARLYCK, Élisabeth. Fiction, figure, désir : le « domaine des marges » de Julien Gracq. 1981. 96 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 199. 9,40€. ISBN 978-2-256-90391-5
ROUSSEAU, Laurence. Images et métaphores aquatiques dans l’œuvre de Julien Gracq. 1981. 96 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 200. 10 € ISBN 978-2-256-90392-2
VOUILLOUX, Bernard. Mimesis — sacrifice et carnaval dans la fiction gracquienne. 1991. 88 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 248.
11 € ISBN 978-2-256-90441-7
DAMAMME-GILBERT, Béatrice. “La Forme d’une ville” de Julien Gracq : lecture d’un lieu dialogique. 1998. 96 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 272. 112€. ISBN 978-2-256-90466-0
DUPARC, Léopoldine. Transmutations de la philosophie dans l’univers imaginaire de Julien Gracq. 2006. 134 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 284. 19 €. ISBN 978-2-256-90478-3
MAROT, Patrick. La Forme du passé — écriture du temps et poétique du fragment chez Julien Gracq. 1999. 222 p. Coll. « Bibliothèque des lettres modernes » 42. 34,30 € ISBN 978-2-256-91002-9
PEYRONIE, André. La Pierre de scandale du “Château d’Argol” de Julien Gracq. 1972. 64 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 133. 7,60 €. ISBN 978-2-256-90324-3
CARDONNE-ARLYCK, Élisabeth. Fiction, figure, désir : le « domaine des marges » de Julien Gracq. 1981. 96 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 199. 9,40€. ISBN 978-2-256-90391-5
ROUSSEAU, Laurence. Images et métaphores aquatiques dans l’œuvre de Julien Gracq. 1981. 96 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 200. 10 € ISBN 978-2-256-90392-2
VOUILLOUX, Bernard. Mimesis — sacrifice et carnaval dans la fiction gracquienne. 1991. 88 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 248.
11 € ISBN 978-2-256-90441-7
DAMAMME-GILBERT, Béatrice. “La Forme d’une ville” de Julien Gracq : lecture d’un lieu dialogique. 1998. 96 p. Coll. « Archives des lettres modernes » 272. 112€. ISBN 978-2-256-90466-0
DUPARC, Léopoldine. Transmutations de la philosophie dans l’univers imaginaire de Julien Gracq. 2006. 134 p. Coll. «Archives des lettres modernes» 284. 19 €. ISBN 978-2-256-90478-3