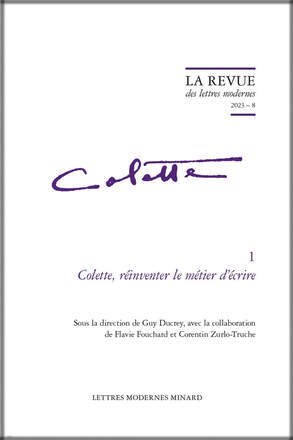Série Colette
Dir. Guy Ducrey (2023)
Dans le paysage des études littéraires, Colette occupe une place majeure, soutenue par la recherche universitaire de ces dernières décennies et un renouveau critique venu dynamiser l’analyse de ses écrits comme de sa figure. Rangée dès 1984 parmi les grands noms de la littérature française dans la prestigieuse « Bibliothèque de la Pléiade », son œuvre a inspiré d’innombrables études – dont un Dictionnaire Colette publié en 2018 et qui rassemblait quatre-vingt spécialistes répartis sur trois continents. À côté de la recherche universitaire, un large public n’en finit pas de proclamer son attachement à cette œuvre complexe, de la lire ou relire, de découvrir des inédits textuels ou photographiques – diffusés par le travail associatif de la Société des amis de Colette depuis un demi-siècle, ou par d’autres explorateurs. C’est enfin un puissant geste de réinscription qui s’est laissé percevoir ces dernières années, où l’écrivaine a été reliée, avec force, en France et ailleurs, à notre actualité brûlante et à notre monde contemporain, sa voix résonnant au diapason des études féministes et queer, végétaristes ou environnementales. Colette est désormais au cœur d’un monde dont elle célébrait l’éclat et les promesses, mais dont elle entrevoyait aussi les périls.
Dans ce domaine en pleine expansion, la Série Colette souhaite approfondir certains thèmes explorés par la recherche antérieure, en esquisser de nouveaux, et surtout croiser les discours et les perspectives d’horizons divers. Terrain de rencontre, cette série espère faire entendre des voix plurielles plutôt qu’un discours homogène, les faisant résonner avec celles du passé mais aussi celles du présent et celles à venir. Cette ambition critique suppose de décentrer quelque peu le point de vue, d’ouvrir les frontières (en particulier transatlantiques), d’abattre certains murs imaginaires pour faire voir l’écrivaine dans sa globalité, elle qui occupe les esprits et les bibliothèques des États-Unis à l’Angleterre, de l’Espagne à la Chine, de l’Allemagne à l’Italie.
Carrefour donc, à la croisée des discours et des échanges, la Série Colette espère apporter à la connaissance de cette œuvre une richesse de points de vue et de discours, des tentatives pour en éclairer le sens et la profondeur dont Gaëtan Picon faisait le principe de toute l’écriture colettienne. À un rythme biennal, la série proposera donc un sujet thématique suffisamment large pour inciter chercheurs et chercheuses à explorer l’œuvre selon diverses approches – thématique ou poétique, génétique ou mémorielle, féministe ou sociologique voire ethnocritique. Afin de situer l’écrivaine dans un contexte large et de faire émerger une pratique singulière des supports qu’elle choisit – supports multiples comme l’on sait – , une analyse comparatiste (la réception à l’étranger, les traductions) et transmédiale (la radio, les adaptations cinématographiques, l’illustration) est vivement encouragée, qui permettra de révéler la conscience profonde des choix opérés par Colette en littérature. Enfin, ce pourra être une confrontation directe ou indirecte de l’œuvre avec les discours sociaux, culturels et artistiques de son temps que Colette brasse, sans avoir l’air d’y toucher, pour s’y conforter ou s’en démarquer. On l’aura compris, l’œuvre échappe autant qu’elle se laisse saisir, enchante autant qu’elle déstabilise, touche autant qu’elle désarçonne. Elle est, comme toutes les grandes œuvres, pourvue d’une coloration inédite, et se laisse sans cesse relire, revisiter, réinterpréter.
Lancée à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance de l’écrivaine (1873), la Série Colette est dirigée par Guy Ducrey, secondé par un Conseil scientifique composé de Flavie Fouchard, Jacques Dupont et Corentin Zurlo-Truche.
Dans ce domaine en pleine expansion, la Série Colette souhaite approfondir certains thèmes explorés par la recherche antérieure, en esquisser de nouveaux, et surtout croiser les discours et les perspectives d’horizons divers. Terrain de rencontre, cette série espère faire entendre des voix plurielles plutôt qu’un discours homogène, les faisant résonner avec celles du passé mais aussi celles du présent et celles à venir. Cette ambition critique suppose de décentrer quelque peu le point de vue, d’ouvrir les frontières (en particulier transatlantiques), d’abattre certains murs imaginaires pour faire voir l’écrivaine dans sa globalité, elle qui occupe les esprits et les bibliothèques des États-Unis à l’Angleterre, de l’Espagne à la Chine, de l’Allemagne à l’Italie.
Carrefour donc, à la croisée des discours et des échanges, la Série Colette espère apporter à la connaissance de cette œuvre une richesse de points de vue et de discours, des tentatives pour en éclairer le sens et la profondeur dont Gaëtan Picon faisait le principe de toute l’écriture colettienne. À un rythme biennal, la série proposera donc un sujet thématique suffisamment large pour inciter chercheurs et chercheuses à explorer l’œuvre selon diverses approches – thématique ou poétique, génétique ou mémorielle, féministe ou sociologique voire ethnocritique. Afin de situer l’écrivaine dans un contexte large et de faire émerger une pratique singulière des supports qu’elle choisit – supports multiples comme l’on sait – , une analyse comparatiste (la réception à l’étranger, les traductions) et transmédiale (la radio, les adaptations cinématographiques, l’illustration) est vivement encouragée, qui permettra de révéler la conscience profonde des choix opérés par Colette en littérature. Enfin, ce pourra être une confrontation directe ou indirecte de l’œuvre avec les discours sociaux, culturels et artistiques de son temps que Colette brasse, sans avoir l’air d’y toucher, pour s’y conforter ou s’en démarquer. On l’aura compris, l’œuvre échappe autant qu’elle se laisse saisir, enchante autant qu’elle déstabilise, touche autant qu’elle désarçonne. Elle est, comme toutes les grandes œuvres, pourvue d’une coloration inédite, et se laisse sans cesse relire, revisiter, réinterpréter.
Lancée à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance de l’écrivaine (1873), la Série Colette est dirigée par Guy Ducrey, secondé par un Conseil scientifique composé de Flavie Fouchard, Jacques Dupont et Corentin Zurlo-Truche.
Colette 1 : “Colette, réinventer le métier d'écrire”
Guy Ducrey (dir.), avec Flavie Fouchard et Corentin Zurlo-Truche
|
L’un des traits les plus marquants de l’œuvre de Colette est de témoigner d’une profonde métamorphose du métier d’écrivain. N’hésitant pas à brocarder, avec Valéry qu’elle admire, l’« écrivain de métier », elle lui préfère les multiples professions qu’impose désormais le monde moderne à ceux qui font métier d’écrire. Actrice de music-hall (« le métier de ceux qui n’en ont appris aucun »), conférencière, préfacière, femme d’affaires, mentor pour jeunes journalistes, journaliste elle-même, marchande de cosmétiques, esthéticienne, Colette fut la femme de plusieurs carrières dont ce premier numéro de la Série Colette cherche à faire entendre les échos dans l’œuvre – des plus connus aux plus négligés par la critique. En déclinant les différentes acceptions que l’autrice de La Femme cachée donna au terme de métier, le dossier la fait apparaître dans toute sa nouveauté : l’exemple d’une nouvelle conception, plurielle, de la carrière littéraire. Le dossier principal de huit contributions sur le métier d’écrivain est suivi d’une rubrique de Variétés, où sont réunis des travaux à thèmes libres, des documents rares et inédits, des notes d’érudition colettienne et un compte rendu.
|
Sommaire
Éditorial : une série pour Colette, par Guy DUCREY, avec Flavie FOUCHARD et Corentin ZURLO-TRUCHE
I. DOSSIER : COLETTE, RÉINVENTER LE MÉTIER D’ÉCRIRE
1. Introduction, par Guy DUCREY
2. Une journée de travail avec Colette : le mardi 25 avril 1933, par Guy DUCREY
3. Colette au travail : ce que les lettres nous apprennent, par Dominique BRÉCHEMIER
4. « Un cochon de métier » : images de la déclassée dans quelques éditions illustrées de La Vagabonde, par Frédéric CANOVAS
5. Colette et les autres : la préface comme (auto)promotion, par Corentin ZURLO-TRUCHE
6. « Écoutez ce que j’ai vu » : Colette conférencière. Un métier méconnu de l’écrivaine, par Margaux GÉRARD
7. Annexe - Table des conférences données par Colette, par Margaux GÉRARD
8. Colette directrice : la Collection Colette, par Kathleen ANTONIOLI
9. Naissance d’une femme d’affaires. Colette et ses éditeurs (1900-1939), par Marie-Charlotte QUIN
10. Claude Tilly à l’école du journalisme, par Pascal DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
II. VARIÉTÉS
11. Un certain goût des choses. Matérialité, consommation et féminité dans les Claudine, par Joséphine VODOZ
12. Les photographies de « Sido ou les points cardinaux », aux sources des portraits de Sido, par Flavie FOUCHARC
13. Deux notules sur Le Pur et l’impur, par Jacques DUPONT
III. MÉMOIRE DE LA CRITIQUE
14. Trois échos d’une tournée de conférences en Europe centrale (Autriche et Roumanie), traduits et présentés par Guy DUCREY et Juliane ROUASSI
IV. COMPTE RENDU
15. Paola PALMA, Colette et le cinéma (par Martine REID)
Commander en ligne ici.
I. DOSSIER : COLETTE, RÉINVENTER LE MÉTIER D’ÉCRIRE
1. Introduction, par Guy DUCREY
2. Une journée de travail avec Colette : le mardi 25 avril 1933, par Guy DUCREY
3. Colette au travail : ce que les lettres nous apprennent, par Dominique BRÉCHEMIER
4. « Un cochon de métier » : images de la déclassée dans quelques éditions illustrées de La Vagabonde, par Frédéric CANOVAS
5. Colette et les autres : la préface comme (auto)promotion, par Corentin ZURLO-TRUCHE
6. « Écoutez ce que j’ai vu » : Colette conférencière. Un métier méconnu de l’écrivaine, par Margaux GÉRARD
7. Annexe - Table des conférences données par Colette, par Margaux GÉRARD
8. Colette directrice : la Collection Colette, par Kathleen ANTONIOLI
9. Naissance d’une femme d’affaires. Colette et ses éditeurs (1900-1939), par Marie-Charlotte QUIN
10. Claude Tilly à l’école du journalisme, par Pascal DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
II. VARIÉTÉS
11. Un certain goût des choses. Matérialité, consommation et féminité dans les Claudine, par Joséphine VODOZ
12. Les photographies de « Sido ou les points cardinaux », aux sources des portraits de Sido, par Flavie FOUCHARC
13. Deux notules sur Le Pur et l’impur, par Jacques DUPONT
III. MÉMOIRE DE LA CRITIQUE
14. Trois échos d’une tournée de conférences en Europe centrale (Autriche et Roumanie), traduits et présentés par Guy DUCREY et Juliane ROUASSI
IV. COMPTE RENDU
15. Paola PALMA, Colette et le cinéma (par Martine REID)
Commander en ligne ici.
Autre titre publié sur Colette
KETCHUM, Anne A. Colette ou la naissance du jour : étude d’un malentendu. 1968. 305 p.
Série fondée et dirigée par Guy DUCREY (2023)
dans La Revue des Lettres modernes
dans La Revue des Lettres modernes