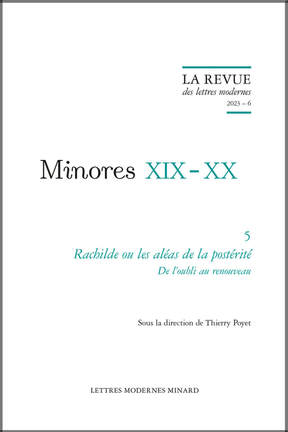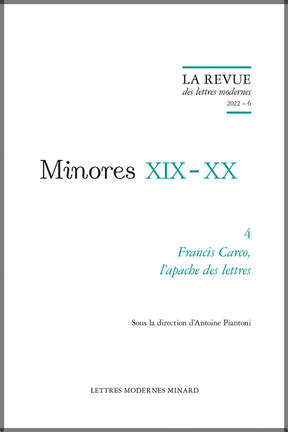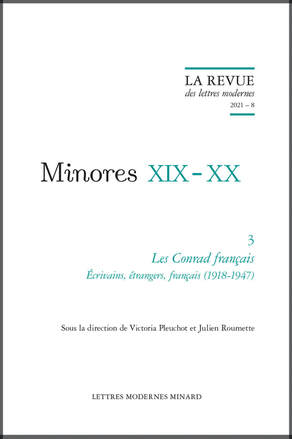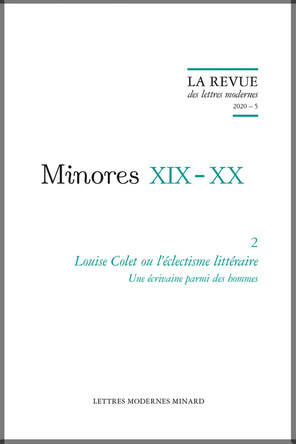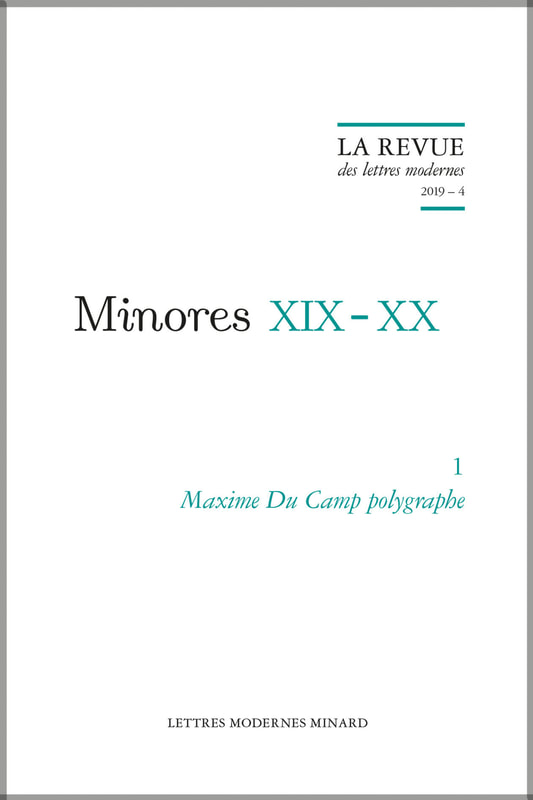Série Minores XIX-XX
Dir. Thierry Poyet (2019)
Par commodité, l’histoire littéraire aime à distinguer au sein d’un siècle quelques rares écrivains considérés comme les représentants les plus accomplis de leur temps : Hugo, Balzac ou Zola pour le XIXe siècle, Proust, Gide ou Sartre pour le XXe siècle sont ainsi des auteurs majeurs que personne ne conteste. D’autres écrivains, cependant, voient leur postérité évoluer, tantôt placés au firmament de leur époque avant de moins briller – Musset, par exemple, ou France – tantôt, au contraire, récompensés enfin par une attente plus ou moins longue dans la reconnaissance de leur talent : Flaubert, Prévert ou Césaire n’ont jamais été aussi appréciés que ces dernières décennies. Et puis il y a la catégorie des auteurs qualifiés aujourd’hui de « minores » qui, pour avoir connu un temps la célébrité, n’ont jamais cependant été complètement affranchis de la tutelle d’un Maître toujours supérieur, ou bien ils sont ceux-là à qui une œuvre jugée moyenne a permis d’exister dans la République des Lettres sans jamais leur offrir une consécration pleine et entière. On dit qu’il leur a manqué de produire un chef d’œuvre et de trouver leur voie. Après quelques succès éditoriaux, ils sont retombés dans un anonymat à peu près définitif.
C’est un continent explosé de la littérature des XIXe et XXe siècles qui se trouve là, encore à explorer, peuplé d’un nombre incertain d’écrivains qui, parvenus jusqu’à la publication, ont pu frayer avec les plus grands. La hiérarchisation de leurs œuvres et, plus généralement, le classement des auteurs constituent un défi difficile à relever : quel rapport entre visibilité et valeur littéraire ? Autrement dit, comment ranger les uns parmi les « majores », les autres dans la catégorie des « minores » ? Avec quels critères ? Selon quelle permanence de jugement ? C’est Maxime Du Camp, le plus beau des « minores », peut-être, qui écrivait : « Le groupe des cent ou des deux cents gens de goût qui, dans chaque siècle, constitue ce que l’on appelle la postérité, est plus sévère que les foules, et son jugement est sans appel. Tel livre dont on a vendu deux cent mille exemplaires lorsqu’il a été mis au jour, ne trouve plus un acheteur au bout de vingt ans. Bien plus, quelques-uns ont si bien disparu, que l’on n’en peut retrouver vestige que dans les dépôts publics ; ils sont retournés à la pâte de papier. L’engouement est extrême, le dédain est excessif ; la mode s’y met et chacun devient aveugle dans ses entraînements. Il faut être très fort pour y résister : Chateaubriand admirait Parny, qui maintenant nous fait sourire[1]. »
Aborder la problématique des auteurs mineurs aux XIXe et XXe siècles, c’est en réalité se poser la double question de la définition du chef d’œuvre – qu’attend-on de la littérature et comment une œuvre obtient-elle une consécration définitive ? – et de la médiatisation du texte littéraire. Il s’agit d’analyser en effet sur quoi se fonde la croyance en la valeur esthétique d’une œuvre littéraire, d’interroger ce qui relève de la stratégie (voir les mises en garde de Julien Gracq dans La Littérature à l’estomac, 1961) ou du stratagème, entre réclame et autopromotion, pour mieux mesurer, aussi, les risques encourus par les « majores » (Sartre notait : « Nous sommes beaucoup plus connus que nos livres ne sont lus. Nous touchons les gens, sans même le vouloir, par de nouveaux moyens. » Qu’est-ce que la littérature ?, 1948) Mieux que les grands auteurs, ce sont peut-être les « minores » qui aident à définir le plus strictement possible le champ littéraire d’un siècle. Mais il faut se garder alors du risque terrible qui consisterait à ne s’intéresser à eux – petites îles éparses et un peu perdues – que pour mieux rendre compte des territoires des « majores ».
C’est en quoi il convient aussi de comparer les « minores » les uns aux autres pour observer la nature de leurs rapports réciproques, que ce soit dans la vie cénaculaire, dans les thématiques développées, les genres retenus, les éditeurs fréquentés… Si la ligne de partage avec les « majores » est à définir, il faut aussi observer leurs solidarités partisanes, leurs liens et leurs conflits, leurs préoccupations esthétiques, morales et sociales : les « minores » forment-ils potentiellement un groupe uni ou bien leurs rivalités internes les condamnent-elles au contraire à rester dans l’ombre comme une explication indépassable ? C’est à la fois l’esthétique définie par la littérature mineure et une histoire littéraire des écrivains qui sont en jeu.
La série « Minores 19-20 » se propose donc de rendre la parole à des auteurs qui ont quelque chose à nous dire, sans parti pris ni volonté de réhabilitation particulière, dans le but cependant clairement affiché de rendre au siècle toute sa palette de couleurs.
[1] Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, Paris, Aubier, 1994, p. 277.
C’est un continent explosé de la littérature des XIXe et XXe siècles qui se trouve là, encore à explorer, peuplé d’un nombre incertain d’écrivains qui, parvenus jusqu’à la publication, ont pu frayer avec les plus grands. La hiérarchisation de leurs œuvres et, plus généralement, le classement des auteurs constituent un défi difficile à relever : quel rapport entre visibilité et valeur littéraire ? Autrement dit, comment ranger les uns parmi les « majores », les autres dans la catégorie des « minores » ? Avec quels critères ? Selon quelle permanence de jugement ? C’est Maxime Du Camp, le plus beau des « minores », peut-être, qui écrivait : « Le groupe des cent ou des deux cents gens de goût qui, dans chaque siècle, constitue ce que l’on appelle la postérité, est plus sévère que les foules, et son jugement est sans appel. Tel livre dont on a vendu deux cent mille exemplaires lorsqu’il a été mis au jour, ne trouve plus un acheteur au bout de vingt ans. Bien plus, quelques-uns ont si bien disparu, que l’on n’en peut retrouver vestige que dans les dépôts publics ; ils sont retournés à la pâte de papier. L’engouement est extrême, le dédain est excessif ; la mode s’y met et chacun devient aveugle dans ses entraînements. Il faut être très fort pour y résister : Chateaubriand admirait Parny, qui maintenant nous fait sourire[1]. »
Aborder la problématique des auteurs mineurs aux XIXe et XXe siècles, c’est en réalité se poser la double question de la définition du chef d’œuvre – qu’attend-on de la littérature et comment une œuvre obtient-elle une consécration définitive ? – et de la médiatisation du texte littéraire. Il s’agit d’analyser en effet sur quoi se fonde la croyance en la valeur esthétique d’une œuvre littéraire, d’interroger ce qui relève de la stratégie (voir les mises en garde de Julien Gracq dans La Littérature à l’estomac, 1961) ou du stratagème, entre réclame et autopromotion, pour mieux mesurer, aussi, les risques encourus par les « majores » (Sartre notait : « Nous sommes beaucoup plus connus que nos livres ne sont lus. Nous touchons les gens, sans même le vouloir, par de nouveaux moyens. » Qu’est-ce que la littérature ?, 1948) Mieux que les grands auteurs, ce sont peut-être les « minores » qui aident à définir le plus strictement possible le champ littéraire d’un siècle. Mais il faut se garder alors du risque terrible qui consisterait à ne s’intéresser à eux – petites îles éparses et un peu perdues – que pour mieux rendre compte des territoires des « majores ».
C’est en quoi il convient aussi de comparer les « minores » les uns aux autres pour observer la nature de leurs rapports réciproques, que ce soit dans la vie cénaculaire, dans les thématiques développées, les genres retenus, les éditeurs fréquentés… Si la ligne de partage avec les « majores » est à définir, il faut aussi observer leurs solidarités partisanes, leurs liens et leurs conflits, leurs préoccupations esthétiques, morales et sociales : les « minores » forment-ils potentiellement un groupe uni ou bien leurs rivalités internes les condamnent-elles au contraire à rester dans l’ombre comme une explication indépassable ? C’est à la fois l’esthétique définie par la littérature mineure et une histoire littéraire des écrivains qui sont en jeu.
La série « Minores 19-20 » se propose donc de rendre la parole à des auteurs qui ont quelque chose à nous dire, sans parti pris ni volonté de réhabilitation particulière, dans le but cependant clairement affiché de rendre au siècle toute sa palette de couleurs.
[1] Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, Paris, Aubier, 1994, p. 277.
Minores XIX-XX – 4
Rachilde, ou les aléas de la postérité
|
Rachilde, dite « Mademoiselle Baudelaire », de son vrai nom Marguerite Eymery (1860/1953), a publié plus de soixante romans réputés pour leur modernité et leur tonalité fin-de-siècle. Si elle a connu les aléas de la postérité, victime de sa dimension scandaleuse, elle laisse un parcours représentatif de la littérature française entre 1880 et 1950. Célèbre et courtisée durant trois décennies au moins, elle connaît une fin de carrière et de vie dans l’oubli alors même qu’elle continue d’écrire sans rien renier de ses opinions et de sa manière toujours singulière d’appréhender le monde.
En 2023, son œuvre tombe dans le domaine public et le monde éditorial s’emploie à redécouvrir des textes originaux dont le caractère souvent subversif peut interroger avec pertinence notre époque. Outre-Manche et outre-Atlantique, le monde universitaire s’est déjà emparé, notamment sous l’effet des gender studies, d’un corpus qui renouvelle l’inspiration romanesque à la fin du XIXe siècle et ouvre des pistes pour le suivant. Car Rachilde est l’autrice de romans qui ont pu paraître à la fois licencieux et suffisamment complexes pour ne pas se démoder et quand l’histoire littéraire la range dans la catégorie des « minores », s’agit-il de lui reprocher au choix : des sujets trop audacieux ? un style trop académique ? un parcours personnel trop tapageur ? des relations trop voyantes et variées ? des prises de position trop tonitruantes ? On ne sait plus… |
En réalité, Rachilde laisse l’œuvre d’une femme libre, nourrie de ses paradoxes sinon de ses contradictions. C’est pourquoi le présent volume, qui regroupe dix-huit contributions, a fait le choix de s’intéresser aux trois grands aspects suivants : la conception de la femme, de la féminité et du féminisme développée par Rachilde dans ses différents textes ; leur modernité entre débats esthétiques et éthiques ou comment Rachilde, par ses fictions, ses comptes rendus et son salon, tente de renouveler la création littéraire ; enfin, la réception critique de ses œuvres, à travers les influences subies, et exercées, et ses amitiés littéraires.
Sommaire
Introduction : Scandale et postérité / Introduction: Scandal and posterity, par Thierry POYET
I. RACHILDE : LA FEMME, LA FÉMINITÉ ET LE FÉMINISME / RACHILDE : WOMAN, FEMININITY AND FEMINISM
1. Le féminin fin de sexe : pour une esthétique de la perversion dans l’imaginaire rachildien / The feminine end of sex: for an aesthetics of perversion in the rachildian imaginary, par Yvonne SAAIBI
2. De la mort de l’amour à l’amour de la mort : hantise et fantasme de la fin de sexe dans La Tour d’amour de Rachilde / From the death of love to the love of death: haunting and fantasizing about the end of sex in Rachilde’s The Tower of Love, par Marie-Gersande RAOULT
3. Pourquoi je ne suis pas féministe : Rachilde ou la provocatrice rétrograde rachildienne / Pourquoi je ne suis pas féministe : Rachilde or the retrograde rachildian provocateur, par Nelly SANCHEZ
4. Rachilde, Animale des lettres. Pour une lecture éco-féministe de l’œuvre rachildienne / Rachilde, Animal of letters. For an eco-feminist reading of Rachilde’s work, par Morgane LERAY
5. Rachilde genderqueer ? / Rachilde genderqueer?, par Maria DEL CARMEN LOJO TIZÓN
6. La femme artiste dans quelques romans rachildiens / The woman artist in some Rachildian novels, par Guri Ellen BARSTAD
II. MODERNITÉS DE L'ŒUVRE : DÉBATS ESTHÉTIQUES ET ÉTHIQUES / MODERNITIES OF THE WORK : AESTHETIC AND ETHICAL DEBATES
7. Rachilde, Reine des Décadents : une lecture de Monsieur Vénus / Rachilde, Queen of the Decadents: a reading of Monsieur Vénus, par Régis-Pierre FIEU
8. Madame Adonis : conte de fées décadent ? / Madame Adonis: a decadent fairy tale?, par Céline BROSSILLON
9. Jouer ou mourir - étude de Queue de poisson (1885) de Rachilde / Play or die - study of Queue de poisson (1885) by Rachilde, par Vicky GAUTHIER
10. L’animal rachildien, avatar de la vérité (Nono, 1885) / The rachildian animal, avatar of the truth (Nono, 1885), par Arielle VERDELHAN
11. Entre l’humain et l’animal : la vie inférieure de Rachilde / Between the human and the animal : the lower life of Rachilde, par Anita STARON
12. La scène première des « humanités médicales » chez Rachilde / The first scene of "medical humanities" in Rachilde, par Larry DUFFY
III. RÉCEPTION ET CRITIQUE / RECEPTION AND CRITICISM
13. La Jongleuse de Rachilde : une anti-éducation sentimentale flaubertienne ? / Rachilde’s La Jongleuse : a Flaubertian anti-educational sentiment ?, par Franck COLOTTE
14. Rachilde et Poe / Rachilde and Poe, par Alain MONTANDON
15. Rachilde en réseau ou l’art du raccroc / Rachilde in network or the art of the hang-up, par Julien SCHUH
16. Quand “Mademoiselle Baudelaire” rencontre “Monsieur de soi-même” ». Rachilde et Barrès / When "Mademoiselle Baudelaire" meets "Monsieur de soi-même". Rachilde and Barrès, par Patrick BERGERON
17. Rachilde, critique de Léon Bloy. De « Mademoiselle Baudelaire » à « Mlle Sainte-Beuve » / Rachilde, critic of Léon Bloy. From "Mademoiselle Baudelaire" to "Mlle Sainte-Beuve, par Michel BRIX
18. Pour une anatomie du discours critique rachildien : Rachilde, « androgyne des lettres » du Mercure ? / For an anatomy of the rachildian critical discourse: Rachilde, "androgynous of letters" of « Mercure de France »?, par Amélie AUZOUX
Commander en ligne ici.
I. RACHILDE : LA FEMME, LA FÉMINITÉ ET LE FÉMINISME / RACHILDE : WOMAN, FEMININITY AND FEMINISM
1. Le féminin fin de sexe : pour une esthétique de la perversion dans l’imaginaire rachildien / The feminine end of sex: for an aesthetics of perversion in the rachildian imaginary, par Yvonne SAAIBI
2. De la mort de l’amour à l’amour de la mort : hantise et fantasme de la fin de sexe dans La Tour d’amour de Rachilde / From the death of love to the love of death: haunting and fantasizing about the end of sex in Rachilde’s The Tower of Love, par Marie-Gersande RAOULT
3. Pourquoi je ne suis pas féministe : Rachilde ou la provocatrice rétrograde rachildienne / Pourquoi je ne suis pas féministe : Rachilde or the retrograde rachildian provocateur, par Nelly SANCHEZ
4. Rachilde, Animale des lettres. Pour une lecture éco-féministe de l’œuvre rachildienne / Rachilde, Animal of letters. For an eco-feminist reading of Rachilde’s work, par Morgane LERAY
5. Rachilde genderqueer ? / Rachilde genderqueer?, par Maria DEL CARMEN LOJO TIZÓN
6. La femme artiste dans quelques romans rachildiens / The woman artist in some Rachildian novels, par Guri Ellen BARSTAD
II. MODERNITÉS DE L'ŒUVRE : DÉBATS ESTHÉTIQUES ET ÉTHIQUES / MODERNITIES OF THE WORK : AESTHETIC AND ETHICAL DEBATES
7. Rachilde, Reine des Décadents : une lecture de Monsieur Vénus / Rachilde, Queen of the Decadents: a reading of Monsieur Vénus, par Régis-Pierre FIEU
8. Madame Adonis : conte de fées décadent ? / Madame Adonis: a decadent fairy tale?, par Céline BROSSILLON
9. Jouer ou mourir - étude de Queue de poisson (1885) de Rachilde / Play or die - study of Queue de poisson (1885) by Rachilde, par Vicky GAUTHIER
10. L’animal rachildien, avatar de la vérité (Nono, 1885) / The rachildian animal, avatar of the truth (Nono, 1885), par Arielle VERDELHAN
11. Entre l’humain et l’animal : la vie inférieure de Rachilde / Between the human and the animal : the lower life of Rachilde, par Anita STARON
12. La scène première des « humanités médicales » chez Rachilde / The first scene of "medical humanities" in Rachilde, par Larry DUFFY
III. RÉCEPTION ET CRITIQUE / RECEPTION AND CRITICISM
13. La Jongleuse de Rachilde : une anti-éducation sentimentale flaubertienne ? / Rachilde’s La Jongleuse : a Flaubertian anti-educational sentiment ?, par Franck COLOTTE
14. Rachilde et Poe / Rachilde and Poe, par Alain MONTANDON
15. Rachilde en réseau ou l’art du raccroc / Rachilde in network or the art of the hang-up, par Julien SCHUH
16. Quand “Mademoiselle Baudelaire” rencontre “Monsieur de soi-même” ». Rachilde et Barrès / When "Mademoiselle Baudelaire" meets "Monsieur de soi-même". Rachilde and Barrès, par Patrick BERGERON
17. Rachilde, critique de Léon Bloy. De « Mademoiselle Baudelaire » à « Mlle Sainte-Beuve » / Rachilde, critic of Léon Bloy. From "Mademoiselle Baudelaire" to "Mlle Sainte-Beuve, par Michel BRIX
18. Pour une anatomie du discours critique rachildien : Rachilde, « androgyne des lettres » du Mercure ? / For an anatomy of the rachildian critical discourse: Rachilde, "androgynous of letters" of « Mercure de France »?, par Amélie AUZOUX
Commander en ligne ici.
Minores XIX-XX – 4
Francis Carco, l'apache des lettres
|
Pour beaucoup, Francis Carco (1886-1958) est et restera le romancier du Milieu, l’amateur des bouges mal famés de la Place Blanche, de Pigalle et de la Butte Montmartre, le chantre gouailleur d’une faune interlope qui mêle apaches, marlous et femmes perdues, dans un Paris labyrinthique où les ors des Grands Boulevards peinent à tenir à distance la boue des fortifs. On ne compte plus les évocations de Carco qui reprennent la lettre adressée à Léopold Marchand dans laquelle il se promet « de foutre dans la gueule des bourgeois, des romans musclés et pourris dont ils se pourlécheront les babouines. » Cette image, sans être totalement erronée, ne rend que très partiellement justice à l’écrivain que fut Carco. À la fois à la marge et au centre du champ littéraire, Carco se tient au croisement des voies du succès commercial, de la respectabilité institutionnelle et de l’absolu littéraire. Nous entendons examiner le paradoxe Carco à travers les différents domaines de sa volumineuse production qui se ramifie dans le roman et la poésie, bien sûr, mais également dans la critique d’art, le reportage et les souvenirs littéraires : la prolixité de son écriture tend à oblitérer, aux yeux de la critique comme du public, un questionnement continu des formes et de leur légitimité, sous la bannière d’une modestie feinte ou sincère, démarche qui fait de Francis Carco un singulier minor dans le paysage des lettres de la première moitié du XXe siècle.
|
Sommaire
Introduction. Francis Carco, l’homme des carrefours / Introduction. Francis Carco standing at the crossroads, par Antoine PIANTONI
I. ROMANCIER DES TÉNÈBRES / A NOVELIST OF THE SHADOWS
1. M’sieur Francis : le romancier des apaches et des filles de joie / M’sieur Francis : The Novelist of ruffians and ladies of the night, par Gilles FREYSSINET
2. Vu du Quai aux Fleurs : sur quelques particularités narratologiques et stylistiques dans les romans de Francis Carco / The View from the Quai aux Fleurs. On some Stylistic and Narratological Peculiarities of Francis Carco’s Novels, par Michel COLLOB
3. De Jésus-la-Caille à Divine : une lecture croisée de Francis Carco et Jean Genet /
From Jésus-la-Caille to Divine : A Comparative Reading of Francis Carco and Jean Genet, par Fabien DUBOSSON
4. Rendez-vous avec la nuit : Carco romancier des limites / Rendezvous with the Night : Carco as a novelist of the edge, par Antoine PIANTONI
II. POÈTE ET CHANSONNIER / POET AND CHANSON SINGER-WRITER
5. Francis Carco poète : le lyrisme de l’ombre / Francis Carco the poet : The Lyricism of the Shadow, par Jean-Pierre ZUBIATE
6. Francis Carco, l’élégiaque et ses démons / Francis Carco,the Elegiac and His Demons, par Pierre LOUBIER
7. « Détours » de la prose : Francis Carco et le poème en prose / “Detours” in prose : Francis Carco and the prose poem, par Adrien CAVALLARO
8. Carco et la douce chanson : le paradoxe de M’sieur Francis / Carco and the Sweet Chanson. The Paradox of M’sieur Francis, par Audrey COUDEVYLLE
III. L’AMATEUR D’IMAGES / THE LOVER OF IMAGES
9. Francis Carco et les peintres : un complexe de valeurs / Francis Carco and Painters : A Complex of Values , par Dominique VAUBEOIS
10. Face aux clichés. Francis Carco et les ouvrages illustrés / Looking head-on at clichés. Francis Carco and illustrated work, par Anne REVERSEAU
11. Francis Carco, chroniqueur de cinéma / FrancisCarco, Film Columnist, par Karine ABADIE
IV. L’ÉCRIVAIN DE L’INTIME ET DE L’EXTIME / A WRITER OF THE INTIMATE AND EXTIMATE
12. Carco, écrivain-reporter et polygraphe du réel / Carco,Writer-Reporter and Polygraphe of Reality, par Mélodie SIMARD-HOUDE
13. Le mémorancier. Francis Carco, ou l’art de romancer ses souvenirs / The Mémorancier. Francis Carco or The Art of Novelizing One’s Memories, par Vincent LAISNEY
14. Un personnage de son œuvre / A Character from his Work, par Bernard BARITAUD
Commander en ligne ici.
I. ROMANCIER DES TÉNÈBRES / A NOVELIST OF THE SHADOWS
1. M’sieur Francis : le romancier des apaches et des filles de joie / M’sieur Francis : The Novelist of ruffians and ladies of the night, par Gilles FREYSSINET
2. Vu du Quai aux Fleurs : sur quelques particularités narratologiques et stylistiques dans les romans de Francis Carco / The View from the Quai aux Fleurs. On some Stylistic and Narratological Peculiarities of Francis Carco’s Novels, par Michel COLLOB
3. De Jésus-la-Caille à Divine : une lecture croisée de Francis Carco et Jean Genet /
From Jésus-la-Caille to Divine : A Comparative Reading of Francis Carco and Jean Genet, par Fabien DUBOSSON
4. Rendez-vous avec la nuit : Carco romancier des limites / Rendezvous with the Night : Carco as a novelist of the edge, par Antoine PIANTONI
II. POÈTE ET CHANSONNIER / POET AND CHANSON SINGER-WRITER
5. Francis Carco poète : le lyrisme de l’ombre / Francis Carco the poet : The Lyricism of the Shadow, par Jean-Pierre ZUBIATE
6. Francis Carco, l’élégiaque et ses démons / Francis Carco,the Elegiac and His Demons, par Pierre LOUBIER
7. « Détours » de la prose : Francis Carco et le poème en prose / “Detours” in prose : Francis Carco and the prose poem, par Adrien CAVALLARO
8. Carco et la douce chanson : le paradoxe de M’sieur Francis / Carco and the Sweet Chanson. The Paradox of M’sieur Francis, par Audrey COUDEVYLLE
III. L’AMATEUR D’IMAGES / THE LOVER OF IMAGES
9. Francis Carco et les peintres : un complexe de valeurs / Francis Carco and Painters : A Complex of Values , par Dominique VAUBEOIS
10. Face aux clichés. Francis Carco et les ouvrages illustrés / Looking head-on at clichés. Francis Carco and illustrated work, par Anne REVERSEAU
11. Francis Carco, chroniqueur de cinéma / FrancisCarco, Film Columnist, par Karine ABADIE
IV. L’ÉCRIVAIN DE L’INTIME ET DE L’EXTIME / A WRITER OF THE INTIMATE AND EXTIMATE
12. Carco, écrivain-reporter et polygraphe du réel / Carco,Writer-Reporter and Polygraphe of Reality, par Mélodie SIMARD-HOUDE
13. Le mémorancier. Francis Carco, ou l’art de romancer ses souvenirs / The Mémorancier. Francis Carco or The Art of Novelizing One’s Memories, par Vincent LAISNEY
14. Un personnage de son œuvre / A Character from his Work, par Bernard BARITAUD
Commander en ligne ici.
Minores XIX-XX – 3
Les Conrad français : écrivains étrangers, français (1918-1947)
|
Au printemps 1940 paraît dans les Nouvelles littéraires une enquête sur les écrivains étrangers, principalement romanciers, ayant choisi d’écrire leur œuvre en français : les « Conrad français ». Ultime manifestation du cosmopolitisme d’entre-deux guerres juste avant la Débâcle, ces entretiens défendent une vision de la littérature ouverte, donnant toute leur place à des écrivains aussi divers que Jean Malaquais, Irène Némirovski, Ernst Erich Noth, Green, Kessel, Troyat, entre autres, auxquels il convient d’ajouter bien d’autres, de Panaït Istrati à Victor Serge, de Romain Gary et Benjamin Fondane à Albert Cohen, de Nathalie Sarraute à Tristan Tzara… Sans eux, la littérature française n’aurait pas le même visage. Relire ces œuvres ensemble, non comme autant d’itinéraires singuliers mais pour ce qu’elles signifient collectivement, comble une lacune de l’histoire littéraire et conduit à repenser la période – d’autant que leur apport se continue bien au-delà de juin 1940, notamment à travers des textes d’une grande maturité littéraire, souvent novateurs, écrits pendant le conflit ou dans l’immédiat après-guerre, qui portent des regards lucides et déchirés sur la France de la Défaite et de Vichy, regards dont nous avons bien besoin aujourd’hui.
Commander en ligne ici. |
Sommaire
Introduction : Le chaînon manquant de l’Histoire littéraire française au XXe siècle
Introduction: The missing Link of French Literary History of the Twentieth Century, par Victoria PLEUCHOT et Julien ROUMETTE
I. DU PLURILINGUISME AU RENOUVELLEMENT DU FRANÇAIS LITTÉRAIRE
FROM PLURILINGUALISM TO THE RENEWAL OF LITERARY FRENCH
1. Choisir le français : mariage d’amour ou de raison ? / Picking French, a marriage of love or convenience?, par Victoria PLEUCHOT
2. Malaquais, de la maîtrise à la paralysie / Malaquais, from mastery to paralysis, par Geneviève NAKACH
3. Benjamin Fondane en quatre langues / Benjamin Fondane in four languages, par Ko IWATSU
4. Albert Cohen, polyglossie et polyphonie /
Albert Cohen, polyglossia and polyphony, par Jérôme CABOT
II. VISIONS DE LA FRANCE VAINCUE / VISIONS OF A DEFEATED FRANCE
5. La souricière et le refuge. Jean Malaquais et Victor Serge, visions de la France vaincue /
The mousetrap and the refuge. Jean Malaquais and Victor Serge, visions of a defeated France, par Pierre MASSON
6. Le mauvais rôle de prophète, La Guerre pourrie, la plus petite France d’Ernst Erich Noth /
The bad role of prophet. La Guerre pourrie, la plus petite France by Ernst Erich Noth, par Julien ROUMETTE
III. FIGURES DE L’ÉTRANGER / FIGURES OF THE FOREIGNER
7. Némirovsky et l’écriture du ban / Irène Némirovsky and the writing of exile, par Elena QUAGLIA
8. Minoritaires d’Istrati / Istrati’s minorities, par Hélène LENZ
9. Du caméléon au métèque, masques et résurgences de la figure de l’étranger chez Gary /
From the chameleon to the metic. Masks and resurgences of the figure of the foreigner in Gary, par Julien ROUMETTE
10. Kessel, tête brûlée, prose protéiforme / Kessel, a risktaker with protean prose, par Georges MILLOT
IV. DIALOGUES / DIALOGUES
11. Aux sources étrangères des avant-gardes françaises, de Dada à Tropismes
The foreign sources of the French avant-garde, from Dada to Tropismes, par Denis LABOURET
12. Écrire au mentor, les correspondances Istrati-Rolland et Gide-Malaquais
Writing to the mentor. The Istrati–Rolland and Gide–Malaquais correspondences, par Victoria PLEUCHOT
V. TEXTES ET INÉDITS / TEXTS AND UNPUBLISHED WORKS
13. Les « Conrad français » : une photo de famille jaunie / The “French Conrads”, a yellowed family photo, par Victoria PLEUCHOT
14. « Les Conrad français », articles des Nouvelles littéraires mars-mai 1940 /
French Conrads. An investigation from the Nouvelles littéraires, par Georges HIGGINS
15. Panaït Istrati et Victor Serge, Amitiés, fidélités et solidarités face au stalinisme /
Panaït Istrati and Victor Serge. Friendships, loyalties, and solidarities in the face of Stalinism, par Christian DELRUE
16. Les persécutions politiques dans l’U.R.S.S. Au secours de Victor Serge ! /
Political persecutions in the USSR. Coming to the rescue of Victor Serge!., par Panaït ISTRATI
Introduction: The missing Link of French Literary History of the Twentieth Century, par Victoria PLEUCHOT et Julien ROUMETTE
I. DU PLURILINGUISME AU RENOUVELLEMENT DU FRANÇAIS LITTÉRAIRE
FROM PLURILINGUALISM TO THE RENEWAL OF LITERARY FRENCH
1. Choisir le français : mariage d’amour ou de raison ? / Picking French, a marriage of love or convenience?, par Victoria PLEUCHOT
2. Malaquais, de la maîtrise à la paralysie / Malaquais, from mastery to paralysis, par Geneviève NAKACH
3. Benjamin Fondane en quatre langues / Benjamin Fondane in four languages, par Ko IWATSU
4. Albert Cohen, polyglossie et polyphonie /
Albert Cohen, polyglossia and polyphony, par Jérôme CABOT
II. VISIONS DE LA FRANCE VAINCUE / VISIONS OF A DEFEATED FRANCE
5. La souricière et le refuge. Jean Malaquais et Victor Serge, visions de la France vaincue /
The mousetrap and the refuge. Jean Malaquais and Victor Serge, visions of a defeated France, par Pierre MASSON
6. Le mauvais rôle de prophète, La Guerre pourrie, la plus petite France d’Ernst Erich Noth /
The bad role of prophet. La Guerre pourrie, la plus petite France by Ernst Erich Noth, par Julien ROUMETTE
III. FIGURES DE L’ÉTRANGER / FIGURES OF THE FOREIGNER
7. Némirovsky et l’écriture du ban / Irène Némirovsky and the writing of exile, par Elena QUAGLIA
8. Minoritaires d’Istrati / Istrati’s minorities, par Hélène LENZ
9. Du caméléon au métèque, masques et résurgences de la figure de l’étranger chez Gary /
From the chameleon to the metic. Masks and resurgences of the figure of the foreigner in Gary, par Julien ROUMETTE
10. Kessel, tête brûlée, prose protéiforme / Kessel, a risktaker with protean prose, par Georges MILLOT
IV. DIALOGUES / DIALOGUES
11. Aux sources étrangères des avant-gardes françaises, de Dada à Tropismes
The foreign sources of the French avant-garde, from Dada to Tropismes, par Denis LABOURET
12. Écrire au mentor, les correspondances Istrati-Rolland et Gide-Malaquais
Writing to the mentor. The Istrati–Rolland and Gide–Malaquais correspondences, par Victoria PLEUCHOT
V. TEXTES ET INÉDITS / TEXTS AND UNPUBLISHED WORKS
13. Les « Conrad français » : une photo de famille jaunie / The “French Conrads”, a yellowed family photo, par Victoria PLEUCHOT
14. « Les Conrad français », articles des Nouvelles littéraires mars-mai 1940 /
French Conrads. An investigation from the Nouvelles littéraires, par Georges HIGGINS
15. Panaït Istrati et Victor Serge, Amitiés, fidélités et solidarités face au stalinisme /
Panaït Istrati and Victor Serge. Friendships, loyalties, and solidarities in the face of Stalinism, par Christian DELRUE
16. Les persécutions politiques dans l’U.R.S.S. Au secours de Victor Serge ! /
Political persecutions in the USSR. Coming to the rescue of Victor Serge!., par Panaït ISTRATI
Minores XIX-XX – 2
Louise Colet ou l'éclectisme littéraire
une écrivaine parmi des hommes
|
Louise Colet n’est restée dans la postérité littéraire qu’en tant que maîtresse de Flaubert alors qu’elle a composé une œuvre remarquée : de la poésie, des romans, des récits de voyage, des textes biographiques, des enquêtes historiques. Si elle a beaucoup écrit pour la presse en rêvant de diriger sa propre revue, elle a tenu aussi un salon littéraire très couru. Ainsi s’est-elle imposée en figure incontournable du monde littéraire.
Malgré de nombreux reproches – on incrimine son éclectisme et fait d’elle un simple bas-bleu –, Louise Colet a laissé une œuvre qui mérite d’être relue. Si l’écrivaine compte aujourd’hui au nombre des minores de son temps, elle n’en est pas moins une figure qui illustre avec beaucoup d’intérêt le XIXe siècle. SOMMAIRE Introduction I. ÉCRIRE 1. « Et mon front couronné s’appuie au front du Temps » Trajectoire poétique de Louise Colet, par Antoine PIANTONI 2. Louise Colet et les conseils de Flaubert, par Éric LE CALVEZ 3. De quelques éléments de facticité dans le roman coletien, par Thierry POYET |
4. L’ironie romantique en France. Essai sur La jeunesse de Goethe, par René STERNKE
II. PENSER (LA FEMME)
5. La Servante et l’éducation des femmes. Louise Colet, une romantique dans le réalisme social, par María Vicenta HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
6. Une biographie d’Émilie du Châtelet, Mettre les Lumières sur une femme de sciences et littérature, par Josiane GUITARD-MOREL
7. Louise Colet, une dramaturge politique dans la presse, par Amélie CALDERONE
8. L’Italie des italiennes : tentative de constitution d’un panthéon féminin en Italie, par Émilie HAMON-LEHOURS
III. VOYAGER
9. Deux mois d’émotions (1843) : entre itinérance mémorielle et scénographie auctoriale, par Franck COLOTTE
10. Louise Colet, une admiratrice enthousiaste de l’Italie du Risorgimento, par Brigitte URBANI
11. À l’épreuve des faits : Les derniers Abbés, un récit anticlérical de Louise Colet, par Nicolas BOURGUINAT
12. Louise Colet au Portugal ou l’histoire possible d’une réception, par Luis Carlos PIMENTA GONCALVES
IV. ÉMOUVOIR
13. Louise Colet et l’enfance, par Guillemette TISON
Commander en ligne ici.
II. PENSER (LA FEMME)
5. La Servante et l’éducation des femmes. Louise Colet, une romantique dans le réalisme social, par María Vicenta HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
6. Une biographie d’Émilie du Châtelet, Mettre les Lumières sur une femme de sciences et littérature, par Josiane GUITARD-MOREL
7. Louise Colet, une dramaturge politique dans la presse, par Amélie CALDERONE
8. L’Italie des italiennes : tentative de constitution d’un panthéon féminin en Italie, par Émilie HAMON-LEHOURS
III. VOYAGER
9. Deux mois d’émotions (1843) : entre itinérance mémorielle et scénographie auctoriale, par Franck COLOTTE
10. Louise Colet, une admiratrice enthousiaste de l’Italie du Risorgimento, par Brigitte URBANI
11. À l’épreuve des faits : Les derniers Abbés, un récit anticlérical de Louise Colet, par Nicolas BOURGUINAT
12. Louise Colet au Portugal ou l’histoire possible d’une réception, par Luis Carlos PIMENTA GONCALVES
IV. ÉMOUVOIR
13. Louise Colet et l’enfance, par Guillemette TISON
Commander en ligne ici.
Minores XIX-XX – 1
Maxime Du Camp polygraphe
Thierry Poyet (dir.)
|
Homme d’influence, académicien, bien introduit dans les cénacles les plus courus, Maxime Du Camp a cherché à être une conscience de son temps en même temps qu’il a espéré peser de tout son poids sur la littérature en train de se faire. Porteur d’un point de vue original et complexe sur la vie littéraire entre 1850 et 1890, il reste incontestablement l’auteur d’une œuvre qu’il convient de relire. Loin de n’être qu’un épigone médiocre de son ami Flaubert ou même un traitre à la cause flaubertienne, Maxime Du Camp qui aura été plus un narrateur ou un conteur qu’un romancier, un théoricien de la poésie qu’un poète, un penseur qu’un moraliste, un sociologue qu’un historien, a écrit et publié de nombreux textes, dont la richesse tant quantitative que qualitative peut représenter une autre manière de faire de la littérature au XIXe siècle.
Ce volume, consacré à Maxime Du Camp, se propose sans volonté de réhabilitation ni perspective strictement historique ou sociologique. L’objectif premier qu’il poursuit consiste dans la volonté de mesurer l’ampleur d’une œuvre aujourd’hui peu lue même si quelques entreprises de réédition ont vu le jour ces trente dernières années. Maxime Du Camp appartient définitivement à |
la catégorie des “minores” du XIXe siècle. Pourtant, son œuvre invite à interroger entre autres la variété de l’inspiration de l’écrivain, ses liens avec les œuvres de ses confrères, la nature et la qualité de ses textes, sa rencontre avec le public mais aussi son esthétique : elle peut aider à fonder une nouvelle définition de la notion de « minores » en posant les bases d’une réflexion archéologique quant à l’influence de Du Camp sur la jeunesse littéraire et relancer la réflexion sur la question de l’héritage littéraire ; elle engage, entre autres encore, le débat sur la notion de sociabilité littéraire.
Par fidélité à sa culture romantique, Maxime Du Camp a fait une large place à l’écriture du moi à tel point que la subjectivité s’est imposée dans son esthétique comme le mode d’appréhension privilégié du réel. Là où ses détracteurs voient un égocentrisme obsessionnel et les limites d’une œuvre, Du Camp a considéré face à l’autonomisation de la littérature, qu’il traçait la voie pour une autre littérature que celle de son ami Flaubert, qui allait bientôt occuper toute la place.
Lire Du Camp, c’est relire selon une autre approche la littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle.
Par fidélité à sa culture romantique, Maxime Du Camp a fait une large place à l’écriture du moi à tel point que la subjectivité s’est imposée dans son esthétique comme le mode d’appréhension privilégié du réel. Là où ses détracteurs voient un égocentrisme obsessionnel et les limites d’une œuvre, Du Camp a considéré face à l’autonomisation de la littérature, qu’il traçait la voie pour une autre littérature que celle de son ami Flaubert, qui allait bientôt occuper toute la place.
Lire Du Camp, c’est relire selon une autre approche la littérature française de la seconde moitié du XIXe siècle.
Sommaire
Introduction. Un homme de culture, par Thierry POYET
I. MAXIME DU CAMP ET LA LITTÉRATURE
1. Du Camp polygraphe et éclectique, par Marta CARAION
2. Du Camp et l’intime. Une esthétique entre liberté, sincérité et vérité, par Thierry POYET
3. Complexité générique dans les nouvelles de Maxime Du Camp. Écriture préfacielle vs écriture fictionnelle, par Charlotte DUFOUR
4. Maxime Du Camp et la genèse de L’Éducation sentimentale, par Éric LE CALVEZ
5. Amour suprême et poésie mineure. Le cas Maxime Du Camp, par Antoine PIANTONI
II. MAXIME DU CAMP ET LE MONDE
6. Du Camp historien du temps présent, par Jean-Charles GESLOT
7. Un pionnier épris de modernité, par Gérard de SENNEVILLE
8. Maxime Du Camp et la photographie, par Anne LACOSTE
9. Maxime Du Camp dans la vallée du Nil. Entre orientalisme et égyptologie, par Hélène VIRENQUE
10. Africanismes. La Nubie de Maxime Du Camp, par Sarga MOUSSA
11. À la croisée des genres. Les Italie de Du Camp, par Philippe ANTOINE
12. Maxime et Gérard vont à Constantinople, par Michel BRIX
13. Pourrait-on identifier l’ami d’En Hollande, lettres à un ami (1859) ?, par Rozanne VERSENDAAL
III. MAXIME DU CAMP ET SES AMIS
14. Les Souvenirs d’outre-tombe de Maxime Du Camp, par Vincent LAISNEY
15. Dans la grande ombre de Flaubert. Louise et Maxime, par Joëlle GARDES TAMINE
16. Louise Pradier et La Païva. deux portraits tirés des Mœurs de mon temps, par Gilles CLÉROUX
17. L’aventure d’une biographie, par Gérard de SENNEVILLE
Commander en ligne ici.
I. MAXIME DU CAMP ET LA LITTÉRATURE
1. Du Camp polygraphe et éclectique, par Marta CARAION
2. Du Camp et l’intime. Une esthétique entre liberté, sincérité et vérité, par Thierry POYET
3. Complexité générique dans les nouvelles de Maxime Du Camp. Écriture préfacielle vs écriture fictionnelle, par Charlotte DUFOUR
4. Maxime Du Camp et la genèse de L’Éducation sentimentale, par Éric LE CALVEZ
5. Amour suprême et poésie mineure. Le cas Maxime Du Camp, par Antoine PIANTONI
II. MAXIME DU CAMP ET LE MONDE
6. Du Camp historien du temps présent, par Jean-Charles GESLOT
7. Un pionnier épris de modernité, par Gérard de SENNEVILLE
8. Maxime Du Camp et la photographie, par Anne LACOSTE
9. Maxime Du Camp dans la vallée du Nil. Entre orientalisme et égyptologie, par Hélène VIRENQUE
10. Africanismes. La Nubie de Maxime Du Camp, par Sarga MOUSSA
11. À la croisée des genres. Les Italie de Du Camp, par Philippe ANTOINE
12. Maxime et Gérard vont à Constantinople, par Michel BRIX
13. Pourrait-on identifier l’ami d’En Hollande, lettres à un ami (1859) ?, par Rozanne VERSENDAAL
III. MAXIME DU CAMP ET SES AMIS
14. Les Souvenirs d’outre-tombe de Maxime Du Camp, par Vincent LAISNEY
15. Dans la grande ombre de Flaubert. Louise et Maxime, par Joëlle GARDES TAMINE
16. Louise Pradier et La Païva. deux portraits tirés des Mœurs de mon temps, par Gilles CLÉROUX
17. L’aventure d’une biographie, par Gérard de SENNEVILLE
Commander en ligne ici.