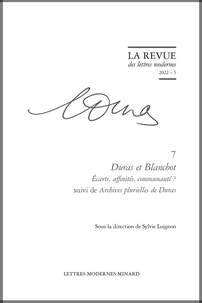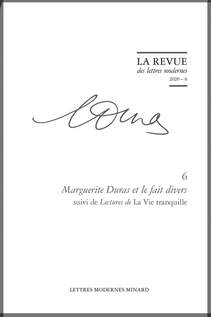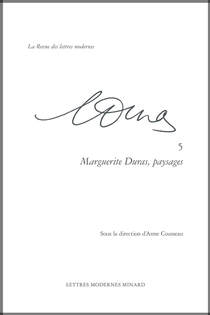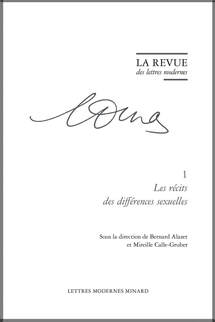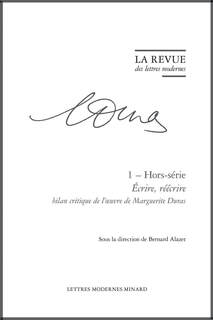Série Marguerite Duras
Dir. Sylvie Loignon (2018)
La Série “Marguerite Duras” est devenue, grâce au chemin ouvert par Bernard Alazet, un lieu d’accueil et de questionnement pour qui étudie l’œuvre de cet auteur, pour qui s’intéresse plus largement à une figure majeure de la littérature du XXe siècle. Cette série a permis d’aborder l’œuvre sous un jour nouveau dans une recherche constante de connaissance, de rigueur et de transmission. C’est ce chemin que nous souhaitons poursuivre.
La série “Marguerite Duras”, telle que nous l’envisageons, répond donc à une exigence de rencontre véritable avec l’œuvre, si tant est que le discours critique “se fasse dialogue”, selon le mot de Jean Starobinski. Prenant acte de l’état actuel des recherches sur l’œuvre de Marguerite Duras, elle se veut ouverte aux approches novatrices de l’œuvre.
Un tel dialogue implique de saisir dans le geste critique non pas seulement les relations internes à l’œuvre et les strates de l’écriture, mais encore les relations de celle-ci à son dehors, cet outside si important pour Duras : les autres œuvres, le réel, la société ou encore l’Histoire.
Sylvie LOIGNON
Marguerite Duras 8 : “Marguerite Duras, mythe(s), écriture, création
et Lectures des Petits Chevaux de Tarquinia”
Simona Crippa et Sylvie Loignon (dir.)
|
La première partie de ce numéro 8 de la série Duras « Mythe(s), écriture et création » désire dessiner un champ de lecture mythopoétique et mythocritique de l’œuvre allant interroger les différents processus et dispositifs de création empruntés par l’autrice qui réactivent et modernisent le savoir mythologique tout en proposant de nouvelles mythologies. L’œuvre de Duras s’inscrit en effet dans un geste aédique continu, car, poreuse aux messages et aux rumeurs que transmet le monde, la voix de l’écrivaine colporte, d’une génération à l’autre, la légende des temps.
Sommaire
Avant-propos, par Sylvie LOIGNON Introduction, par Simona CRIPPA |
I. DURAS : MYTH(E), ÉCRITURE ET CRÉATION
1. Duras par Duras. Le Mythe, par Mireille CALLE-GRUBER
2. Histoires de la violence. Duras, mythographe des genres et des classes, par Johan FAERBER
3. Le mythe de la prison chez Duras, par Anne BRANCKY
4. Le « sang noir » de la jeune fille ensauvagée. Matricide sacrificiel et traversée créatrice dans le cycle indochinois de Marguerite Duras, par Savannah KOCEVAR
5. Duras et la sacralité de l’écriture. Entre élan mythique et déréliction mystique, par Alexis WEINBERG
6. Les Mains négatives. Cosmogonie, création et représentation, par Luciene GUIMARÃES DE OLIVEIRA
7. « Toutes les Belles au Bois dormant l’attendaient ». Le devenir-conte de l’œuvre durassienne, par Christophe MEURÉE
8. Les vitesses au volant, par Emmanuel LASCOUX
9. D’impair en impair, par Marie COSNAY
II. LECTURES DES PETITS CHEVAUX DE TARQUINIA
Introduction, par Sylvie LOIGNON
10. L’ennui dans Les Petits Chevaux de Tarquinia, par Marie-Hélène BOBLET
11. Tombeau de la révolution, par Cécile HANANIA
12. Des tombes étrusques au tombeau littéraire, par Carine CAPONE
13. L’amertume du Campari, par Robert HARVEY
14. Portrait d’une femme mutique, par Midori OGAWA
15. Écrire « les lendemains d’événements ». L’événement silencieux des corps, de la mort et du désir dans Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras, par Laëtitia DELEUZE
16. Garder/changer. Un questionnement existentiel, par Philippe PANSIOT
Commander en ligne ici.
1. Duras par Duras. Le Mythe, par Mireille CALLE-GRUBER
2. Histoires de la violence. Duras, mythographe des genres et des classes, par Johan FAERBER
3. Le mythe de la prison chez Duras, par Anne BRANCKY
4. Le « sang noir » de la jeune fille ensauvagée. Matricide sacrificiel et traversée créatrice dans le cycle indochinois de Marguerite Duras, par Savannah KOCEVAR
5. Duras et la sacralité de l’écriture. Entre élan mythique et déréliction mystique, par Alexis WEINBERG
6. Les Mains négatives. Cosmogonie, création et représentation, par Luciene GUIMARÃES DE OLIVEIRA
7. « Toutes les Belles au Bois dormant l’attendaient ». Le devenir-conte de l’œuvre durassienne, par Christophe MEURÉE
8. Les vitesses au volant, par Emmanuel LASCOUX
9. D’impair en impair, par Marie COSNAY
II. LECTURES DES PETITS CHEVAUX DE TARQUINIA
Introduction, par Sylvie LOIGNON
10. L’ennui dans Les Petits Chevaux de Tarquinia, par Marie-Hélène BOBLET
11. Tombeau de la révolution, par Cécile HANANIA
12. Des tombes étrusques au tombeau littéraire, par Carine CAPONE
13. L’amertume du Campari, par Robert HARVEY
14. Portrait d’une femme mutique, par Midori OGAWA
15. Écrire « les lendemains d’événements ». L’événement silencieux des corps, de la mort et du désir dans Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras, par Laëtitia DELEUZE
16. Garder/changer. Un questionnement existentiel, par Philippe PANSIOT
Commander en ligne ici.
Marguerite Duras 7 : “Duras et Blanchot : écarts, affinités, communauté ?
suivi de Archives plurielles de Duras”
Sylvie Loignon (dir.)
|
Si Maurice Blanchot semble accompagner l’entrée en littérature de Marguerite Duras, en rédigeant le premier compte rendu de son premier roman, Les Impudents, en 1943, les deux écrivains entretiennent une forme de compagnonnage amical et intellectuel. Blanchot fréquenta d’ailleurs le « groupe de la rue Saint-Benoît », autour du couple formé par Dionys Mascolo et Marguerite Duras, et de Robert Antelme. De mêmes lignes de réflexion (sur le communisme et la judéité notamment), des engagements politiques similaires réunissent ces écrivains et intellectuels autour de la revue 14 Juillet, du Manifeste des 121, ou encore du Comité d’action étudiants-écrivains pendant les événements de Mai 1968. Ces relations amicales et intellectuelles ne sont pas sans résonance sur les œuvres de chacun des écrivains. Or, pour l’instant, ces relations ont été relativement peu explorées par la critique.
Blanchot est lecteur et critique de l’œuvre durassienne. Il l’est doublement pourrait-on dire, tant il semble avoir joué un rôle non pas seulement dans la réception de l’œuvre de Duras comme le montrent ses articles – « La douleur du dialogue » (1956), « La voix narrative » (1964), « Détruire » |
(1970) – et son court essai La Communauté des amants (1983) à partir de La Maladie de la mort (1982) ; mais encore dans la genèse de certains textes, à l’instar d’Abahn Sabana David (1970), dont Duras lui donne à lire le manuscrit.
Comme l’indique David Amar, Duras quant à elle « évoque […] Blanchot de façon régulière comme figure ou référence ultime de la littérature ». De fait, pour ne citer qu’Abahn Sabana David, la lecture de l’article de Blanchot « Être juif » a influencé l’écriture de ce texte et les manuscrits de l’adaptation cinématographique, Jaune le soleil, témoignent encore de l’importance du critique et romancier, puisqu’ils sont parcourus de sa belle formule : « il faut aimer pour détruire », qu’il avait employée à propos de Détruire dit-elle.
Les œuvres des deux écrivains font entendre de singulières affinités électives, c’est le cas notamment du Ravissement de Lol V. Stein dont les thématiques et l’écriture ne sont pas sans rappeler celles de L’Attente l’oubli. Bien plus, la nuit, l’absence et la disparition forment le creuset où s’origine l’œuvre de chaque écrivain. Ainsi, dans C’est tout, dont la première version est publiée quelques mois avant sa mort, Duras évoque « le livre à disparaître » comme étant le titre de son dernier livre à venir… Un même questionnement des limites sous-tend l’écriture et en dit la faille et la blessure.
Il conviendra donc de s’intéresser aux diverses relations qui s’esquissent entre Duras et Blanchot, non pas seulement selon le prisme biographique et historico-culturel, mais aussi selon un questionnement des notions si fondamentales de « neutre », de « communauté », d’« impersonnel », de « disparition ». Il s’agira encore d’analyser l’influence de Blanchot dans l’écriture et dans l’herméneutique durassiennes, de mettre au jour les grandes lignes d’une définition commune de la littérature, de dégager les préoccupations théoriques et thématiques qui nourrissent les œuvres des deux auteurs. En définitive, quels sont les écarts et les points de convergence entre Duras et Blanchot sur les plans esthétiques, poétiques et politiques ?
Comme l’indique David Amar, Duras quant à elle « évoque […] Blanchot de façon régulière comme figure ou référence ultime de la littérature ». De fait, pour ne citer qu’Abahn Sabana David, la lecture de l’article de Blanchot « Être juif » a influencé l’écriture de ce texte et les manuscrits de l’adaptation cinématographique, Jaune le soleil, témoignent encore de l’importance du critique et romancier, puisqu’ils sont parcourus de sa belle formule : « il faut aimer pour détruire », qu’il avait employée à propos de Détruire dit-elle.
Les œuvres des deux écrivains font entendre de singulières affinités électives, c’est le cas notamment du Ravissement de Lol V. Stein dont les thématiques et l’écriture ne sont pas sans rappeler celles de L’Attente l’oubli. Bien plus, la nuit, l’absence et la disparition forment le creuset où s’origine l’œuvre de chaque écrivain. Ainsi, dans C’est tout, dont la première version est publiée quelques mois avant sa mort, Duras évoque « le livre à disparaître » comme étant le titre de son dernier livre à venir… Un même questionnement des limites sous-tend l’écriture et en dit la faille et la blessure.
Il conviendra donc de s’intéresser aux diverses relations qui s’esquissent entre Duras et Blanchot, non pas seulement selon le prisme biographique et historico-culturel, mais aussi selon un questionnement des notions si fondamentales de « neutre », de « communauté », d’« impersonnel », de « disparition ». Il s’agira encore d’analyser l’influence de Blanchot dans l’écriture et dans l’herméneutique durassiennes, de mettre au jour les grandes lignes d’une définition commune de la littérature, de dégager les préoccupations théoriques et thématiques qui nourrissent les œuvres des deux auteurs. En définitive, quels sont les écarts et les points de convergence entre Duras et Blanchot sur les plans esthétiques, poétiques et politiques ?
Sommaire
Introduction, par Sylvie LOIGNON
I. DURAS ET BLANCHOT : Écarts, affinités, communauté ? / DURAS AND BLANCHOT : DIFFERENCES, AFFINITIES, COMMUNITY ?
1. « Seuls demeurent ». Poétique de l’impersonnel chez Duras et Blanchot / « Seuls demeurent » (Alone Remain). Duras and Blanchot’s Impersonal Poetics, par Neil MALLOY
2. Le passager de la rue Saint-Benoît, / The Passenger of Rue Saint-Benoît, par Maud FOURTON
3. « Sublime, forcément sublime… ». Marguerite Duras et Maurice Blanchot autour de Louis-René des Forêts. Sublime, musique, enfance / “Sublime, necessarily sublime…” Marguerite Duras and Maurice Blanchot in the Company of Louis-René des Forêts. Sublime, Music, Childhood., par Carol MURPHY
4. L’absence et le neutre. Analyse d’un écart entre Camus, Duras et Blanchot / Absence and the Neuter. Exploring the Divergence between Camus, Duras and Blanchot, par Maïté MARCIANO
5. Duras-Blanchot, la communauté ou le « pas de plus vers l’abîme de vérité » / Duras-Blanchot, Community or the “further step towards the abyss of truth”, par Simona CRIPPA
6. L’absolument féminin. Blanchot lecteur de La Maladie de la mort / The Absolutely Feminine. Blanchot as a Reader of La Maladie de la Mort, Éric HOPPENOT
7. Entre Duras et Blanchot. Comment faire « communauté » ? / Between Duras and Blanchot. What Makes a “Community”?, Llewellyn BROWN
8. La destruction, le désastre. L’avenir selon Duras et Blanchot / Destruction, Disaster. The Future According to Duras and Blanchot, par Christophe MEURÉE
II. ARCHIVES PLURIELLES DE DURAS / DURAS’ ARCHIVAL PLURALITY
9. Les inédits de Marguerite Duras dans les archives : fonds de tiroir ou perles rares ? / Marguerite Duras’ Unpublished Manuscripts in the Archives: Leftovers or Precious Gems?, par Sophie BOGAERT
10. « Le film maigre ». De la création de l’espace hybride dans Le Navire Night de Marguerite Duras / “The Lean Film”. On the Creation of Hybrid Space in Marguerite Duras’ Le Navire Night, par Youlia MARITCHIK-SIOLI
11. De l’inachevé vers l’absent. Le personnage, allégorie du processus d’écriture dans Le Ravissement de Lol V. Stein / From the Unfinished to the Absent. Character as an Allegory of the Writing Process in Le Ravissement de Lol V. Stein, par Lauren UPADHYAY
12. La poétique de la déambulation dans le cinéma durassien. Le processus créateur du film Le Navire Night / The Poetics of Wandering in Duras’ Films. The Creative Process of the Film Le Navire Night, par Luciene GUIMARAES DE OLIVIERA
Commander en ligne ici.
I. DURAS ET BLANCHOT : Écarts, affinités, communauté ? / DURAS AND BLANCHOT : DIFFERENCES, AFFINITIES, COMMUNITY ?
1. « Seuls demeurent ». Poétique de l’impersonnel chez Duras et Blanchot / « Seuls demeurent » (Alone Remain). Duras and Blanchot’s Impersonal Poetics, par Neil MALLOY
2. Le passager de la rue Saint-Benoît, / The Passenger of Rue Saint-Benoît, par Maud FOURTON
3. « Sublime, forcément sublime… ». Marguerite Duras et Maurice Blanchot autour de Louis-René des Forêts. Sublime, musique, enfance / “Sublime, necessarily sublime…” Marguerite Duras and Maurice Blanchot in the Company of Louis-René des Forêts. Sublime, Music, Childhood., par Carol MURPHY
4. L’absence et le neutre. Analyse d’un écart entre Camus, Duras et Blanchot / Absence and the Neuter. Exploring the Divergence between Camus, Duras and Blanchot, par Maïté MARCIANO
5. Duras-Blanchot, la communauté ou le « pas de plus vers l’abîme de vérité » / Duras-Blanchot, Community or the “further step towards the abyss of truth”, par Simona CRIPPA
6. L’absolument féminin. Blanchot lecteur de La Maladie de la mort / The Absolutely Feminine. Blanchot as a Reader of La Maladie de la Mort, Éric HOPPENOT
7. Entre Duras et Blanchot. Comment faire « communauté » ? / Between Duras and Blanchot. What Makes a “Community”?, Llewellyn BROWN
8. La destruction, le désastre. L’avenir selon Duras et Blanchot / Destruction, Disaster. The Future According to Duras and Blanchot, par Christophe MEURÉE
II. ARCHIVES PLURIELLES DE DURAS / DURAS’ ARCHIVAL PLURALITY
9. Les inédits de Marguerite Duras dans les archives : fonds de tiroir ou perles rares ? / Marguerite Duras’ Unpublished Manuscripts in the Archives: Leftovers or Precious Gems?, par Sophie BOGAERT
10. « Le film maigre ». De la création de l’espace hybride dans Le Navire Night de Marguerite Duras / “The Lean Film”. On the Creation of Hybrid Space in Marguerite Duras’ Le Navire Night, par Youlia MARITCHIK-SIOLI
11. De l’inachevé vers l’absent. Le personnage, allégorie du processus d’écriture dans Le Ravissement de Lol V. Stein / From the Unfinished to the Absent. Character as an Allegory of the Writing Process in Le Ravissement de Lol V. Stein, par Lauren UPADHYAY
12. La poétique de la déambulation dans le cinéma durassien. Le processus créateur du film Le Navire Night / The Poetics of Wandering in Duras’ Films. The Creative Process of the Film Le Navire Night, par Luciene GUIMARAES DE OLIVIERA
Commander en ligne ici.
Marguerite Duras 6 : “Marguerite Duras et le fait divers, suivi de lectures de La Vie tranquille”
Sylvie Loignon (dir.)
|
Information le plus souvent brève et dont la diversité est la caractéristique majeure, le fait divers propose une « mise en discours » et une « mise en récit » d’un fait arrivé dans le réel, engendrant une représentation du réel, de la société et de l’imaginaire collectif, et leur interprétation. Le fait divers démontre autant qu’il montre le réel. Comme l’écrit Merleau-Ponty : « Le goût du fait divers, c’est le désir de voir, et voir c’est deviner dans un pli de visage tout un monde semblable au nôtre. » Le fait divers reflète les structures profondes de l’imaginaire et s’intéresse à toutes les formes que peut prendre la fatalité. Roland Barthes (1) a, quant à lui, mis en exergue certains traits formels caractéristiques du fait divers : « récit à structure immanent », le fait divers ne nécessite pas de connaissances en dehors de lui-même – à la différence du fait politique ou historique. Surtout, le fait divers instaure une déviation par rapport à la norme, selon ce que Barthes appelle les « paradoxes de la causalité », affectant la cause et la coïncidence, et révélant le tragique de l’existence. Ainsi, le fait divers donne à voir la société, les mentalités et les fantasmes qui la régissent et tend au lecteur un miroir singulièrement fascinant et repoussant – en cela il a une fonction cathartique.
|
Selon Roland Barthes toujours, le fait divers a en outre un « pouvoir d’appel paradoxal » pour la littérature : en effet, il a à voir avec l’irreprésentable et n’existe pleinement qu’en deçà du langage, « là où le monde cesse d’être nommé ». Plus qu’une simple source d’inspiration, le fait divers est aussi un défi lancé aux écrivains et à l’écriture. Échangeur entre le familier et le remarquable (ce que notait Foucault), le fait divers confronte l’écrivain à une sorte d’aporie : il questionne les frontières du réel et du fictionnel, du vrai et du vraisemblable, du vraisemblable et de l’invraisemblable.
Comment Marguerite Duras s’est-elle emparée du fait divers ? Très présent dans la production durassienne, le fait divers apparaît comme une source d’inspiration indéniable et permet à l’écrivain d’explorer, voire d’expérimenter différentes formes (texte journalistique, pièce de théâtre, récit empruntant au roman d’investigation…). Peut-on alors parler d’un infléchissement par le fait divers de la forme littéraire qui l’accueille ? et plus encore, peut-on esquisser les grandes lignes d’une esthétique du fait divers ? Le fait divers, s’originant dans le réel, renvoie à un imaginaire qui semble rencontrer celui de l’écrivain, notamment à travers l’évocation de la passion. Dès lors, le fait divers s’inscrit-il à la « marge » de l’œuvre ou n’est-ce pas plutôt une question centrale si tant est que la figure du criminel se constitue en figure quasi mythologique chez Duras ? Le fait divers est ainsi singulièrement transposé, voire transformé par cet imaginaire à l’œuvre. Il fait passer du réel à la fiction et souligne, peut-être, la porosité entre ces deux domaines. Il interroge le rapport qu’entretient l’écrivain avec le réel.
Ce volume se propose encore d’étudier les fonctions du fait divers dans l’œuvre durassienne, la façon en particulier dont il amène une réflexion sur la fatalité, dont il dévoile le réel et la société, leurs dysfonctionnements et leurs mécanismes secrets. C’est enfin le geste même d’écrire et ses motivations qui sont questionnés par la présence du fait divers au sein de l’œuvre, ouvrant à une réflexion métapoétique.
1. Roland Barthes, « Structure du fait divers », Essais critiques, Paris, Le Seuil, 1964.
Comment Marguerite Duras s’est-elle emparée du fait divers ? Très présent dans la production durassienne, le fait divers apparaît comme une source d’inspiration indéniable et permet à l’écrivain d’explorer, voire d’expérimenter différentes formes (texte journalistique, pièce de théâtre, récit empruntant au roman d’investigation…). Peut-on alors parler d’un infléchissement par le fait divers de la forme littéraire qui l’accueille ? et plus encore, peut-on esquisser les grandes lignes d’une esthétique du fait divers ? Le fait divers, s’originant dans le réel, renvoie à un imaginaire qui semble rencontrer celui de l’écrivain, notamment à travers l’évocation de la passion. Dès lors, le fait divers s’inscrit-il à la « marge » de l’œuvre ou n’est-ce pas plutôt une question centrale si tant est que la figure du criminel se constitue en figure quasi mythologique chez Duras ? Le fait divers est ainsi singulièrement transposé, voire transformé par cet imaginaire à l’œuvre. Il fait passer du réel à la fiction et souligne, peut-être, la porosité entre ces deux domaines. Il interroge le rapport qu’entretient l’écrivain avec le réel.
Ce volume se propose encore d’étudier les fonctions du fait divers dans l’œuvre durassienne, la façon en particulier dont il amène une réflexion sur la fatalité, dont il dévoile le réel et la société, leurs dysfonctionnements et leurs mécanismes secrets. C’est enfin le geste même d’écrire et ses motivations qui sont questionnés par la présence du fait divers au sein de l’œuvre, ouvrant à une réflexion métapoétique.
1. Roland Barthes, « Structure du fait divers », Essais critiques, Paris, Le Seuil, 1964.
Sommaire
Avant-propos, par Sylvie LOIGNON
Introduction, par Sylvie LOIGNON
I. MARGUERITE DURAS ET LE FAIT DIVERS
1. Des vies infimes aux folies infâmes : le tournant des années Cinquante dans l’œuvre de Duras ; Des Viaducs de la Seine-et-Oise
à L’Amante anglaise, par Marie-Hélène BOBLET
2. “Marguerite en son miroir” : reflets du fait divers, par Anne BRANCKY
3. “Autour” du fait divers, par Maud FOURTON
4. Une aussi longue absence : un fait divers avec sa grande H, par Cécile HANANIA
5. Par-delà le bien et le mal : le fait divers comme structure romanesque : Duras, herméneute de l’affaire Berthaud,
par Chloé CHOUEN-OLLIER
6. Marguerite Duras, Jean Genet et le fait divers, par Najet LIMAM-TNANI
7. Espionne de Dieu : Duras entre faits divers et mythes, par Simona CRIPPA
8. Christine V. ou les lectures illimitées : poétique sociale du fait divers chez Duras, par Johan FAERBER
II. LECTURES DE LA VIE TRANQUILLE
9. La Vie tranquille ou le roman de l’intranquillité, par Françoise BARBE-PETIT
10. Vie étrange de Francine V, par Midori OGAWA
11. Visagéité et in-vu de l’Autre : enjeux d’un manque-à-être dans La Vie tranquille, par Olivier AMMOUR-MAYEUR
12. Françou : les prémices d’Aurélia ? ou la question des origines, par Laurent CAMERINI
13. Réflexion sur le personnage féminin dans La Vie tranquille, par par Julie BEAULIEU
14. « Tout est déjà passé » ? : du tragique dans La Vie tranquille, par Christophe MEURÉE
III. CARNET CRITIQUE
Commander en ligne ici.
Introduction, par Sylvie LOIGNON
I. MARGUERITE DURAS ET LE FAIT DIVERS
1. Des vies infimes aux folies infâmes : le tournant des années Cinquante dans l’œuvre de Duras ; Des Viaducs de la Seine-et-Oise
à L’Amante anglaise, par Marie-Hélène BOBLET
2. “Marguerite en son miroir” : reflets du fait divers, par Anne BRANCKY
3. “Autour” du fait divers, par Maud FOURTON
4. Une aussi longue absence : un fait divers avec sa grande H, par Cécile HANANIA
5. Par-delà le bien et le mal : le fait divers comme structure romanesque : Duras, herméneute de l’affaire Berthaud,
par Chloé CHOUEN-OLLIER
6. Marguerite Duras, Jean Genet et le fait divers, par Najet LIMAM-TNANI
7. Espionne de Dieu : Duras entre faits divers et mythes, par Simona CRIPPA
8. Christine V. ou les lectures illimitées : poétique sociale du fait divers chez Duras, par Johan FAERBER
II. LECTURES DE LA VIE TRANQUILLE
9. La Vie tranquille ou le roman de l’intranquillité, par Françoise BARBE-PETIT
10. Vie étrange de Francine V, par Midori OGAWA
11. Visagéité et in-vu de l’Autre : enjeux d’un manque-à-être dans La Vie tranquille, par Olivier AMMOUR-MAYEUR
12. Françou : les prémices d’Aurélia ? ou la question des origines, par Laurent CAMERINI
13. Réflexion sur le personnage féminin dans La Vie tranquille, par par Julie BEAULIEU
14. « Tout est déjà passé » ? : du tragique dans La Vie tranquille, par Christophe MEURÉE
III. CARNET CRITIQUE
Commander en ligne ici.
Marguerite Duras 5 : “Marguerite Duras : paysages”
Anne Cousseau, Bernard Alazet (dir.)
|
Si importante que soit la bibliographie critique de Marguerite Duras, il est peu de travaux qui aient évoqué cette œuvre à partir du geste descriptif. La description traverse pourtant les textes durassiens, souvent en marge, parfois au premier plan. Celle-ci se cristallise en particulier dans l’évocation de paysages, ceux de l’enfance et des pays lointains, mais aussi ceux qui n’existent que de donner forme signifiante aux personnages qui les habitent. Paysage d’eau ou urbain, l’espace décrit se révèle chez Duras illimité, appel à percevoir pour mieux témoigner d’un manque à voir, paysage intérieur dans lequel se réfléchit le monde.
Sommaire
Avant-propos de Bernard ALAZET
Yann Andréa – Entretien avec Catherine RODGERS Présentation par Anne COUSSEAU |
I. PAYSAGES
1. Inspirations paysagères de Marguerite Duras : Savanes de l’Ouellé, vallée de la Lune et cimes de la mort, par Cécile HANANIA
2. (D)écrire, dit-elle : le geste descriptif chez Duras, par Marie-Annick GERVAIS-ZANINGER
3. Le paysage durassien : entre abstraction et fantasme, par Marie-Françoise BERTHU-COURTIVRON
4. Le Paysage, le dehors et le tout : Le Camion de Marguerite Duras, par Florence de CHALONGE
5. Valeurs du paysage dans L’Homme assis dans le couloir, par Anne COUSSEAU
II. ÉTUDES
6. La Jeune fille et la mort. Notes sur les rapports entre Duras et Blanchot, par David AMAR
7. Des cris et de l’écrit : de Marguerite Duras à Jean-Luc Lagarce, par Marie-Hélène BOBLET
8. Sur la mer des ténèbres – Marguerite Duras et Tsushima Yūko, par Midori OGAWA
9. L’Être et le « là » dans Le ravissement de Lol V. Stein, par Philippe PANSIOT PREUD’HOMME
10. Jeu et enjeu de la répétition dans La Musica Deuxième, par Sélila MEJRI
11. Les peurs de Marguerite Duras, par Catherine RODGERS
III. CARNET CRITIQUE
Commander en ligne ici.
1. Inspirations paysagères de Marguerite Duras : Savanes de l’Ouellé, vallée de la Lune et cimes de la mort, par Cécile HANANIA
2. (D)écrire, dit-elle : le geste descriptif chez Duras, par Marie-Annick GERVAIS-ZANINGER
3. Le paysage durassien : entre abstraction et fantasme, par Marie-Françoise BERTHU-COURTIVRON
4. Le Paysage, le dehors et le tout : Le Camion de Marguerite Duras, par Florence de CHALONGE
5. Valeurs du paysage dans L’Homme assis dans le couloir, par Anne COUSSEAU
II. ÉTUDES
6. La Jeune fille et la mort. Notes sur les rapports entre Duras et Blanchot, par David AMAR
7. Des cris et de l’écrit : de Marguerite Duras à Jean-Luc Lagarce, par Marie-Hélène BOBLET
8. Sur la mer des ténèbres – Marguerite Duras et Tsushima Yūko, par Midori OGAWA
9. L’Être et le « là » dans Le ravissement de Lol V. Stein, par Philippe PANSIOT PREUD’HOMME
10. Jeu et enjeu de la répétition dans La Musica Deuxième, par Sélila MEJRI
11. Les peurs de Marguerite Duras, par Catherine RODGERS
III. CARNET CRITIQUE
Commander en ligne ici.
Marguerite Duras 4 : “le personnage : miroitements du sujet”
Florence de Chalonge (dir.)

C’est en 1996 que Marguerite Duras a quitté l’écriture, ou plutôt que l’écriture l’a quittée. Ce temps de l’après engage à revisiter les commentaires que son œuvre a fait naître tout au long de sa production, à les renouveler depuis cette distance temporelle qui permet toujours d’appréhender différemment une thématique, une esthétique, une singularité. C’est la notion de personnage qui est ici réinvestie par les chercheurs qu’a réunis Florence de Chalonge pour ce quatrième volume de la Série Marguerite Duras. Exégète de l’œuvre depuis de nombreuses années, Florence de Chalonge, par ses nombreux travaux, nous a en particulier permis de mieux saisir la spécificité du texte durassien dans le champ littéraire et philosophique du second demi-siècle. Elle nous invite ici à redécouvrir la population durassienne, dont l’identité « de nature indécise », est à même de construire/déconstruire un sujet saisi dans ses miroitements.
Le second volet de ce volume, voué à rendre compte de l’avancée de la recherche consacrée à Marguerite Duras, accueille trois contributions qui, sans leur faire toujours explicitement écho, accompagnent les analyses du premier volet.
Le second volet de ce volume, voué à rendre compte de l’avancée de la recherche consacrée à Marguerite Duras, accueille trois contributions qui, sans leur faire toujours explicitement écho, accompagnent les analyses du premier volet.
Sommaire
avant-propos, par Bernard ALAZET
I. LE PERSONNAGE : MIROITEMENTS DU SUJET.
« Ces gens-là », dit Marguerite Duras : des personnages en quête d’histoire, par Florence DE CHALONGE.
1. Genèse du personnage : Jacques Hold dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, par Annalisa BERTONI.
2. « Prête-moi ta plume… », l’auctorialité chez Marguerite Duras, par Maud FOURTON.
3. Faire parler les personnages, Duras ou l’art du (dé)placement, par Philippe WAHL.
4. Sur Moderato cantabile et Détruire dit-elle de Marguerite Duras — personnages sans point de vue, points de vue sans personnage, par Gilles PHILIPPE.
5. Entre l’homme et la femme... (dans l’œuvre de Marguerite Duras), par Michel DAVID.
6. A.-M. S., ou la politique cryptée de Duras, par Martin CROWLEY.
7. Les Personnages juifs chez Marguerite Duras, une écriture d’après Auschwitz, par Carole KSIAZENICER-MATHERON.
II. ÉTUDES :
8. Le Récit à l’épreuve du poétique (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-consul, India Song de Marguerite Duras, par Anne COUSSEAU.
9. Apprendre le nom juif : Abahn, Sabana, David, de Marguerite Duras, par Llewellyn BROWN.
10. “À partir du manque, donner à voir” : une pudeur déplacée dans l’écriture de Marguerite Duras, par Anaïs FRANTZ.
III. CARNET CRITIQUE
Marguerite Duras 4 : “Le Personnage : miroitements du sujet”. Florence DE CHALONGE ed. 2011. 198 p. 20 €
ISBN 978-2-256-91163-7
I. LE PERSONNAGE : MIROITEMENTS DU SUJET.
« Ces gens-là », dit Marguerite Duras : des personnages en quête d’histoire, par Florence DE CHALONGE.
1. Genèse du personnage : Jacques Hold dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, par Annalisa BERTONI.
2. « Prête-moi ta plume… », l’auctorialité chez Marguerite Duras, par Maud FOURTON.
3. Faire parler les personnages, Duras ou l’art du (dé)placement, par Philippe WAHL.
4. Sur Moderato cantabile et Détruire dit-elle de Marguerite Duras — personnages sans point de vue, points de vue sans personnage, par Gilles PHILIPPE.
5. Entre l’homme et la femme... (dans l’œuvre de Marguerite Duras), par Michel DAVID.
6. A.-M. S., ou la politique cryptée de Duras, par Martin CROWLEY.
7. Les Personnages juifs chez Marguerite Duras, une écriture d’après Auschwitz, par Carole KSIAZENICER-MATHERON.
II. ÉTUDES :
8. Le Récit à l’épreuve du poétique (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-consul, India Song de Marguerite Duras, par Anne COUSSEAU.
9. Apprendre le nom juif : Abahn, Sabana, David, de Marguerite Duras, par Llewellyn BROWN.
10. “À partir du manque, donner à voir” : une pudeur déplacée dans l’écriture de Marguerite Duras, par Anaïs FRANTZ.
III. CARNET CRITIQUE
Marguerite Duras 4 : “Le Personnage : miroitements du sujet”. Florence DE CHALONGE ed. 2011. 198 p. 20 €
ISBN 978-2-256-91163-7
Marguerite Duras 3
"Paradoxes de l'image"
avant-propos, par Bernard Alazet
I. PARADOXES DE L'IMAGE
liminaire, par Sylvie Loignon
1. La Maladie de la mort de Marguerite Duras, ou la Maladie de l’imagination, par Chloé Chouen-Ollier.
2. L’Angle mort ou les trois temps de l’image dans l’œuvre de Marguerite Duras, par Johan Faerber.
3. L’Image dans la parole, Hiroshima mon amour de Marguerite Duras et Alain Resnais, par Florence de Chalonge.
4. Ce qui d’une image n’est pas à voir, ce qui d’un texte n’est pas à lire, les mises en scène des œuvres de Marguerite Duras par Claude Régy
et Robert Wilson, par Sabine Quiriconi.
5. Vu et lu sur une carte postale — carte postale et écriture dans l’œuvre de Marguerite Duras, par Maud Fourton.
6. La Mer écrite de Marguerite Duras ou le dynamisme poétique d’une image d’enfance, par Anne Cousseau.
II. Études
7. La Mère océanique de Marguerite Duras : un lieu métaphorique, par Joëlle Pagès-Pindon.
8. Marguerite Duras ou l’indécence, Les Yeux bleus cheveux noirs, La Maladie de la mort, par Charlotte Laugraud-de Sainte Hermine.
9. L’Âge de la traversée, Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras, par Simona Crippa.
10. Écritures du contrepoint : India Song de Duras et Passacaille de Pinget, par Aline Marchand.
11. Marguerite Duras et Jean Genet : « “La vérité” des ténèbres », par Najet Limam-Tnani.
III. Carnet critique
Marguerite Duras 3 : “Paradoxes de l’image”. Sylvie Loignon ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. «La Revue des lettres
modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 196 p. 19 € ISBN 978-2-256-91141-5
Marguerite Duras 2 : “Écriture, écritures”.
Myriem EL MAÏZI et Brian STIMPSON (dir.)
|
avant-propos, par Carol MURPHY
introduction, par Myriem EL MAÏZI et BRIAN STIMPSON I. PROCÈS D’ÉCRITURE. 1. Des “Coréens” à Emily L. : genèse d’une poïétique durassienne, par Brian STIMPSON. 2. « Une même personne indéfiniment multipliée » : l’ubiquité du personnage- écrivain dans Emily L. de Marguerite Duras, par Maud FOURTON. 3. La Réécriture chez Marguerite Duras : entre épuisement et relance, par Bernard ALAZET. 4. « On peut aussi ne pas écrire, oublier une mouche » — Genèse de Aurélia Steiner (Paris), par Myriem EL MAÏZI. 5. “Un miroir qui revient” : genèse de la scène du bal dans l’avant-texte de Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, par Annalisa BERTONI. |
6. « À corps » et désaccords : de l’écriture désaccordée au corps comme lieu de l’écriture chez Marguerite Duras, par Sylvie LOIGNON.
7. Processus atemporel durassien, par Christophe MEURÉE.
II. ÉCRITURE, VOIX ET IMAGE.
8. À travers le miroir acous- tique : les membranes audio-vocales du théâtre durassien, par Mary NOONAN.
9. Images archétypes et voix archaïques : les origines du cinéma de Marguerite Duras, par Renate GÜNTHER.
10. Du paratexte au cinéma : la poïétique durassienne et sa mise en scène, par Michelle ROYER.
11. La “chambre noire” dans Le Camion de Marguerite Duras, par Julie BEAULIEU.
12. Le cinéma de Marguerite Duras : entre “impossible” et sublime, par Sarah GASPARI.
III. L’ÉCRITURE ET LE «MONDE EXTÉRIEUR».
13. Le Moi hybride postcolonial dans les textes coloniaux de Marguerite Duras, par Raylene RAMSAY.
14. De Moscou à Hiroshima : les «archives» artificielles de Marguerite Duras, par Cécile HANANIA.
15. “Dedicated to the One I Love”, ce que nous disent les dédicaces de Duras, par Martin CROWLEY.
Marguerite Duras 2 : “Écriture, écritures”. Myriem EL MAÏZI et Brian STIMPSON eds. 2007. 252 p. 18 € ISBN 978-2-256-91124-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
7. Processus atemporel durassien, par Christophe MEURÉE.
II. ÉCRITURE, VOIX ET IMAGE.
8. À travers le miroir acous- tique : les membranes audio-vocales du théâtre durassien, par Mary NOONAN.
9. Images archétypes et voix archaïques : les origines du cinéma de Marguerite Duras, par Renate GÜNTHER.
10. Du paratexte au cinéma : la poïétique durassienne et sa mise en scène, par Michelle ROYER.
11. La “chambre noire” dans Le Camion de Marguerite Duras, par Julie BEAULIEU.
12. Le cinéma de Marguerite Duras : entre “impossible” et sublime, par Sarah GASPARI.
III. L’ÉCRITURE ET LE «MONDE EXTÉRIEUR».
13. Le Moi hybride postcolonial dans les textes coloniaux de Marguerite Duras, par Raylene RAMSAY.
14. De Moscou à Hiroshima : les «archives» artificielles de Marguerite Duras, par Cécile HANANIA.
15. “Dedicated to the One I Love”, ce que nous disent les dédicaces de Duras, par Martin CROWLEY.
Marguerite Duras 2 : “Écriture, écritures”. Myriem EL MAÏZI et Brian STIMPSON eds. 2007. 252 p. 18 € ISBN 978-2-256-91124-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
Marguerite Duras 1 : “Les Récits des différences sexuelles”
Bernard Alazet et Mireille Calle-Gruber (dir.)
|
présentation de la Série Marguerite Duras, par Bernard ALAZET
avant-propos, par Bernard ALAZET I. MARGUERITE DURAS OU LES RÉCITS DES DIFFÉRENCES SEXUELLES. Viens, liminaire, par Mireille CALLE- GRUBER. 1. La Dérobée du récit chez M. Duras, par Mireille CALLE-GRUBER. 2. « Elle marcherait et la phrase avec elle » : la phrase, le neutre, l’androgyne chez M. Duras, par Bernard ALAZET. 3. L’Écriture, “admirable putain” : écriture et prostitution chez M. Duras, par Chloé CHOUEN-OLLIER. 4. Souvenirs du Triangle d’or ou du troisième sexe au troisième texte dans L’Amant de la Chine du Nord de M. Duras, par Johan FAERBER. 5. La Retombée des mots : le corps des mots dans l’œuvre de M. Duras, par Sylvie LOIGNON. |
6. « L’Homme vierge de Lahore », une approche du héros éponyme dans Le Vice-consul de M. Duras, par Christiane BLOT-LABARRÈRE.
7. La Voix (dés)incarnée du Navire Night de M. Duras, par Midori OGAWA.
8. Eau-nanisme ou plaisir du dédoublement narcissique, chez M. Duras, par Laurent CAMERINI.
II. ÉTUDES.
9. M. Duras : Délivrer l’écrit de l’écriture même, par Emmanuelle TOUATI.
10. Théâtre et polyphonie dans Le Square de M. Duras et Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, par Pauline SELLIER.
11. Questions de voix, Le Bavard de Louis-René des Forêts et La Maladie de la Mort de M. Duras, par Sabine DOLIGÉ.
12. Le Jeu spéculaire de l’autobiographie dans L’Amant de M. Duras et Journal du voleur de Jean Genet, par Najet LIMAM-TNANI.
13. Savannah Bay : entre l’épique et le dramatique, par Sélila MEJRI.
14. Le Vice-consul de M. Duras ou l’éloge de la désorientation, par Samia KASSAB-CHARFI.
III. CARNET CRITIQUE
Marguerite Duras 1 : “Les Récits des différences sexuelles”. Bernard ALAZET et Mireille CALLE-GRUBER eds. 2005. II + 276. p. 25 €
ISBN 978-2-256-91093-7
RÉIMPRESSION à commander en ligne ici.
7. La Voix (dés)incarnée du Navire Night de M. Duras, par Midori OGAWA.
8. Eau-nanisme ou plaisir du dédoublement narcissique, chez M. Duras, par Laurent CAMERINI.
II. ÉTUDES.
9. M. Duras : Délivrer l’écrit de l’écriture même, par Emmanuelle TOUATI.
10. Théâtre et polyphonie dans Le Square de M. Duras et Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, par Pauline SELLIER.
11. Questions de voix, Le Bavard de Louis-René des Forêts et La Maladie de la Mort de M. Duras, par Sabine DOLIGÉ.
12. Le Jeu spéculaire de l’autobiographie dans L’Amant de M. Duras et Journal du voleur de Jean Genet, par Najet LIMAM-TNANI.
13. Savannah Bay : entre l’épique et le dramatique, par Sélila MEJRI.
14. Le Vice-consul de M. Duras ou l’éloge de la désorientation, par Samia KASSAB-CHARFI.
III. CARNET CRITIQUE
Marguerite Duras 1 : “Les Récits des différences sexuelles”. Bernard ALAZET et Mireille CALLE-GRUBER eds. 2005. II + 276. p. 25 €
ISBN 978-2-256-91093-7
RÉIMPRESSION à commander en ligne ici.
D'AUTRES TITRES CONSACRÉS À L'ŒUVRE DE MARGUERITE DURAS
écrire, réécrire
bilan critique de l'œuvre de Marguerite Duras
|
avant-propos, par Bernard ALAZET.
1. Paroles d’auteur : les enjeux du paratexte dans l’œuvre de Duras, par Christiane BLOT-LABARRÈRE. 2. Faire rêver la langue : style, forme, écriture chez Duras, par Bernard ALAZET. 3. Réécrire l’origine : Duras dans le champ analytique, par Philippe SPOLJAR. 4. Les Lectures « sémiotiques » du texte durassien : un barrage contre la fascination, par Madeleine BORGOMANO. 5. « La Région des voix » : énonciation verbale et narration chez Duras, par Florence de CHALONGE. 6. Duras traduite, Duras traductrice, par Robert HARVEY. Bernard ALAZET ed. 2002. Coll. « La Revue des lettres modernes /L’Icosathèque 19 ». 188 p. 19€. ISBN 978-2-256-91042-5 RÉIMPRESSION : commander en ligne ici. |
BROWN, Llewellyn. Marguerite Duras, écrire et détruire : un paradoxe de la création. Coll. « Archives des lettres modernes », n° 297.
CERASI, Claire. Du rythme au sens — une lecture de “L’Amour” de Marguerite Duras. 1992. 102 p. Coll. « Archives des lettres modernes », n° 254. 12 €. ISBN 978-2-256-90447-9
CHOUEN-OLLIER, Chloé. L’Écriture de la prostitution dans l’œuvre de Marguerite Duras : écrire l’écart, série « Critique », n° 47, 2015.
CLÉDER, Jean (dir.). Études cinématographiques vol. 73 : “Marguerite Duras, le cinéma”, « La Revue des Lettres modernes », 2013.
CRIPPA, Simona. Marguerite Duras : la tentation du théorique, Coll. « Biblothèque des lettres modernes ; Critique », n° 57, 2021.
SEYLAZ, Jean-Luc. Les Romans de Marguerite Duras. Essai sur une thématique de la durée. 1963. 48 p. Coll. « Archives des lettres modernes », n° 47. épuisé. ISBN 978-2-256-90238-3
Consulter aussi
Un Nouveau roman ? recherches et tradition — la critique étrangère. John Herbert MATTHEWS ed. 1964. 256 p. Coll. « Situation » 3. ISBN 978-2-256-90521-6 [« Reprint Érudition Poche » 2, 1983 : ISBN 978-2-85210-201-9] 13,60 €
Pp. 75–82 : Marguerite Duras : le langage comme événement, par Barbara BRAY.
Le « Nouveau Roman » en questions 1 : “‘Nouveau Roman’ et archétypes”. Roger-Michel ALLEMAND ed. 1992. VI + 156 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/ « L’Icosathèque 13 ». 20€. ISBN 978-2-256-90903-0
Pp. 13–60 : L’Amour fou, femme fatale, Marguerite Duras : une récriture sublime des archétypes les mieux établis en littérature,
par Mireille CALLE-GRUBER.
Le « Nouveau Roman » en questions 2 : “ ‘Nouveau Roman’ et archétypes 2”. Roger-Michel ALLEMAND ed.
1993. 202 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/« L’Icosathèque 14 ». 25€. ISBN 978-2-256-90929-0
Pp. 121–62 : L’Écriture de Duras ou la récriture du livre : L’Amant de la Chine du Nord ou « L’Amant recommencé », par Béatrice
BONHOMME.
Études romanesques 4. “L’Autre du roman et de la fiction”. Jean BESSIÈRE ed. 1996. 226 p. 30,50 €. ISBN 978-2-256-90962-7
Pp. 51–74 : Apories contemporaines du narratif et fable féminine : Anaïs Nin, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Elsa Morante,
par Jean BESSIÈRE.
Le « Nouveau Roman » en questions 3 : “Le Créateur et la Cité”. Roger-Michel ALLEMAND ed. 1999. 202 p. Coll. « La Revue des lettres modernes » /« L’Icosathèque 16 ». 23,40€. ISBN 978-2-256-91000-5
Pp. 33–62 : Duras : d’une écriture politique à une écriture du politique, par Madeleine BORGOMANO.
Pp. 127–54 : Marguerite Duras et le « Nouveau Roman », par Christiane BLOT-LABARRÈRE.
Études romanesques 6. “Dialogue franco-ukrainien sur le roman”. Agnès SPIQUEL ed. 2000. 192 p. 20 €. ISBN 978-2-256-91012-8
Pp. 121–8 : L’Écriture et l’interminable : l’enjeu du texte chez Marguerite Duras, par Bernard ALAZET.
Le « Nouveau Roman » en questions 5 : “Une ‘Nouvelle Autobiographie’?”. Roger-Michel ALLEMAND et Christian MILAT eds. 2004. 306 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/« L’Icosathèque » 22. 25 €. ISBN 978-2-256-91078-4
Pp. 75–90 : Duras, Annaud et L’Amant, par Eileen M. ANGELINI.
Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines ? 1”. Johan FAERBER ed. 2008. 286 p. Coll. « La Revue des lettres modernes ». 28 €. ISBN 978-2-256-91138-5
Pp. 135–47 : Vestiges de l’amour, ou l’amour en ruines dans L’Amour de Marguerite Duras, par Sylvie LOIGNON.
lire & voir 2 : “de l’autoportrait à l’autobiographie”, textes réunis et présentés par Jan BAETENS et Alexander STREITBERGER, « La Revue des Lettres modernes », 2009.
Pp. 75–82 : Marguerite Duras : le langage comme événement, par Barbara BRAY.
Le « Nouveau Roman » en questions 1 : “‘Nouveau Roman’ et archétypes”. Roger-Michel ALLEMAND ed. 1992. VI + 156 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/ « L’Icosathèque 13 ». 20€. ISBN 978-2-256-90903-0
Pp. 13–60 : L’Amour fou, femme fatale, Marguerite Duras : une récriture sublime des archétypes les mieux établis en littérature,
par Mireille CALLE-GRUBER.
Le « Nouveau Roman » en questions 2 : “ ‘Nouveau Roman’ et archétypes 2”. Roger-Michel ALLEMAND ed.
1993. 202 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/« L’Icosathèque 14 ». 25€. ISBN 978-2-256-90929-0
Pp. 121–62 : L’Écriture de Duras ou la récriture du livre : L’Amant de la Chine du Nord ou « L’Amant recommencé », par Béatrice
BONHOMME.
Études romanesques 4. “L’Autre du roman et de la fiction”. Jean BESSIÈRE ed. 1996. 226 p. 30,50 €. ISBN 978-2-256-90962-7
Pp. 51–74 : Apories contemporaines du narratif et fable féminine : Anaïs Nin, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Elsa Morante,
par Jean BESSIÈRE.
Le « Nouveau Roman » en questions 3 : “Le Créateur et la Cité”. Roger-Michel ALLEMAND ed. 1999. 202 p. Coll. « La Revue des lettres modernes » /« L’Icosathèque 16 ». 23,40€. ISBN 978-2-256-91000-5
Pp. 33–62 : Duras : d’une écriture politique à une écriture du politique, par Madeleine BORGOMANO.
Pp. 127–54 : Marguerite Duras et le « Nouveau Roman », par Christiane BLOT-LABARRÈRE.
Études romanesques 6. “Dialogue franco-ukrainien sur le roman”. Agnès SPIQUEL ed. 2000. 192 p. 20 €. ISBN 978-2-256-91012-8
Pp. 121–8 : L’Écriture et l’interminable : l’enjeu du texte chez Marguerite Duras, par Bernard ALAZET.
Le « Nouveau Roman » en questions 5 : “Une ‘Nouvelle Autobiographie’?”. Roger-Michel ALLEMAND et Christian MILAT eds. 2004. 306 p. Coll. « La Revue des lettres modernes »/« L’Icosathèque » 22. 25 €. ISBN 978-2-256-91078-4
Pp. 75–90 : Duras, Annaud et L’Amant, par Eileen M. ANGELINI.
Le « Nouveau Roman » en questions 6 : “Vers une écriture des ruines ? 1”. Johan FAERBER ed. 2008. 286 p. Coll. « La Revue des lettres modernes ». 28 €. ISBN 978-2-256-91138-5
Pp. 135–47 : Vestiges de l’amour, ou l’amour en ruines dans L’Amour de Marguerite Duras, par Sylvie LOIGNON.
lire & voir 2 : “de l’autoportrait à l’autobiographie”, textes réunis et présentés par Jan BAETENS et Alexander STREITBERGER, « La Revue des Lettres modernes », 2009.
Série fondée et dirigée par Bernard ALAZET (2004-2017)
dirigée par Sylvie LOIGNON (2018-) dans La Revue des Lettres modernes
dirigée par Sylvie LOIGNON (2018-) dans La Revue des Lettres modernes