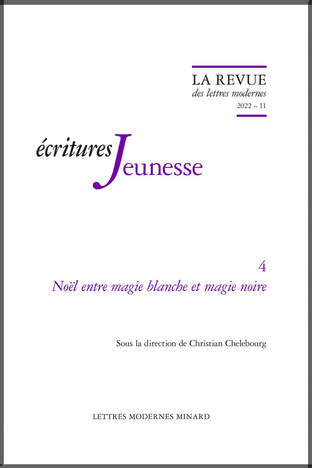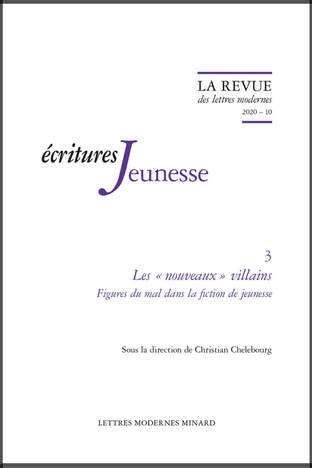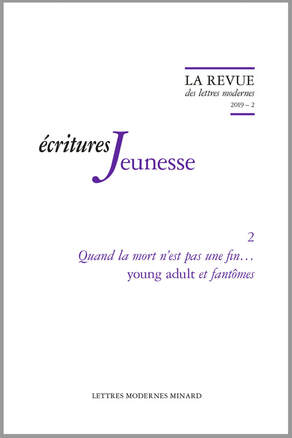Série Écritures jeunesse
Dir. Christian Chelebourg (2010)
La création d’une Série dans La Revue des Lettres Modernes consacrée à la littérature et aux productions artistiques destinées à la jeunesse répond à la volonté d’étudier l’ensemble de ce corpus à l’instar d’œuvres artistiques reconnues. De là le choix de l’aborder sous l’angle de l’écriture ou plutôt des écritures, étant donné le nombre de médias et de genres concernés : roman, poésie, théâtre, bande dessinée, cinéma, dessins animés, jeux vidéo, produits dérivés, etc. À l’heure où la littérature de jeunesse s’installe à l’Université, il nous a semblé nécessaire d’accompagner cette évolution en l’inscrivant de façon claire dans le champ de la recherche herméneutique. Il nous a paru également utile de la relier d’emblée aux autres médias artistiques ou « médiarts » qui lui sont connexes et déclinent volontiers la même matière, à la faveur de multiples logiques d’adaptation dont le texte n’est plus toujours le foyer d’origine. Ce pragmatisme est d’ailleurs récompensé par l’ouverture à de nouvelles formes de création, à des nouvelles expériences du langage et de son rapport à l’image, comme à de nouveaux questionnements critiques; et ajoutons qu’il n’y a pas de fatalité à ce qu’un produit, fût-il dûment formaté, ne soit également une réelle œuvre d’art. Au risque de choquer, rappelons que les pièces du théâtre classique subissaient elles-mêmes des contraintes formelles et thématiques auxquelles les codes des producteurs ou les prétendues exigences du marché n’ont rien à envier sous le rapport de la rigidité.
Conformément à ce souci de respect des œuvres abordées, Écritures jeunesse prônera qu’elles soient étudiées, autant que possible, dans leur langue d’origine. La Série fera également en sorte de s’intéresser aussi bien à la littérature de jeunesse déjà partiellement «légitimée» par son ancienneté, sa recommandation scolaire ou sa diffusion auprès du public adulte, qu’aux productions récentes, les plus récréatives, les moins évidemment susceptibles d’être un jour reconnues par les instances de patrimonialisation des produits culturels. Elle s’intéressera tantôt à des thématiques, tantôt à des auteurs ou des genres. Il s’agira d’englober dans son ensemble un corpus aussi vaste que varié, protéiforme et difficilement délimitable puisqu’il s’étend des albums pour les plus petits aux lectures transgressives des plus grands, lesquelles empiètent assez largement sur la littérature populaire.
Dans ce vaste champ, il est un thème qui peut servir de repère à un premier balisage de la littérature et des films de jeunesse, c’est la représentation de cette même jeunesse. Depuis le XVIIIe siècle, au moins, un livre pour la jeunesse est très volontiers un livre qui met en scène des enfants ou de jeunes personnages. Les autres médias, en ce domaine, ont très largement repris le procédé. Les productions pour la jeunesse reposent majoritairement sur une logique projective qui tend à faire vivre leur public par procuration; de là leur succès dans le domaine de l’évasion, de l’aventure ou des tendres idylles, aussi bien que leurs usages compassionnels ou exemplaires chers aux pédagogues et aux moralistes de tout poil.
Représenter la jeunesse pour elle-même, telle est l’une des principales fonctions assignées au corpus du premier volume. Les études en analysent les principes, les contraintes et les résultantes autour des trois questions nodales du sexe et de la sexualité, de l’âge et de l’accès à la maturité, des valeurs et de leur mise en œuvre, trois problématiques à forte potentialité projective, et comme telles puissamment impliquées dans la poétique des productions à destination de la jeunesse.
Christian CHELEBOURG
Écritures jeunesse 4 : “Noël, entre magie blanche et magie noire”
Commander en ligne ici.
Série Écritures jeunesse
Écritures jeunesse 3 : “Les ‘Nouveaux’ villains : figures du mal dans la littérature de jeunesse
|
Avant-propos, par Nathalie DUFAYET I. LE GRAND MÉCHANT LOUP D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 1. « Entre inhumanité et déshumanisation : le personnage du Loup Boche en 1914-1918 », par Thaïs BIHOUR 2. « Le Trois Petits Cochons et le Grand Méchant Loup : la rencontre entre deux archétypes », par Lison JOUSTEN 3. « Mais qui a encore peur du Grand Méchant Loup ? », par Marion DUVAL 4. « La nostalgie des loups : réintroduire la sauvagerie en ville ? », par Alice BRIÈRE-HAQUET 5. « Le loup est revenu : le “nouveau” visage du loup dans le conte du Petit Chaperon Rouge », par Mathilde BRISSONNET-TEYSSÉDOU |
II. INVERSIONS CARNAVALESQUES : LE MÉCHANT, DU RIRE, AUX LARMES
6. Sympathy for the Evil : méchanceté relative dans les adaptations de contes de fées au xxie siècle », par Mirta CIMMINO
7. « “Après la première mort…” : l’irruption des Enfants de la Nuit dans Laisse-moi entrer (John Lindqvist), Ma Chère Grand-mère (Catherine Brighton) et La Balafre (Jean-Claude Mourlevat) », par Isabelle-Rachel CASTA
8. « Le méchant au cœur des contradictions de la fiction de jeunesse », par Nicole Wells
9. « De l’autre côté de la porte : monstres enfantins et enfants monstrueux dans Monstres & Cie et Monstres Academy », par Roland CARRÉE
10. « Au bout de la méchanceté : mères meurtrières et enfants assassins dans le conte traditionnel », par Bochra CHARNAY
11. « Les Méchants ordinaires dans le roman réaliste pour la jeunesse », par Violaine BEYRON
12. « Le Docteur Facilier dans La Princesse et la grenouille : enjeux idéologiques de la représentation du premier méchant noir par Disney », par Marine CELLIER
III. L’HOMME, LA BÊTE ET J. K. ROWLING
13. « Harry Potter : du méchant de l’histoire à l’histoire du méchant », par Éric AURIACOMBE
14. « Lord Voldemort : “le villain aux mille visages” », par Nathalie DUFAYET
15. « Méchanceté, mystère et rédemption : regards croisés sur Severus Snape et Mrs Coulter », par Isabelle OLIVIER
Commandez en ligne ici.
6. Sympathy for the Evil : méchanceté relative dans les adaptations de contes de fées au xxie siècle », par Mirta CIMMINO
7. « “Après la première mort…” : l’irruption des Enfants de la Nuit dans Laisse-moi entrer (John Lindqvist), Ma Chère Grand-mère (Catherine Brighton) et La Balafre (Jean-Claude Mourlevat) », par Isabelle-Rachel CASTA
8. « Le méchant au cœur des contradictions de la fiction de jeunesse », par Nicole Wells
9. « De l’autre côté de la porte : monstres enfantins et enfants monstrueux dans Monstres & Cie et Monstres Academy », par Roland CARRÉE
10. « Au bout de la méchanceté : mères meurtrières et enfants assassins dans le conte traditionnel », par Bochra CHARNAY
11. « Les Méchants ordinaires dans le roman réaliste pour la jeunesse », par Violaine BEYRON
12. « Le Docteur Facilier dans La Princesse et la grenouille : enjeux idéologiques de la représentation du premier méchant noir par Disney », par Marine CELLIER
III. L’HOMME, LA BÊTE ET J. K. ROWLING
13. « Harry Potter : du méchant de l’histoire à l’histoire du méchant », par Éric AURIACOMBE
14. « Lord Voldemort : “le villain aux mille visages” », par Nathalie DUFAYET
15. « Méchanceté, mystère et rédemption : regards croisés sur Severus Snape et Mrs Coulter », par Isabelle OLIVIER
Commandez en ligne ici.
Série Écritures jeunesse
Écritures jeunesse 2 : “Quand la mort n'est pas une fin… young adult et fantômes”
|
Contrairement à ce que signale l’expérientiel anthropologique, la mort n’est pas la fin… de tout ; en culture de jeunesse (littérature, sérialité, films, mangas….) elle représente parfois même le nouveau commencement, d’une survie ou d’un autre monde, où la figure du revenant se décline multiplement ; c’est la variété de ces occurrences (simple impulsion électrique sur un écran de smartphone ou surgissement, en corps, dans la cuisine de parents endeuillés) que les dix études explorent ici, en présentant non seulement des cas romanesques ou filmiques de contacts avec l’au-delà, mais aussi une plus vaste et juvénile « clinique du fantôme » (le mot est de Serge Tisseron). Zombies, vampires et spectres actualisent en effet une espérance, déguisée en terreur : que la perte soit réversible, et les lois naturelles… transcendées.
|
Sommaire
Avant-propos, par Isabelle Rachel CASTA
1. “Forever young” ? La mortalité comme issue heureuse dans la fantasy jeunesse contemporaine…, par Anne BESSON
2. « Bébé veut manger maman. » Dialectique de l’enfant en territoire zombie, par Lucie GROETZINGER
3. « Dis, quand on est mort, c’est pour la vie ? » Représentations thanatologiques dans les classiques d’animation Disney,
par Apolline LEHMANN
4. Être ou ne pas être un fantôme : Tom’s Midnight Garden ou de quelques codes en littérature de jeunesse, par Hélène WEIS
5. L’immortalité, « grain de sable dans l’univers ». Fantaisie autour du cycle de Ji, par Luce ROUDIER
6. Vertiges et fantasmes d’immortalité : L’Ève future, première intelligence artificielle, par Valérie TRITTER
7. « La mort est ton cadeau » : Des fantômes et des esprits dans la série télévisée fantastique, par Mathieu PIERRE
8. Thaumaturges, golems et autres automates, par Thierry JANDROK
9. Orphée et les reflets : chagrin et chimères, par Guillaume SIOLY
10. Kieren, Victor, Jill, Lily… “sans” les autres : dans les Jardins d’Israël il ne faisait jamais nuit, par Isabelle Rachel CASTA
Commander en ligne ici.
1. “Forever young” ? La mortalité comme issue heureuse dans la fantasy jeunesse contemporaine…, par Anne BESSON
2. « Bébé veut manger maman. » Dialectique de l’enfant en territoire zombie, par Lucie GROETZINGER
3. « Dis, quand on est mort, c’est pour la vie ? » Représentations thanatologiques dans les classiques d’animation Disney,
par Apolline LEHMANN
4. Être ou ne pas être un fantôme : Tom’s Midnight Garden ou de quelques codes en littérature de jeunesse, par Hélène WEIS
5. L’immortalité, « grain de sable dans l’univers ». Fantaisie autour du cycle de Ji, par Luce ROUDIER
6. Vertiges et fantasmes d’immortalité : L’Ève future, première intelligence artificielle, par Valérie TRITTER
7. « La mort est ton cadeau » : Des fantômes et des esprits dans la série télévisée fantastique, par Mathieu PIERRE
8. Thaumaturges, golems et autres automates, par Thierry JANDROK
9. Orphée et les reflets : chagrin et chimères, par Guillaume SIOLY
10. Kieren, Victor, Jill, Lily… “sans” les autres : dans les Jardins d’Israël il ne faisait jamais nuit, par Isabelle Rachel CASTA
Commander en ligne ici.
Série Écritures jeunesse
Écritures jeunesse 1 : "représenter la jeunesse pour elle-même"
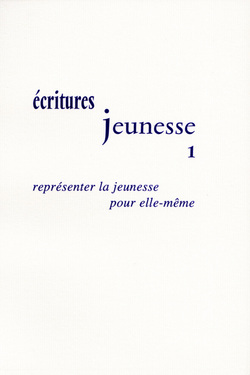
Il est un thème qui peut servir de repère à un premier balisage de la littérature et des films de jeunesse, c’est la représentation de cette même jeunesse. Depuis le XVIIIe siècle, au moins, un livre pour la jeunesse est très volontiers un livre qui met en scène des enfants ou de jeunes personnages. Les autres médias, en ce domaine, ont très largement repris le procédé. Les productions pour la jeunesse reposent majoritairement sur une logique projective qui tend à faire vivre leur public par procuration ; de là leur succès dans le domaine de l’évasion, de l’aventure ou des tendres idylles, aussi bien que leurs usages compassionnels ou exemplaires chers aux pédagogues et aux moralistes de tout poil. Représenter la jeunesse pour elle-même, telle est l’une des principales fonctions assignées à ce corpus. Les études qui suivent en analysent les principes, les contraintes et les résultantes autour des trois questions nodales du sexe et de la sexualité, de l’âge et de l’accès à la maturité, des valeurs et de leur mise en œuvre, trois problématiques à forte potentialité projective, et comme telles puissamment impliquées dans la poétique des productions à destination de la jeunesse.
Sommaire
SEXE(S).
1. Être ou ne pas être une fille en littérature de jeunesse — survie des stéréotypes et nouvelles explorations, par Danièle HENKY.
2. Du livre au film : la part du frère dans Tout contre Léo de Christophe Honoré, par Marc ARINO.
3. La Littérature de jeunesse québécoise et l’hypersexualisation des adolescents, par Daniel CHOUINARD.
ÂGE(S).
4. L’Adolescence en danger ou le monde selon Joe Dante, par Danièle ANDRÉ
5. Le Cyberpunk latino-américain : critiques de la puérilité, par Juan Ignacio Munoz ZAPATA.
6. « Devenir celle que tu dois être » — héroïsme et destin dans les romans d’Érik L’Homme, par Katia ARGAND.
7. Apocalypse, sceau de l’enfer, pop-corn et scoubidou — l’étrange jeunesse de Buffy, la tueuse de vampires, par Isabelle-Rachel CASTA.
VALEUR(S).
8. Le Prince Éric de Serge Dalens : jeune fauve ou enfant roi ?, par Laurent DÉOM.
9. L’Enfance en guerre dans « Les Livres Roses de la Guerre », 1914–1918, par Laurence OLIVIER-MESSONNIER.
10. “Tu m’as menti! Mais moi aussi!” — poétique du mensonge dans la littérature de jeunesse contemporaine, par Christian CHELEBOURG.
Carnet critique, par Christian CHELEBOURG.
Écritures jeunesse 1 : “Représenter la jeunesse pour elle-même”. Christian Chelebourg ed. avec la collaboration de Danièle André et Danièle Henky. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 198 p. 19 €
ISBN 978-2-256-91154-5
1. Être ou ne pas être une fille en littérature de jeunesse — survie des stéréotypes et nouvelles explorations, par Danièle HENKY.
2. Du livre au film : la part du frère dans Tout contre Léo de Christophe Honoré, par Marc ARINO.
3. La Littérature de jeunesse québécoise et l’hypersexualisation des adolescents, par Daniel CHOUINARD.
ÂGE(S).
4. L’Adolescence en danger ou le monde selon Joe Dante, par Danièle ANDRÉ
5. Le Cyberpunk latino-américain : critiques de la puérilité, par Juan Ignacio Munoz ZAPATA.
6. « Devenir celle que tu dois être » — héroïsme et destin dans les romans d’Érik L’Homme, par Katia ARGAND.
7. Apocalypse, sceau de l’enfer, pop-corn et scoubidou — l’étrange jeunesse de Buffy, la tueuse de vampires, par Isabelle-Rachel CASTA.
VALEUR(S).
8. Le Prince Éric de Serge Dalens : jeune fauve ou enfant roi ?, par Laurent DÉOM.
9. L’Enfance en guerre dans « Les Livres Roses de la Guerre », 1914–1918, par Laurence OLIVIER-MESSONNIER.
10. “Tu m’as menti! Mais moi aussi!” — poétique du mensonge dans la littérature de jeunesse contemporaine, par Christian CHELEBOURG.
Carnet critique, par Christian CHELEBOURG.
Écritures jeunesse 1 : “Représenter la jeunesse pour elle-même”. Christian Chelebourg ed. avec la collaboration de Danièle André et Danièle Henky. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 198 p. 19 €
ISBN 978-2-256-91154-5