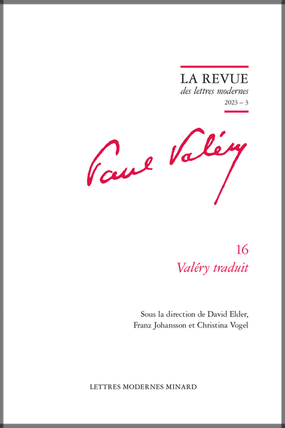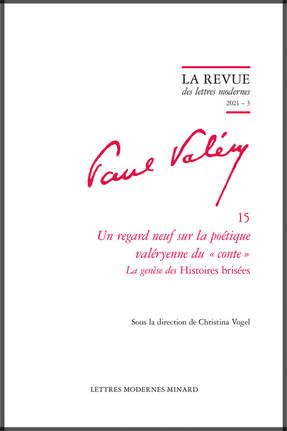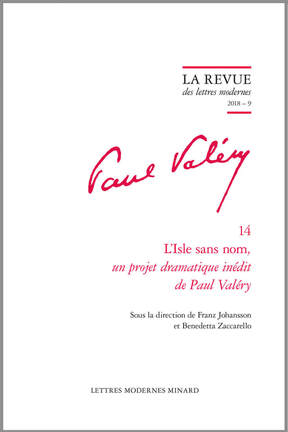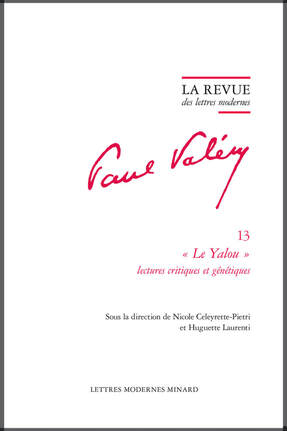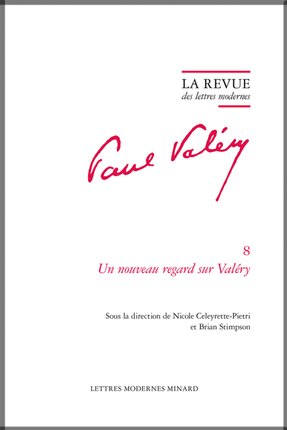Série Paul Valéry
Dir. C. Vogel (2014)
Paul Valéry se soustrait à toutes les tentatives d’identification et de classification. Sa conviction, selon laquelle « d’être plusieurs c’est l’essence de l’homme » (Cahiers, X, 709), n’a rien d’abstrait, il l’a vécue comme une expérience constamment présente. Véritable Protée, toujours autre et ailleurs, il s’exerce comme poète, penseur, écrivain ou encore comme essayiste, mais à aucun moment il ne se laisse enfermer et saisir dans un de ces rôles.
Depuis qu’une équipe internationale a entrepris, dans les années quatre-vingts, sous la direction de Nicole Celeyrette-Pietri, l’édition intégrale des Cahiers 1894-1914 de Valéry, ce n’est plus seulement l’auteur de Monsieur Teste, de La Jeune Parque, du dialogue Eupalinos, des recueils Variété et Tel Quel qui fait l’admiration des lecteurs et éveille l’intérêt des chercheurs, mais un Valéry plus secret et solitaire, s’adonnant chaque matin à une « Autodiscussion infinie ». À côté du théoricien qui note, dès l’aube, ses réflexions sur les sciences, la philosophie, la psychologie, la poïétique ou le langage, on y découvre l’homme sensible qui interroge le corps, la mémoire, le rêve ou encore Éros. Inachevée par essence, cette écriture, qui reste très mal connue dans son ensemble, continue à susciter des analyses conduites dans différentes perspectives théoriques et méthodologiques.
Que l’œuvre parue du vivant de Valéry ne représente qu’une infime partie de tout ce qu’il a esquissé, ébauché, écrit sans jamais le publier, c’est ce que l’équipe « Valéry » de l’Institut des Textes et Manuscrits modernes (CNRS/ENS) met en évidence, en s’attachant à étudier, à partir de manuscrits inédits, le processus de genèse des textes valéryens. Réunissant des chercheurs venant de divers pays (France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Irlande, Japon, entre autres) le groupe de travail de l’ITEM a réussi à renouveler et à complexifier aussi bien l’image de Valéry que la compréhension de son œuvre protéiforme.
La Série Paul Valéry de la « Revue des Lettres modernes » se propose de faire connaître les résultats des nombreux travaux consacrés à un homme dont l’œuvre – loin d’être accomplie et fermée sur elle-même – se présente comme un chantier en devenir, appelé à révéler les pouvoirs de création qui sont en puissance et n’attendent qu’une chose : leur actualisation et compréhension dans la succession de leurs continuelles transformations. Notre objectif est d’offrir un forum international où les chercheurs, jeunes et chevronnés, pourront diffuser leurs découvertes, mettre en discussion leurs interprétations et échanger leurs points de vue en expérimentant différentes approches critiques.
Christina VOGEL
Depuis qu’une équipe internationale a entrepris, dans les années quatre-vingts, sous la direction de Nicole Celeyrette-Pietri, l’édition intégrale des Cahiers 1894-1914 de Valéry, ce n’est plus seulement l’auteur de Monsieur Teste, de La Jeune Parque, du dialogue Eupalinos, des recueils Variété et Tel Quel qui fait l’admiration des lecteurs et éveille l’intérêt des chercheurs, mais un Valéry plus secret et solitaire, s’adonnant chaque matin à une « Autodiscussion infinie ». À côté du théoricien qui note, dès l’aube, ses réflexions sur les sciences, la philosophie, la psychologie, la poïétique ou le langage, on y découvre l’homme sensible qui interroge le corps, la mémoire, le rêve ou encore Éros. Inachevée par essence, cette écriture, qui reste très mal connue dans son ensemble, continue à susciter des analyses conduites dans différentes perspectives théoriques et méthodologiques.
Que l’œuvre parue du vivant de Valéry ne représente qu’une infime partie de tout ce qu’il a esquissé, ébauché, écrit sans jamais le publier, c’est ce que l’équipe « Valéry » de l’Institut des Textes et Manuscrits modernes (CNRS/ENS) met en évidence, en s’attachant à étudier, à partir de manuscrits inédits, le processus de genèse des textes valéryens. Réunissant des chercheurs venant de divers pays (France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Irlande, Japon, entre autres) le groupe de travail de l’ITEM a réussi à renouveler et à complexifier aussi bien l’image de Valéry que la compréhension de son œuvre protéiforme.
La Série Paul Valéry de la « Revue des Lettres modernes » se propose de faire connaître les résultats des nombreux travaux consacrés à un homme dont l’œuvre – loin d’être accomplie et fermée sur elle-même – se présente comme un chantier en devenir, appelé à révéler les pouvoirs de création qui sont en puissance et n’attendent qu’une chose : leur actualisation et compréhension dans la succession de leurs continuelles transformations. Notre objectif est d’offrir un forum international où les chercheurs, jeunes et chevronnés, pourront diffuser leurs découvertes, mettre en discussion leurs interprétations et échanger leurs points de vue en expérimentant différentes approches critiques.
Christina VOGEL
Valéry traduit
Paul Valéry 16
|
Les poèmes et pensées de Paul Valéry sont traduits de son vivant, entre autres par le poète Rainer Maria Rilke, et ils continuent, de nos jours, à faire l’objet de vastes projets de traduction. Ceux et celles qui traduisent les Œuvres et les Cahiers de Valéry en allemand, en anglais, en arabe, en italien ou en portugais ne doivent pas seulement résoudre de nombreux problèmes – conceptuels, linguistiques, stylistiques – mais encore prendre en considération le contexte – culturel, social, politique – qui influence la réception de leurs traductions.
Or Valéry traduit lui-même. Sa traduction des Bucoliques de Virgile, entreprise entre 1942 et 1944 pour une société de bibliophiles, est le produit le plus connu de ses efforts de traducteur. Moins connus sont les ébauches et les essais de traduction inachevés qui témoignent de l’attention qu’il a portée, toute sa vie, à l’activité de traduire. En effet, Valéry considère la traduction comme une opération mentale de base. Loin de s’intéresser uniquement à la transposition d’un texte d’une langue dans une autre, il développe, dans un souci génétique, une véritable théorie de la pratique du traduire. Le présent volume éclaire le lien entre Valéry et la traduction sous ces angles différents et il montre son besoin vital de saisir les phénomènes en les traduisant en son propre langage. Christina VOGEL |
Sommaire
Préface / Preface, par David ELDER, Franz JOHANSSON, Christina VOGEL
1. (Se) traduire en mode self / Translate into self mode, par Micheline HONTEBEYRIE
2. Vers une traduction des refus dans la pensée de Paul Valéry / Towards a translation of refusals in the thought of Paul Valéry, par David ELDER
3. Aux confins de l’unique / On the borders of the unique, par Jean HAINAUT
4. La Voix du discours écrit dans la traduction en anglais des Cahiers de Valéry /
The Voice of written speech in the English translation of Valéry's Cahiers/Notebooks, par Brian STIMPSON
5. Traduire Valéry en italien / Translating Valery into Italian, par Maria Teresa GIAVERI. Entretien avec Paola CATTANI
6. Valéry traduit en allemand : les Œuvres, les Cahiers, les Principes d’an-archie / Valéry translated into German: Valéry’s Works, Notebooks, Principles of anarchy, par Jürgen SCHMIDT-RADEFELDT
7. Situation de Valéry à travers les traductions brésiliennes depuis les années 1950 /
Valéry’s Position as seen through the Brazilian translations since the 1950s, par Álvaro FALEIROS, Roberto ZULAR
8. Vers une anthropologie valéryenne de l´écriture : une poïétique pour la traduction des Cahiers au Brésil / Towards a Valeryan anthropology of writing: a poetics for the translation of the Notebooks in Brazil, par Roberto ZULAR, Fabio Roberto LUCAS
9. Paul Valéry en arabe : entre imitation et création / Paul Valéry in Arabic: between imitation and creation, par Jacqueline COURIER-BRIÈRE
10. Rilke traducteur de Valéry : la fin de l’attente / Rilke translates Valéry: the end of the wait, par Christina VOGEL
11. Ébauche d’une histoire de la traduction des Bucoliques / Draft of a history of the translation of Les Bucoliques, par Franck JAVOUREZ
12. Les Bucoliques de Virgile traduites par Paul Valéry : une expérience totale / Virgil’s Bucolics (Eclogues) translated by Paul Valéry: a total experience, par Jacqueline COURIER-BRIÈRE
13. Paul Valéry et The Red Badge of Courage – An Episode of the American Civil War (Stephen Crane, 1895) / Paul Valéry and The Red Badge of Courage – An Episode of the American Civil War (Stephen Crane, 1895), par Robert PICKERING
14. Neige sur la Baltique : une traduction sans original ? / Neige sur la Baltique: a translation without an original, par Antonietta SANNA
Commander en ligne ici.
1. (Se) traduire en mode self / Translate into self mode, par Micheline HONTEBEYRIE
2. Vers une traduction des refus dans la pensée de Paul Valéry / Towards a translation of refusals in the thought of Paul Valéry, par David ELDER
3. Aux confins de l’unique / On the borders of the unique, par Jean HAINAUT
4. La Voix du discours écrit dans la traduction en anglais des Cahiers de Valéry /
The Voice of written speech in the English translation of Valéry's Cahiers/Notebooks, par Brian STIMPSON
5. Traduire Valéry en italien / Translating Valery into Italian, par Maria Teresa GIAVERI. Entretien avec Paola CATTANI
6. Valéry traduit en allemand : les Œuvres, les Cahiers, les Principes d’an-archie / Valéry translated into German: Valéry’s Works, Notebooks, Principles of anarchy, par Jürgen SCHMIDT-RADEFELDT
7. Situation de Valéry à travers les traductions brésiliennes depuis les années 1950 /
Valéry’s Position as seen through the Brazilian translations since the 1950s, par Álvaro FALEIROS, Roberto ZULAR
8. Vers une anthropologie valéryenne de l´écriture : une poïétique pour la traduction des Cahiers au Brésil / Towards a Valeryan anthropology of writing: a poetics for the translation of the Notebooks in Brazil, par Roberto ZULAR, Fabio Roberto LUCAS
9. Paul Valéry en arabe : entre imitation et création / Paul Valéry in Arabic: between imitation and creation, par Jacqueline COURIER-BRIÈRE
10. Rilke traducteur de Valéry : la fin de l’attente / Rilke translates Valéry: the end of the wait, par Christina VOGEL
11. Ébauche d’une histoire de la traduction des Bucoliques / Draft of a history of the translation of Les Bucoliques, par Franck JAVOUREZ
12. Les Bucoliques de Virgile traduites par Paul Valéry : une expérience totale / Virgil’s Bucolics (Eclogues) translated by Paul Valéry: a total experience, par Jacqueline COURIER-BRIÈRE
13. Paul Valéry et The Red Badge of Courage – An Episode of the American Civil War (Stephen Crane, 1895) / Paul Valéry and The Red Badge of Courage – An Episode of the American Civil War (Stephen Crane, 1895), par Robert PICKERING
14. Neige sur la Baltique : une traduction sans original ? / Neige sur la Baltique: a translation without an original, par Antonietta SANNA
Commander en ligne ici.
Un regard neuf sur la poétique valéryenne du “conte”
La genèse des Histoires brisées
Paul Valéry 15
|
Ce n’est que la partie émergée d’un immense iceberg que les éditions des Histoires brisées nous donnent à lire. Cette livraison en dévoile pour la première fois la partie cachée : un chantier d’écriture aux innombrables esquisses inédites que Valéry présente lui-même comme un « recueil paradoxal de fragments, de commencements ».
Soustraire le conte aux caprices du hasard et aux interventions incontrôlables du lecteur, c’est l’objectif d’une prose qui se veut rigoureuse et parfaite tout en parcourant la totalité des mondes fictifs possibles. En acceptant la proposition de Gaston Gallimard qui, en 1923, lui demande de faire « un roman cérébral et sensuel», Valéry saisit l’occasion d’écrire des contes capables de communiquer une sorte de « sensibilité intellectuelle ». Tandis que des débuts de récit naissent facilement sous sa plume, leurs prolongements, voire achèvements s’avèrent difficiles et soulèvent d’énormes problèmes esthétiques. Les onze études réunies dans le volume 15 éclairent, dans différentes perspectives complémentaires, des aspects essentiels de ces Histoires brisées : les unes abordent leur genèse et leur composition complexes, la tradition littéraire dont le recueil hérite ou les variations autour de certains thèmes privilégiés ; les autres interrogent le genre poétique et l’unité de ces ébauches fort hétérogènes, analysent une fiction mêlant la narration |
concrète à la théorisation abstraite, révèlent les éléments d’une écriture autobiographique déguisée ou encore les enjeux d’une dialectique du Même et de l’Autre. Or toutes concourent à montrer que le conte valéryen ne finit pas de réfléchir ses propres effets et conditions de production, n’hésitant pas à briser les barrières de nos catégories littéraires.
Christina VOGEL
Christina VOGEL
Sommaire
Préface. Les Histoires brisées, fragments d’une poétique valéryenne du conte / Preface. The Histoires brisées, Fragments of a Valéryan poetics of the tale, par Christina VOGEL
1. Des « Histoires brisées » aux Histoires brisées. Une genèse en question(s) / From “broken stories” to the Histoires brisées. A genesis in question(s), par Micheline HONTEBEYRIE
2. Du conte symboliste aux Histoires brisées / From the symbolist tale to the Histoires brisées, par Frank JAVOUREZ
3. Ceci n’est pas un récit. Suite de variations sur « Robinson » / This is not a story. Successive variations on “Robinson”, par Brian STIMPSON
4. « ACEM », raconter la théorie – théoriser le conte / “ACEM”, Narrating theory – theorizing the tale, par Christina VOGEL
5. Les personae de Valéry dans le cahier Agar ou les « masques d’un même » /Valéry’s personae in the Agar notebook or “masks to match”,
par Rémi FURLANETTO
6. Paul Valéry, l’histoire – conte de l’Autre-Soi / Paul Valéry, the story – tale of the Other-Self, par Micheline HONTEBEYRIE
7. Le Jouteur de Sète et la Révélation anagogique des Histoires brisées / The jouster of Sète and the Anagogical Revelation in the Histoires brisées,
par Jean HAINAUT
8. « Au commencement était la Fable ». Éléments d’une poétique valéryenne du conte / “In the beginning was the Fable”. Elements of a Valéryan
poetics of the tale, par Fabienne MÉREL
9. Auctor et lector in fabula. Figurations des acteurs d’une poétique dans les Histoires brisées / Auctor et lector in fabula. Representing the actors
of a poetics in the Histoires brisées, par Franz JOHANSSON
10. Contes et Histoires en construction. Théories en gestation / Tales and Stories under construction. Theories in the making, par Jacqueline
COURIER-BRIÈRE
11. Le phénomène, la poïétique et la « sensibilité intellectuelle » chez Valéry. Traduire « Rachel » / The phenomenon, poiesis, and “intellectual
sensibility” in Valéry. Translating “Rachel”, par David ELDER
Commander en ligne ici.
1. Des « Histoires brisées » aux Histoires brisées. Une genèse en question(s) / From “broken stories” to the Histoires brisées. A genesis in question(s), par Micheline HONTEBEYRIE
2. Du conte symboliste aux Histoires brisées / From the symbolist tale to the Histoires brisées, par Frank JAVOUREZ
3. Ceci n’est pas un récit. Suite de variations sur « Robinson » / This is not a story. Successive variations on “Robinson”, par Brian STIMPSON
4. « ACEM », raconter la théorie – théoriser le conte / “ACEM”, Narrating theory – theorizing the tale, par Christina VOGEL
5. Les personae de Valéry dans le cahier Agar ou les « masques d’un même » /Valéry’s personae in the Agar notebook or “masks to match”,
par Rémi FURLANETTO
6. Paul Valéry, l’histoire – conte de l’Autre-Soi / Paul Valéry, the story – tale of the Other-Self, par Micheline HONTEBEYRIE
7. Le Jouteur de Sète et la Révélation anagogique des Histoires brisées / The jouster of Sète and the Anagogical Revelation in the Histoires brisées,
par Jean HAINAUT
8. « Au commencement était la Fable ». Éléments d’une poétique valéryenne du conte / “In the beginning was the Fable”. Elements of a Valéryan
poetics of the tale, par Fabienne MÉREL
9. Auctor et lector in fabula. Figurations des acteurs d’une poétique dans les Histoires brisées / Auctor et lector in fabula. Representing the actors
of a poetics in the Histoires brisées, par Franz JOHANSSON
10. Contes et Histoires en construction. Théories en gestation / Tales and Stories under construction. Theories in the making, par Jacqueline
COURIER-BRIÈRE
11. Le phénomène, la poïétique et la « sensibilité intellectuelle » chez Valéry. Traduire « Rachel » / The phenomenon, poiesis, and “intellectual
sensibility” in Valéry. Translating “Rachel”, par David ELDER
Commander en ligne ici.
L'Isle sans nom
Un projet dramatique inédite de Paul Valéry
Paul Valéry 14
|
Les douze études constituant cet ouvrage explorent un projet de Paul Valéry resté pratiquement inconnu à ce jour : L’Isle sans nom. Elles montrent comment, sous la forme aussi réjouissante qu’inattendue d’un « conte pour la scène », ce chantier se nourrit des problématiques les plus importantes – et, parfois, les plus secrètes – de la pensée valéryenne : le motif romanesque d’un naufragé amnésique offre à l’écrivain l’occasion de donner corps à l’expérience de la « tabula rasa » qui lui est chère, de même qu’une géographie de fantaisie lui permet de montrer, au sein d’une fable politique, les crises latentes et les fantômes de l’Europe de 1936.
Sommaire
Préface par Benedetta Zaccarello
I. CARTOGRAPHIE DE L'ÎLE SANS NOM 1. L’Odyssée de “l’Homme-tout-nu” : lecture en filigrane, par Micheline Hontebeyrie 2. Un portrait sans nom, par Michel Jarrety 3. Les méandres d’une dramaturgie, par Franz Johansson 4. Valéry et le “flux de la vie matérielle” : une lecture de L’Isle sans nom comme scénario, par Jean-Louis Jeannelle |
II. LE NOMINALISME EN QUESTION
5. Variations autour du Moi et du Je sans attributs de L’Isle sans nom, par David Elder
6. Aspects du nominalisme valéryen dans L’Isle sans nom, par Thomas Vercruysse
7. L’acte de nommer : entre oubli et mémoire, par Christina Vogel
III. LA CITÉ ET L'INDIVIDU À « L'HEURE DE LA MER CONFUSE »
8. L’Isle sans nom : peinture du désordre, ruine de la fiducia, par Barbara Scapolo
9. L’Isle sans nom : “antipolitique lente” sur scène ?, par Antonietta Sanna
10. La table rase ou la mémoire impersonnelle dans L’Isle sans nom, par Masahiko Kimura
11. Perte et prise de corps », par Émilie Roger
Commander en ligne ici.
5. Variations autour du Moi et du Je sans attributs de L’Isle sans nom, par David Elder
6. Aspects du nominalisme valéryen dans L’Isle sans nom, par Thomas Vercruysse
7. L’acte de nommer : entre oubli et mémoire, par Christina Vogel
III. LA CITÉ ET L'INDIVIDU À « L'HEURE DE LA MER CONFUSE »
8. L’Isle sans nom : peinture du désordre, ruine de la fiducia, par Barbara Scapolo
9. L’Isle sans nom : “antipolitique lente” sur scène ?, par Antonietta Sanna
10. La table rase ou la mémoire impersonnelle dans L’Isle sans nom, par Masahiko Kimura
11. Perte et prise de corps », par Émilie Roger
Commander en ligne ici.
Paul Valéry 13 : “Le Yalou”
lectures critiques et génétiques
|
in memoriam Huguette Laurenti
avant-propos, par Nicole Celeyrette-Pietri et Huguette Laurenti 1. “Le Yalou” : aperçu du dossier, par Françoise Haffner. 2. Éléments de bibliographie, par Régine Pietra. 3. Glose en aparté autour de la genèse d’un fac-similé, par Micheline Hontebeyrie. 4. L’Espace marin, une génétique des commencements, «Le Yalou», par Huguette Laurenti. 5. Intertextualité et poésie dans «Le Yalou», par Françoise Haffner. 6. Écriture, imaginaire et métaphore, une lecture du “Yalou”, par Tatsuya Tagami. 7. Le Sage chinois, le barbare civilisé et la pensée du Tao, par Isabelle Combes. 8. La Recherche difficile d’une frontière pendulaire entre Occident et Orient. Quelques observations en marge du “Yalou”, par Barbara Scapolo. 9. Préoccupations politiques et métapolitiques dans «Le Yalou», par Nicole Celeyrette-Pietri. 10. Quelques choses du “Yalou”, par Jean-Philippe Biehler. |
Keep smiling, par Monique Allain-Castrillo.
Document : Transcriptions des feuillets reproduits du “Yalou”, par Françoise Haffner et Huguette Laurenti.
Paul Valéry 13 : “‘Le Yalou’ — lectures critiques et génétiques”. Nicole Celeyrette-Pietri et Huguette Laurenti eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. vi + 270 p. 25 € ISBN 978-2-256-91151-4
RÉIMPRESSION : commander en ligne ici.
Document : Transcriptions des feuillets reproduits du “Yalou”, par Françoise Haffner et Huguette Laurenti.
Paul Valéry 13 : “‘Le Yalou’ — lectures critiques et génétiques”. Nicole Celeyrette-Pietri et Huguette Laurenti eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. vi + 270 p. 25 € ISBN 978-2-256-91151-4
RÉIMPRESSION : commander en ligne ici.
Paul Valéry 12 : image, imagination, imaginaire
autour de Valéry
avant-propos, par Sang-Tai Kim
I. POÉSIE, PEINTURE ET IMAGINAIRE COMPARÉ
1. «Dessiner virtuellement» : l’autoportrait chez Valéry et Degas, par Brian Stimpson.
2. Lecture imaginative de Léonard de Vinci chez le jeune Valéry, par Kunio Tsunekawa.
3. Les Serpents enroulés de Paul Valéry et La Fleur des amants d’André Breton, par Sang-Tai Kim.
4. Imaginaire ascendant, imaginaire descendant : étude comparée de l’image de l’arbre chez Valéry, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud et
Baudelaire, par Hai-Young Park.
5. La Réception de Paul Valéry en Corée : traits valéryens dans la poésie de Suk-Cho Shin, par Kye-Jin Lee.
6. L’Imagination selon Poe et Valéry : un concept clé de l’analyse des phénomènes psychiques, par Karl Alfred Blüher.
II. IMAGINATION ET CRÉATION POÉTIQUE
7. L’Imaginaire prophétique de l’histoire chez Valéry, par Ynhui Park.
8. La Théorie de l’ornement et l’abstraction chez Valéry, par Jürgen Schmidt-Radefeldt.
9. Réflexions sur les contes de Valéry : Valéry lecteur de Villiers de L’Isle-Adam, par Toshinao Nakamura.
10. Valéry et l’imaginaire mathématique, par Andrea Pasquino.
11. Le Langage du rêve, le langage d’images, par Masanori Tsukamoto.
III. IMAGINAIRE ABSTRAIT, IMAGINAIRE, MYSTIQUE
12. L’Imaginaire abstrait et le “Système”, par Nicole Celeyrette-Pietri.
13. L’Imaginaire de la source-origine, par Paul Gifford.
14. Du regard iconoclaste de M. Teste dans la “Soirée”, par Anna Lo Giudice.
15. La Danse divine ou érotique chez Paul Valéry, par Kwang-Heam Jeang.
16. L’Espace imaginaire et le problème de l’inconscient chez Valéry, par Atsuo Morimoto.
IV. IMAGINAIRE DE LA CRÉATION
17. L’Imaginaire théâtral de Paul Valéry, par Huguette Laurenti.
18. Imagination et inspiration, par Monique Allain-Castrillo.
19. Valéry et la limite de l’intuition spatiale, par Tatsuya Tagami.
20. «Les Hésitations de la marquise» : Valéry, le roman et l’imaginaire de l’incipit, par Niels Buch-Leander.
V. GÉNÉALOGIE DES IMAGES
21. Du voyage en ballon au saut à l’élastique, par Régine Pietra.
22. Édition et électronique : les Cahiers de Valéry comme base de données, par Pascal Michelucci.
23. L’Image du mystère dans La Jeune Parque, par Huldrych Thomann.
24. L’Image de la souffrance chez Paul Valéry : l’image d’un soi volontaire, par Kyung-Ha Kim.
25. Le Phantasme de la morsure : l’ouverture sur l’imaginaire — à propos de La Jeune Parque de Valéry, par Cornelia Klettke.
Paul Valéry 12 : “Image, imagination, imaginaire autour de Valéry”. Sang-Tai Kim ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 312 p. 25 € ISBN 978-2-256-91115-6
I. POÉSIE, PEINTURE ET IMAGINAIRE COMPARÉ
1. «Dessiner virtuellement» : l’autoportrait chez Valéry et Degas, par Brian Stimpson.
2. Lecture imaginative de Léonard de Vinci chez le jeune Valéry, par Kunio Tsunekawa.
3. Les Serpents enroulés de Paul Valéry et La Fleur des amants d’André Breton, par Sang-Tai Kim.
4. Imaginaire ascendant, imaginaire descendant : étude comparée de l’image de l’arbre chez Valéry, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud et
Baudelaire, par Hai-Young Park.
5. La Réception de Paul Valéry en Corée : traits valéryens dans la poésie de Suk-Cho Shin, par Kye-Jin Lee.
6. L’Imagination selon Poe et Valéry : un concept clé de l’analyse des phénomènes psychiques, par Karl Alfred Blüher.
II. IMAGINATION ET CRÉATION POÉTIQUE
7. L’Imaginaire prophétique de l’histoire chez Valéry, par Ynhui Park.
8. La Théorie de l’ornement et l’abstraction chez Valéry, par Jürgen Schmidt-Radefeldt.
9. Réflexions sur les contes de Valéry : Valéry lecteur de Villiers de L’Isle-Adam, par Toshinao Nakamura.
10. Valéry et l’imaginaire mathématique, par Andrea Pasquino.
11. Le Langage du rêve, le langage d’images, par Masanori Tsukamoto.
III. IMAGINAIRE ABSTRAIT, IMAGINAIRE, MYSTIQUE
12. L’Imaginaire abstrait et le “Système”, par Nicole Celeyrette-Pietri.
13. L’Imaginaire de la source-origine, par Paul Gifford.
14. Du regard iconoclaste de M. Teste dans la “Soirée”, par Anna Lo Giudice.
15. La Danse divine ou érotique chez Paul Valéry, par Kwang-Heam Jeang.
16. L’Espace imaginaire et le problème de l’inconscient chez Valéry, par Atsuo Morimoto.
IV. IMAGINAIRE DE LA CRÉATION
17. L’Imaginaire théâtral de Paul Valéry, par Huguette Laurenti.
18. Imagination et inspiration, par Monique Allain-Castrillo.
19. Valéry et la limite de l’intuition spatiale, par Tatsuya Tagami.
20. «Les Hésitations de la marquise» : Valéry, le roman et l’imaginaire de l’incipit, par Niels Buch-Leander.
V. GÉNÉALOGIE DES IMAGES
21. Du voyage en ballon au saut à l’élastique, par Régine Pietra.
22. Édition et électronique : les Cahiers de Valéry comme base de données, par Pascal Michelucci.
23. L’Image du mystère dans La Jeune Parque, par Huldrych Thomann.
24. L’Image de la souffrance chez Paul Valéry : l’image d’un soi volontaire, par Kyung-Ha Kim.
25. Le Phantasme de la morsure : l’ouverture sur l’imaginaire — à propos de La Jeune Parque de Valéry, par Cornelia Klettke.
Paul Valéry 12 : “Image, imagination, imaginaire autour de Valéry”. Sang-Tai Kim ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 312 p. 25 € ISBN 978-2-256-91115-6
Paul Valéry 11 : La Jeune Parque
des brouillons au poème nouvelles lectures génétiques
avant-propos, par Françoise Haffner, Micheline Hontebeyrie et Robert Pickering.
1. Transcrire le dossier de La Jeune Parque, par Nicole CELEYRETTE-PIETRI.
2. Le Contexte scriptural de La Jeune Parque (1913–1917), par M. HONTEBEYRIE.
3. De La Jeune Parque à Album de vers anciens et vice versa — de la source au commencement, par Régine PIETRA.
4. De “Igitur” à La Jeune Parque — le destin d’une ombre, par Laurent MATTIUSSI.
5. La Fulgurance de 1913 et “l’embryon fécondé ” de La Jeune Parque, par Paul GIFFORD.
6. « Sans arrimage et arrimé » — réminiscences et rémanences (Paul Valéry et saint Jean de la Croix), par Monique ALLAIN-CASTRILLO.
7. Profondeur et clarté : le statut du moi dans les brouillons de La Jeune Parque, par Benedetta ZACCARELLO.
8. Modulation et substitution (analyse du dossier de brouillons JPmsIII, ff. 3, 23, 24, 25, 25vo, 33), par Jacqueline COURIER-BRIÈRE.
9. Grammaire et genèse — le travail syntaxique dans les brouillons de La Jeune Parque, par William MARX.
10. Rimer — (se) mirer — le rôle génétique des rimes dans les brouillons de La Jeune Parque, par M. HONTEBEYRIE.
11. Les «Fréquences» d’un esprit — une génétique de l’imaginaire, par Huguette LAURENTI.
12. La “parole intérieure” : conditions d’émergence — de la conceptualisation à la dynamique créatrice. — Annexe : La “parole intérieure” chez
Valéry, relevé des principaux éléments de définition, par R. PICKERING.
Paul Valéry 11 : “ ‘La Jeune Parque’, des brouillons au poème — nouvelles lectures génétiques”. Françoise Haffner, Micheline Hontebeyrie et Robert Pickering eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 242 p. 23 €
1. Transcrire le dossier de La Jeune Parque, par Nicole CELEYRETTE-PIETRI.
2. Le Contexte scriptural de La Jeune Parque (1913–1917), par M. HONTEBEYRIE.
3. De La Jeune Parque à Album de vers anciens et vice versa — de la source au commencement, par Régine PIETRA.
4. De “Igitur” à La Jeune Parque — le destin d’une ombre, par Laurent MATTIUSSI.
5. La Fulgurance de 1913 et “l’embryon fécondé ” de La Jeune Parque, par Paul GIFFORD.
6. « Sans arrimage et arrimé » — réminiscences et rémanences (Paul Valéry et saint Jean de la Croix), par Monique ALLAIN-CASTRILLO.
7. Profondeur et clarté : le statut du moi dans les brouillons de La Jeune Parque, par Benedetta ZACCARELLO.
8. Modulation et substitution (analyse du dossier de brouillons JPmsIII, ff. 3, 23, 24, 25, 25vo, 33), par Jacqueline COURIER-BRIÈRE.
9. Grammaire et genèse — le travail syntaxique dans les brouillons de La Jeune Parque, par William MARX.
10. Rimer — (se) mirer — le rôle génétique des rimes dans les brouillons de La Jeune Parque, par M. HONTEBEYRIE.
11. Les «Fréquences» d’un esprit — une génétique de l’imaginaire, par Huguette LAURENTI.
12. La “parole intérieure” : conditions d’émergence — de la conceptualisation à la dynamique créatrice. — Annexe : La “parole intérieure” chez
Valéry, relevé des principaux éléments de définition, par R. PICKERING.
Paul Valéry 11 : “ ‘La Jeune Parque’, des brouillons au poème — nouvelles lectures génétiques”. Françoise Haffner, Micheline Hontebeyrie et Robert Pickering eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 242 p. 23 €
Paul Valéry 8 : Un nouveau regard sur Valéry
|
1. Valéry et la sincérité, par Daniel OSTER
2. Quel homme veut-on ?, par Pierre JOURDAN 3. Valéry inactuel, par Régine PIETRA 4. L’approche transdisciplinaire de Valéry et les « deux cultures », par Jürgen SCHMIDT-RADEFELDT 5. Un nouveau regard sur les cahiers, par Judith ROBINSON-VALÉRY 6. L’écriture informe dans les Cahiers, par Shuhsi KAO 7. Écrire comme on efface, par Jean-Marc HOUPERT 8. Composer continu et discontinu : modulation et fragmentation dans l’écriture valéryenne, par Brian STIMPSON 9. Agathe, utopie de la pulsion sémiotique Valéryenne, par Kunio TSUNEKAWA 10. Alphabet, « Une cosmochronie fondamentale », par Maria Teresa GIAVERI 11. Graphie, calligraphie : l’esthétique valéryenne et l’acte d’écrire, par Robert PICKERING 12. Le ballet-théâtre valéryenne, par Huguette LAURENTI 13. Une scène pour le poème, par Antonietta SANNA 14. L’anamnèse dans La Jeune Parque, par Florence de LUSSY 15. Muthos, Eros, Logos : Valéry et la mythopoésie du désir, par Paul GIFFORD 16. Le musée chez Valéry, par Claude FOUCART 17. Valéry et les philosophes, par Gilbert KAHN 18. La physique du corps : le dépassement dépassé ?, par Harmut KÖHLER 19. La « connaissance de la connaissance », par Nicole CELEYRETTE-PIETRI |
RÉIMPRESSION : commander en ligne ici.
Paul Valéry 8 : “Un Nouveau regard sur Valéry”. Rencontres de Cerisy (26 août–5 septembre 1992). Nicole Celeyrette-Pietri et Brian Stimpson eds. 1995. 292 p. 34 € ISBN 978-2-256-90949-8
Paul Valéry 8 : “Un Nouveau regard sur Valéry”. Rencontres de Cerisy (26 août–5 septembre 1992). Nicole Celeyrette-Pietri et Brian Stimpson eds. 1995. 292 p. 34 € ISBN 978-2-256-90949-8
Volumes antérieurs
Paul Valéry 1 : “Lectures de ‘Charmes’”. 1974. 224 p. 15,70 € ISBN 978-2-256-90118-8
Paul Valéry 2 : “Recherches sur ‘La Jeune Parque’ ”. 1977. 200 p. 14,70 € ISBN 978-2-256-90132-4
Paul Valéry 3 : “Approche du ‘Système’ ”. 1979. 224 p. 18,20 € ISBN 978-2-256-90141-6
Paul Valéry 4 : “Le Pouvoir de l’esprit”. 1983. 184 p. 18 € ISBN 978-2-256-90161-4
Paul Valéry 5 : “Musique et architecture”. 1987. 192 p. 18,20 € ISBN 978-2-256-90192-8
Paul Valéry 6 : “ ‘Mare Nostrum’, Valéry et le monde méditerranéen”. 1989. 228 p. 23,80 € ISBN 978-2-256-90876-7
Paul Valéry 7 : “Valéry et le ‘monde actuel’ ”. 1993. 154 p. 24,30 € ISBN 978-2-256-90924-5
Paul Valéry 8 : “Un Nouveau regard sur Valéry”. Rencontres de Cerisy (26 août–5 septembre 1992). Nicole Celeyrette-Pietri et Brian Stimpson eds. 1995. 292 p. 34 € ISBN 978-2-256-90949-8
Paul Valéry 9 : “Autour des Cahiers”. 1999. 208 p. 23,40 € ISBN 978-2-256-91005-0
Paul Valéry 10 : “Du théâtre — la Scène et le Symbole”. 2003. 174 p. 20 € ISBN 978-2-256-91057-9
Paul Valéry 2 : “Recherches sur ‘La Jeune Parque’ ”. 1977. 200 p. 14,70 € ISBN 978-2-256-90132-4
Paul Valéry 3 : “Approche du ‘Système’ ”. 1979. 224 p. 18,20 € ISBN 978-2-256-90141-6
Paul Valéry 4 : “Le Pouvoir de l’esprit”. 1983. 184 p. 18 € ISBN 978-2-256-90161-4
Paul Valéry 5 : “Musique et architecture”. 1987. 192 p. 18,20 € ISBN 978-2-256-90192-8
Paul Valéry 6 : “ ‘Mare Nostrum’, Valéry et le monde méditerranéen”. 1989. 228 p. 23,80 € ISBN 978-2-256-90876-7
Paul Valéry 7 : “Valéry et le ‘monde actuel’ ”. 1993. 154 p. 24,30 € ISBN 978-2-256-90924-5
Paul Valéry 8 : “Un Nouveau regard sur Valéry”. Rencontres de Cerisy (26 août–5 septembre 1992). Nicole Celeyrette-Pietri et Brian Stimpson eds. 1995. 292 p. 34 € ISBN 978-2-256-90949-8
Paul Valéry 9 : “Autour des Cahiers”. 1999. 208 p. 23,40 € ISBN 978-2-256-91005-0
Paul Valéry 10 : “Du théâtre — la Scène et le Symbole”. 2003. 174 p. 20 € ISBN 978-2-256-91057-9
Autres titres publiés sur Paul Valéry
HONTEBEYRIE, Micheline. Paul Valéry — deux projets de prose poétique : « Alphabet » et « Le Manuscrit trouvé dans une cervelle ». Coll. « Archives des lettres modernes 275 ». 1999. 148 p. 21,80 € ISBN 978-2-256-90469-1
LECUYER, Maurice A., Étude de la prose de Paul Valéry dans La Soirée avec Monsieur Teste, « Archives des lettres modernes », n° 55, 1964, 56 p.
LUSSY, Florence de, L’Univers formel de la poésie chez Valéry, ou la recherche d’une morphologie généralisée. 1987. Coll. « Archives des lettres modernes 226 », « Archives Paul Valéry » , n° 7.
PICKERING, Robert, Genèse du concept valérien “pouvoir” et “conquête méthodique” de l’écriture. Coll. « Archives des lettres modernes 243 », « Archives Paul Valéry », n° 8, 1990.
YESCHUA, Silvio. Valéry, le roman et l’œuvre à faire. 1977, Coll. « Bibliothèque des lettres modernes 26 ». ISBN 978-2-256-90774-6
Problèmes du langage chez Valéry (Cahiers et œuvres, 1894-1900), Textes réunis par Nicole CELEYRETT-PIETRI. Coll. « Archives des lettres modernes 225 », « Archives Paul Valéry n° 6 ». 1987.
Valéry : dossier de notes manuscrites inédites pour “Le Souper de Singapour”, transcrit et commenté par Huguette LAURENTI. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. « Archives des lettres modernes » 287 / « Archives Paul Valéry 10 ». Un volume broché, rogné 19 cm. 112 p. 20€ ISBN 978-2-256-90481-3
LECUYER, Maurice A., Étude de la prose de Paul Valéry dans La Soirée avec Monsieur Teste, « Archives des lettres modernes », n° 55, 1964, 56 p.
LUSSY, Florence de, L’Univers formel de la poésie chez Valéry, ou la recherche d’une morphologie généralisée. 1987. Coll. « Archives des lettres modernes 226 », « Archives Paul Valéry » , n° 7.
PICKERING, Robert, Genèse du concept valérien “pouvoir” et “conquête méthodique” de l’écriture. Coll. « Archives des lettres modernes 243 », « Archives Paul Valéry », n° 8, 1990.
YESCHUA, Silvio. Valéry, le roman et l’œuvre à faire. 1977, Coll. « Bibliothèque des lettres modernes 26 ». ISBN 978-2-256-90774-6
Problèmes du langage chez Valéry (Cahiers et œuvres, 1894-1900), Textes réunis par Nicole CELEYRETT-PIETRI. Coll. « Archives des lettres modernes 225 », « Archives Paul Valéry n° 6 ». 1987.
Valéry : dossier de notes manuscrites inédites pour “Le Souper de Singapour”, transcrit et commenté par Huguette LAURENTI. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. « Archives des lettres modernes » 287 / « Archives Paul Valéry 10 ». Un volume broché, rogné 19 cm. 112 p. 20€ ISBN 978-2-256-90481-3
série fondée, dirigée et éditée (1974) par Huguette LAURENTI
dirigée et éditée par Robert Pickering (2004-2013)
dirigée et éditée par Christina Vogel (2014)
dirigée et éditée par Robert Pickering (2004-2013)
dirigée et éditée par Christina Vogel (2014)