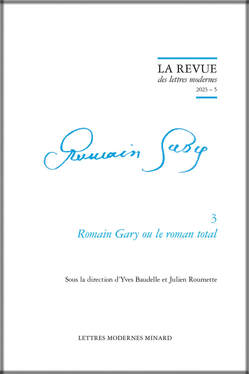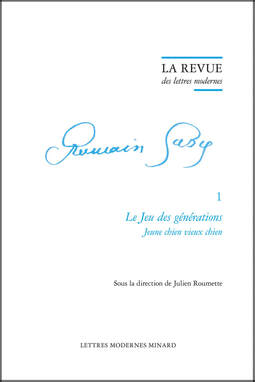Série Romain Gary
Dir. Julien Roumette (2010)
Après un long silence, l’Université s’éveille aujourd’hui à l’œuvre de Romain Gary. Avec le recul, on commence à voir que celle-ci compte dans la littérature française d’après-guerre, d’autant plus qu’elle est en dehors des courants littéraires principaux. Sa singularité, qui a sans doute retardé sa reconnaissance, en fait aujourd’hui le prix : sa personnalité exubérante, ses choix politiques, son passé de héros de la guerre, sa conception de l’écriture et du roman à rebours de celles qui font école, ses rapports conflictuels avec le monde de l’édition, avec le “monde du livre”… L’invention d’Ajar, à cause de son exceptionnelle réussite, a sans doute mis le comble à ces malentendus. On a cherché à retrouver la personnalité de Gary dans le double littéraire qu’il s’était créé plus qu’on n’a étudié les œuvres.
L’étrange est que le monde universitaire ait emboîté le pas à la critique et, si longtemps, dénié à l’œuvre une dimension littéraire de premier plan. Dans son essai Pour Sganarelle, paru en 1965, Gary a pourtant présenté une réflexion théorique originale sur le roman. On ne prit pas seulement la peine de la discuter. Les universitaires des années 1960 et 1970, à quelques très rares exceptions près, surtout à l’étranger, l’ont passé sous silence, avec le reste de ses livres — jusque dans les années 1990.
Après quelques initiatives isolées, en 1995, Nancy Huston publie son hommage, Tombeau de Romain Gary (1995). En 1997, Jean-François Hangouët fonde l’association « Les Mille Gary », qui se donnait pour but l’inventaire et la promotion de l’œuvre. Le mouvement s’accélère à partir du tournant des années 2000. Plusieurs thèses sont publiées. Un volume des Cahiers de l’Herne, dirigé par Paul Audi et Jean-François Hangouët, apporte une vue d’ensemble de ces recherches, en 2004. Accompagnant ces publications, plusieurs colloques ont été organisés. Plusieurs thèses sont actuellement en cours ou viennent d’être soutenues. Les livres scolaires et universitaires se sont limités à trois titres (La Promesse de l’aube, La Vie devant soi et Les Racines du ciel). Trente ans après sa mort, si les œuvres de Romain Gary continuent à être beaucoup lues (elles n’ont jamais cessé de l’être), si elles sont enseignées dans les lycées depuis longtemps (notamment La Promesse de l’aube, La Vie devant soi et Chien blanc), elles ne le sont toujours que très peu à l’université.
Les critiques se sont concentrés jusqu’ici principalement sur les problématiques de l’identité. D’une part, s’agissant du double visage Gary/Ajar, l’accent est mis, selon les perspectives, sur le goût du travestissement ou sur une tendance à la schizophrénie. C’est l’image de Gary “caméléon”. D’autre part, le philosophe Paul Audi interroge, notamment, le rapport de Gary à la judéité, à travers une lecture de son idéalisme à la lumière de la notion de messianisme.
Les études les plus convaincantes embrassant généralement l’œuvre entière, l’analyse de chaque livre y est réduite à de trop rapides esquisses. Des aspects entiers de l’œuvre ne sont que très peu abordés.
Nourri de littératures russe et anglo-saxonne, Gary a fait entendre dans la littérature française des tonalités qui y sont peu représentées. Plaçant l’imagination au-dessus du travail du style, développant une théorie du comique plus attachée à la tradition juive d’Europe centrale qu’à la conception française, il a renouvelé le roman à sa manière, sans renoncer au récit ni aux personnages. Traçant avec persévérance et lucidité son propre chemin, il l’a poursuivi à travers près d’une trentaine de titres. Au-delà du jeu sur les pseudonymes, son œuvre frappe par son ambition et son unité. C’est à montrer la cohérence de cet itinéraire par l’étude attentive des œuvres que nous voulons consacrer cette Série.
Julien Roumette
Romain Gary 3 : “Romain Gary ou le roman total”
SommaireIntroduction. Romain Gary ou le roman total / Introduction. Romain Gary or the total novel, par Yves BAUDELLE, Julien ROUMETTE 1. Stratégie océan bleu : saisir l’originalité de Romain Gary / Blue Ocean Strategy. Grasping the Originality of Romain Gary, par Jørn BOISEN 2. « La boîte de couleurs » défendue ou la tentation picturale de Romain Gary / The Forbidden “box of colors” or the Pictorial Temptation of Romain Gary, par Julien ROUMETTE 3. Pour Sganarelle et le Nouveau Roman : la métafiction de Gengis Cohn / Pour Sganarelle and the Nouveau Roman : The Metafiction of Genghis Cohn, par Ruth DIVER 4. Méditer le roman avec Romain Gary dans Pour Sganarelle / Meditate on the Novel with Romain Gary in Pour Sganarelle, par Astrid POIER-BERNHARD 5. Romain Gary, la réalité, échec et mat ? / RomainGary, Reality, Checkmate ?, par Maxime DECOUT |
6. Les voix de l’absence : la polyphonie du skaz chez Gary / The Voices of Absence : The Polyphony of Skaz in Gary’s Work, par Sophie BERNARD-LÉGER
7. Aux sources du soufisme des Racines du ciel et de La Vie devant soi, Émile Dermenghem /To the Sources of Sufism in The Roots of Heaven and The Life Before Us, Emile DermengheM, par Jean-François HANGOUËT
8. Du premier amour au livre posthume : Romain Gary et la création recommencée / From First Love to Posthumous Book : Romain Gary and the Renewal of Creation, par Anne MORANGE
9. Géographies américaines de Romain Gary / American Geographies in Romain Gary’s Works, par Carine PERREUR
10. Lilly Sauter, première traductrice de Romain Gary en allemand / Lilly Sauter, First Translator of Romain Gary’s Works into German, par Karl ZIEGER
11. Du gaullisme littéraire de Romain Gary / On Romain Gary’s Literary Gaullism, par Kerwin SPIRE
12. Romain Gary face aux pouvoirs de la bêtise : Totoche, Filoche et leurs disciples / Romain Gary Facing the Powers of Stupidity : Totoche, Filoche and Their Disciples, par Nicolas GELAS
Commander en ligne ici.
7. Aux sources du soufisme des Racines du ciel et de La Vie devant soi, Émile Dermenghem /To the Sources of Sufism in The Roots of Heaven and The Life Before Us, Emile DermengheM, par Jean-François HANGOUËT
8. Du premier amour au livre posthume : Romain Gary et la création recommencée / From First Love to Posthumous Book : Romain Gary and the Renewal of Creation, par Anne MORANGE
9. Géographies américaines de Romain Gary / American Geographies in Romain Gary’s Works, par Carine PERREUR
10. Lilly Sauter, première traductrice de Romain Gary en allemand / Lilly Sauter, First Translator of Romain Gary’s Works into German, par Karl ZIEGER
11. Du gaullisme littéraire de Romain Gary / On Romain Gary’s Literary Gaullism, par Kerwin SPIRE
12. Romain Gary face aux pouvoirs de la bêtise : Totoche, Filoche et leurs disciples / Romain Gary Facing the Powers of Stupidity : Totoche, Filoche and Their Disciples, par Nicolas GELAS
Commander en ligne ici.
Romain Gary 2 : “Picaros et paumés : voyous, prostituées,
maquereaux, vagabonds dans l'œuvre de Gary”
|
Dans Pour Sganarelle, Gary fait du picaresque la notion clé de sa conception du roman. Plus qu’à un genre, il se réfère à un type de personnage : le picaro. Voyous, prostituées, maquereaux, vagabonds peuplent ses romans, avec en filigrane la figure de l’auteur. Pourtant, le roman picaresque n’est pas un véritable modèle littéraire pour Gary. L’idéalisme est trop ancré en lui. La figure du « paumé », marginal d’une autre façon, par désir d’aliénation, contrebalance le cynisme lucide et intéressé du picaro. Ce volume précise le sens de la référence picaresque chez Gary : ancrage dans des traditions littéraires (américaine, russe, française), originalités (référence à Teilhard de Chardin) et figures privilégiées (Jésus, Judas, le Juif errant).
|
Sommaire
picaros et paumés, par Julien ROUMETTE
1. Les Racines américaines du picaresque garyen — des hobos au confidence man, par Carine PERREUR.
2. Filles de Lioubov : Gary et les prostituées littéraires russes, par Ruth DIVER.
3. La Généalogie introuvable du «picaresque» selon Gary, par Hélène BATY-DELALANDE.
4. Picaros et pédoncules : Gary et Teilhard de Chardin — du «phénomène humain» à l’«affaire homme», par Jean- François HANGOUËT.
5. Portrait de l’écrivain en picaro, par Jean-Marie CATONNÉ.
6. Romanesque et marginalité chez Romain Gary — résister au réel, par Nicolas GELAS.
7. Le picaro, l’esthétique garyenne, par Hyun-Hee KIM.
8. Gary et la légende du Juif errant, par Jean-Marie CATONNÉ.
9. La Danse de Judas et du Christ dans l’œuvre de Gary ou les réécritures picaresques du mythe de l’homme au pays de Mickey Mouse, par
Maxime DECOUT.
10. Gary et James Baldwin — les salauds, les paumés et les «frères de race» dans Chien Blanc, par Julien ROUMETTE.
Picaros et paumés : voyous, prostituées, maquereaux, vagabonds dans l'œuvre de Gary (Romain Gary 2), Julien ROUMETTE (ed.). Paris, Lettres Modernes Minard, 2014. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, 15 x 22 x 1,3 cm, 235 p. 24 €. ISBN 978-2-8124-3114-2.
Commander en ligne ici.
1. Les Racines américaines du picaresque garyen — des hobos au confidence man, par Carine PERREUR.
2. Filles de Lioubov : Gary et les prostituées littéraires russes, par Ruth DIVER.
3. La Généalogie introuvable du «picaresque» selon Gary, par Hélène BATY-DELALANDE.
4. Picaros et pédoncules : Gary et Teilhard de Chardin — du «phénomène humain» à l’«affaire homme», par Jean- François HANGOUËT.
5. Portrait de l’écrivain en picaro, par Jean-Marie CATONNÉ.
6. Romanesque et marginalité chez Romain Gary — résister au réel, par Nicolas GELAS.
7. Le picaro, l’esthétique garyenne, par Hyun-Hee KIM.
8. Gary et la légende du Juif errant, par Jean-Marie CATONNÉ.
9. La Danse de Judas et du Christ dans l’œuvre de Gary ou les réécritures picaresques du mythe de l’homme au pays de Mickey Mouse, par
Maxime DECOUT.
10. Gary et James Baldwin — les salauds, les paumés et les «frères de race» dans Chien Blanc, par Julien ROUMETTE.
Picaros et paumés : voyous, prostituées, maquereaux, vagabonds dans l'œuvre de Gary (Romain Gary 2), Julien ROUMETTE (ed.). Paris, Lettres Modernes Minard, 2014. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, 15 x 22 x 1,3 cm, 235 p. 24 €. ISBN 978-2-8124-3114-2.
Commander en ligne ici.
Romain Gary 1 : "Le jeu des générations – jeune chien vieux chien"
|
« La vie est jeune », écrit Gary dans La Promesse de l’aube. L’attention aux phénomènes de génération est une constante de son œuvre. Parce qu’il a fait partie d’une génération qui s’est forgée et imposée dans l’action, cette notion est, pour lui, essentielle. Homme de la France Libre, il n’a eu de cesse de proclamer sa fidélité à la fraternité combattante de 1940.
Mais Gary ne s’enferme pas dans la commémoration de ce qu’il a vécu. Sa fidélité à sa fratrie, paradoxalement, l’ouvre aux autres générations. Il a mis toute sa lucidité à percevoir ce qui habitait en propre chacune de celles qu’il a croisées ensuite, des adolescents d’après-guerre à la jeunesse américaine des années Soixante, puis à celle de la France des années Soixante-Dix, allant même jusqu’à en incarner une des voix marquantes sous le pseudonyme d’Ajar. Fait exceptionnel, par son attention à la jeunesse, Gary a ainsi été l’écrivain de plusieurs générations. À l’articulation de deux générations se jouent les notions d’héritage, de transmission, de révolte, de succession par la révolte, etc. Chez Gary, elle est marquée par l’absence, la révolte et les adoptions : absence des parents, la plupart des héros garyens sont orphelins ; |
révoltes, refus de transmission, refus des héritages, refus de transmettre ; mais aussi possibilité d’établir des liens : les sauts de génération – combien de figures grand-paternelles chez Gary ? – facilitent sinon la transmission du moins une forme d’entente fraternelle. De la fraternité combattante, celle de l’armée ou celle de la bande, de l’amour absolu qui cimente une union pour la vie dès l’enfance, à la fraternité et à l’amour entre jeunes et vieux, Gary dessine une cosmographie originale des rapports générationnels.
Dans ce volume, une première série d’études est consacrée à situer Romain Gary dans sa génération. Un second ensemble s’attache à la représentation de l’enfance, ainsi qu’au sens et à la place de l’image de l’orphelin. Enfin, sont posées les questions des rapports entre les générations.
Dans ce volume, une première série d’études est consacrée à situer Romain Gary dans sa génération. Un second ensemble s’attache à la représentation de l’enfance, ainsi qu’au sens et à la place de l’image de l’orphelin. Enfin, sont posées les questions des rapports entre les générations.
Sommaire
avant-propos, par Julien Roumette
1. Gary et le deuil de la France Libre — une amertume féconde, par Julien Roumette.
2. Gary et l’héritage républicain, par Jean-Marie Catonné.
3. La Fraternité à l’œuvre, par Jean-François Hangouët.
4. L’Expérience liminaire de la perte paternelle chez Gary — réécritures et variations, par Katia Cikalovski.
5. Les Mythes de l’enfance : modèles autobiographiques russes de Romain Gary, par Ruth Diver.
6. Inspiration et renouveau du «maître d’école» chez Gary — le jeune instituteur et la vieille armée, par Anne Morange.
7. “Tombé du nid” : Adieu Gary Cooper ou l’homme sans héritages, par Firyel Abdeljaouad.
Témoignage :
Gary, Sartre et Faulkner : tresses et détresses de l’Orphelin, par Paul Rozenberg.
Romain Gary 1 : “Le Jeu des générations — jeune chien vieux chien”. Julien Roumette ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 210 p. 20 € ISBN 978-2-256-91160-6.
À nouveau disponible. Commander ici.
1. Gary et le deuil de la France Libre — une amertume féconde, par Julien Roumette.
2. Gary et l’héritage républicain, par Jean-Marie Catonné.
3. La Fraternité à l’œuvre, par Jean-François Hangouët.
4. L’Expérience liminaire de la perte paternelle chez Gary — réécritures et variations, par Katia Cikalovski.
5. Les Mythes de l’enfance : modèles autobiographiques russes de Romain Gary, par Ruth Diver.
6. Inspiration et renouveau du «maître d’école» chez Gary — le jeune instituteur et la vieille armée, par Anne Morange.
7. “Tombé du nid” : Adieu Gary Cooper ou l’homme sans héritages, par Firyel Abdeljaouad.
Témoignage :
Gary, Sartre et Faulkner : tresses et détresses de l’Orphelin, par Paul Rozenberg.
Romain Gary 1 : “Le Jeu des générations — jeune chien vieux chien”. Julien Roumette ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 210 p. 20 € ISBN 978-2-256-91160-6.
À nouveau disponible. Commander ici.