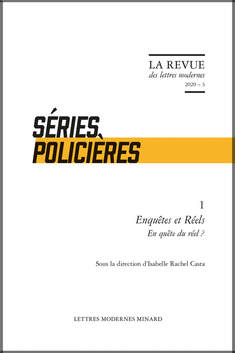Séries policières
Dir. Isabelle Casta (2020)
Longtemps minorée, la critique du “milieu” policier (au sens quasi naturaliste du terme) est depuis vingt ans devenue tellement systématique, riche et nuancée, qu’au enfin qui salua les premières thèses (Régis Messac, Charles Grivel, Jacques Dubois…) succède quasiment un encore… un peu goguenard mais cependant plein d’attente qui accueille toute nouvelle proposition sur le domaine.
Alors risquons l’aventure, voire la double aventure du polar et de la sérialité, autrement dit du crime fictionnel et de sa thématisation multiple, réitérée, schématisée selon des rythmes et des codes que les importants travaux de Mathieu Letourneux ou de Stéphane Benassi (entre mille) ont scrutés et commentés, car : « Le chaos, la déréliction des communautés et des sujets, la consommation et la schizophrénie, l’empire de la déréalisation médiatique […] conduisent alors à réenvisager le visage actuel du récit policier. » (1).
Ces propos de Denis Mellier ne désignent-ils pas la lecture du polar comme apprivoisement du négatif et éveil à la noirceur, au sein de notre modernité ? De ce prisme unique dans sa détermination : policier , bien des éclairages peuvent naître, obliquer et diverger. À l’heure où « sort la recluse » (Fred Vargas, Flammarion)… que peut le genre policier ? Qu’a-t-il à nous dire maintenant ? Quelles grandes configurations, quelles actualisations, quels contours esthétiques et anthropologiques notre Série de la RLM pourrait-elle mettre à jour, avec cohérence et persévérance ? Rappelons que la sécularisation de nos sociétés démocratiques a mené du justicier au détective, et de la vengeance personnelle à la loi collective : c’est en tout cas la thèse de Jean-Claude Vareille dans son ouvrage de référence, L’Homme masqué, le justicier, le détective (1989). Mais les zones grises demeurent, et c’est là que la fiction policière enfonce son trépan et pose sa loupe grossissante, exagérant pour mieux les désigner les maux et les manques des sociétés.
C’est pourquoi l’une des “entrées” possibles pour un premier numéro serait sans doute la réécriture du fait divers contemporain, à laquelle se livrent aussi bien Emmanuel Carrère que Morgan Sportès. On pourrait par exemple établir une symétrie entre Ivan Jablonka écrivant Laëtitia, et Harold Cobert entrant dans la tête de Monique Fourniret (La Mésange et l’ogresse),en se demandant s’ils excipent encore du polar, ou du reportage post-mortem, mâtiné de Ubi sunt ; ainsi du Claustria de Jauffret (2012). Ces quelques aperçus n’ont que la vertu du signalement : leur nombre est légion.
Le dire policier aime aussi se frotter à la Mort. Comme tout « grand récit » humain, acté et sédimenté, la confrontation légale procède à la fois d’une « superstructure » culturelle (littéraire mais aussi filmographique…) et d’une « infrastructure » sociétale : ces romans adoptent pour discours la parresia (la “vérité”), la technicité d’un spécialiste. Est-ce compatible avec la liberté de la fiction ?
Notre propos ici n’est pas d’envisager tous les cas de figure, toutes les combinatoires ou thématiques traversantes possibles : du roman policier fantastique au roman policier “noir”, du néo-polar à la fantasy policière… la matière est énorme, et se prête à de nombreux exercices critiques. On pourrait d’ailleurs aussi envisager une forme de livraison « méta-critique », où seraient enregistrées les principales “écoles” de la critique policière. Autrement dit, on peut analyser le surgissement du récit criminel comme l’un des pôles de notre littérature stoïcienne moderne, témoignant à la fois de l’avancée des démocraties (sans lesquelles aucun travail de police n’est possible) et de l’ensauvagement ininterrompu des sociétés. A ce titre, il parait légitime de confronter le questionnement sur la sérialité (cf. la récurrence des personnages de policiers) à celui plus proprement adressé à la dynamique de l’enquête criminelle, tous deux pourvoyeurs d’une nouvelle posture lectorale et intellectuelle ; une nouvelle anthropologie de la réception.
1. « Thriller postmoderne et frontière contemporaine du littéraire », in Le Roman populaire en question(s), Migozzi dir., 1997, p. 482.
Alors risquons l’aventure, voire la double aventure du polar et de la sérialité, autrement dit du crime fictionnel et de sa thématisation multiple, réitérée, schématisée selon des rythmes et des codes que les importants travaux de Mathieu Letourneux ou de Stéphane Benassi (entre mille) ont scrutés et commentés, car : « Le chaos, la déréliction des communautés et des sujets, la consommation et la schizophrénie, l’empire de la déréalisation médiatique […] conduisent alors à réenvisager le visage actuel du récit policier. » (1).
Ces propos de Denis Mellier ne désignent-ils pas la lecture du polar comme apprivoisement du négatif et éveil à la noirceur, au sein de notre modernité ? De ce prisme unique dans sa détermination : policier , bien des éclairages peuvent naître, obliquer et diverger. À l’heure où « sort la recluse » (Fred Vargas, Flammarion)… que peut le genre policier ? Qu’a-t-il à nous dire maintenant ? Quelles grandes configurations, quelles actualisations, quels contours esthétiques et anthropologiques notre Série de la RLM pourrait-elle mettre à jour, avec cohérence et persévérance ? Rappelons que la sécularisation de nos sociétés démocratiques a mené du justicier au détective, et de la vengeance personnelle à la loi collective : c’est en tout cas la thèse de Jean-Claude Vareille dans son ouvrage de référence, L’Homme masqué, le justicier, le détective (1989). Mais les zones grises demeurent, et c’est là que la fiction policière enfonce son trépan et pose sa loupe grossissante, exagérant pour mieux les désigner les maux et les manques des sociétés.
C’est pourquoi l’une des “entrées” possibles pour un premier numéro serait sans doute la réécriture du fait divers contemporain, à laquelle se livrent aussi bien Emmanuel Carrère que Morgan Sportès. On pourrait par exemple établir une symétrie entre Ivan Jablonka écrivant Laëtitia, et Harold Cobert entrant dans la tête de Monique Fourniret (La Mésange et l’ogresse),en se demandant s’ils excipent encore du polar, ou du reportage post-mortem, mâtiné de Ubi sunt ; ainsi du Claustria de Jauffret (2012). Ces quelques aperçus n’ont que la vertu du signalement : leur nombre est légion.
Le dire policier aime aussi se frotter à la Mort. Comme tout « grand récit » humain, acté et sédimenté, la confrontation légale procède à la fois d’une « superstructure » culturelle (littéraire mais aussi filmographique…) et d’une « infrastructure » sociétale : ces romans adoptent pour discours la parresia (la “vérité”), la technicité d’un spécialiste. Est-ce compatible avec la liberté de la fiction ?
Notre propos ici n’est pas d’envisager tous les cas de figure, toutes les combinatoires ou thématiques traversantes possibles : du roman policier fantastique au roman policier “noir”, du néo-polar à la fantasy policière… la matière est énorme, et se prête à de nombreux exercices critiques. On pourrait d’ailleurs aussi envisager une forme de livraison « méta-critique », où seraient enregistrées les principales “écoles” de la critique policière. Autrement dit, on peut analyser le surgissement du récit criminel comme l’un des pôles de notre littérature stoïcienne moderne, témoignant à la fois de l’avancée des démocraties (sans lesquelles aucun travail de police n’est possible) et de l’ensauvagement ininterrompu des sociétés. A ce titre, il parait légitime de confronter le questionnement sur la sérialité (cf. la récurrence des personnages de policiers) à celui plus proprement adressé à la dynamique de l’enquête criminelle, tous deux pourvoyeurs d’une nouvelle posture lectorale et intellectuelle ; une nouvelle anthropologie de la réception.
1. « Thriller postmoderne et frontière contemporaine du littéraire », in Le Roman populaire en question(s), Migozzi dir., 1997, p. 482.
Séries policières 3
“À l'est de l'étoile polar”
|
La troisième saison des Séries policières se tourne résolument vers l’Est, pour scruter les fictions qui s’y déploient et l’imaginaire qu’elles révèlent, et par la même occasion la façon dont on les perçoit et représente ailleurs ; car comment envisage-t-on la police, la justice, le crime… quand on a si longtemps vécu dans l’oppression d’un régime quasi totalitaire ? Ce seront les réponses fournies par les romanciers hongrois, roumains, polonais, russes, ukrainiens, serbes… et français qui dessineront un atlas du récit criminel en pays froid, dans ses impasses comme ses réussites, ses étrangetés ou ses fidélités.
Sommaire
1. Polars de l’Est en français / East-European Crime and Mystery Fiction in French, par Paul BLETON
2. Meurtres en pays froid . La Sibérie en mode polar / Murders in the Cold Country: Siberia in noir, par Désiré NYELA |
3. Nordic Noir, adieu ! Une Russie rétrofuturiste ? Nordic Noir, Goodbye! A Retrofuturistic Russia?, par Isabelle-Rachel CASTA
4. Aux marges du polar, au cœur de l’Ukraine, avec Andreï Kourkov / On the Margins of Crime Fiction, in the Heart of Ukraine, withAndreï Kourkov, par Christiane CONNAN-PINTADO
5. Drôles de râles . Mimétique/ludique : un couple désassorti ? / Funny Moaning. Mimetic/Ludic: A Mismatched Couple?, par Paul BLETON
6. T’en prends du temps ! Chronotopes, mono- et polychronies, temporalités et accrocs de lecture /
You are sure taking your sweet time! Chronotope, Mono- and Polychronies, Temporalities and Reading Hang-ups, par Paul BLETON
7. Il y a bien « contre » dans « rencontre » ? passeurs, clichés interculturels, lieux et modalités de rencontre / Isn’t there “Counter” in “Encounter”? Transmitters, Intercultural Clichés, Places and Modalities of Contact, par Paul BLETON
8. L’Eau rouge. Quel réalisme pour le marché mondialisé de la fiction criminelle ? / Red Water. What Realism does the Globalized Crime Fiction Market Require?, par Paul BLETON
9. Désarrois hongrois : le crime en Hongrie selon les romanciers occidentaux, biculturels et hongrois / Hungarian Disarray. Hungarian Crime according to Western, Bicultural, and Hungarian Writers, par Paul BLETON et Sándor KÁLAI
10. Aux mains de témoins roumains . le crime en Roumanie selon les romanciers occidentaux, biculturels et roumains / In the Hands of Romanian Witnesses. Romanian Crime according to Western, Bicultural, and Romanian Writers, par Paul BLETON
11. À la polonaise – sexe, pouvoir et rapacité . polar ancien, contemporain, historique et post-moderne / Polish-Style Sex, Power and Greed. Ancient, Contemporary, Historical and Post-Modern Thriller, par Paul BLETON
Commander en ligne ici
4. Aux marges du polar, au cœur de l’Ukraine, avec Andreï Kourkov / On the Margins of Crime Fiction, in the Heart of Ukraine, withAndreï Kourkov, par Christiane CONNAN-PINTADO
5. Drôles de râles . Mimétique/ludique : un couple désassorti ? / Funny Moaning. Mimetic/Ludic: A Mismatched Couple?, par Paul BLETON
6. T’en prends du temps ! Chronotopes, mono- et polychronies, temporalités et accrocs de lecture /
You are sure taking your sweet time! Chronotope, Mono- and Polychronies, Temporalities and Reading Hang-ups, par Paul BLETON
7. Il y a bien « contre » dans « rencontre » ? passeurs, clichés interculturels, lieux et modalités de rencontre / Isn’t there “Counter” in “Encounter”? Transmitters, Intercultural Clichés, Places and Modalities of Contact, par Paul BLETON
8. L’Eau rouge. Quel réalisme pour le marché mondialisé de la fiction criminelle ? / Red Water. What Realism does the Globalized Crime Fiction Market Require?, par Paul BLETON
9. Désarrois hongrois : le crime en Hongrie selon les romanciers occidentaux, biculturels et hongrois / Hungarian Disarray. Hungarian Crime according to Western, Bicultural, and Hungarian Writers, par Paul BLETON et Sándor KÁLAI
10. Aux mains de témoins roumains . le crime en Roumanie selon les romanciers occidentaux, biculturels et roumains / In the Hands of Romanian Witnesses. Romanian Crime according to Western, Bicultural, and Romanian Writers, par Paul BLETON
11. À la polonaise – sexe, pouvoir et rapacité . polar ancien, contemporain, historique et post-moderne / Polish-Style Sex, Power and Greed. Ancient, Contemporary, Historical and Post-Modern Thriller, par Paul BLETON
Commander en ligne ici
Séries policières 2
“Amour fou et crimes en séries
quand le polar ausculte les abîmes”
|
Le monde comme une fiction... Une fiction d’horreur, d’absurde, d’inexplicable folie ou cruauté, on ne sait, dont le « vent noir» nous parvient parfois quasi malgré nous. En effet, les grands arcs narratifs, qui structurent le long temps des séries, ont presque toujours à voir avec les invariants anthropologiques de l’imaginaire collectif ; le sexe et la mort, l’amour et le crime, la violence et le pardon en sont les composantes majeures. Pourtant, s’ils sont souvent des « déclencheurs » d’intrigue sérielle, ils se font plus discrets quand commence l’enquête proprement dite, car une isotopie en remplace une autre – ou plutôt un faisceau d’isotopies, liées aux codes du feuilleton comme à ceux du polar... grand pourvoyeur, comme nous allons le découvrir, d’amours lamentables et de vampires affectifs.
Sommaire
1. Amour (devenu) fou et crimes en séries : quand le polar ausculte les abîmes, par Isabelle Rachel CASTA
|
2. Le rose et le noir, roman d’amour vs roman policier ? Quête amoureuse et enquête criminelle dans les romans de Léo Malet, par Cédric PÉROLINI
3. À la recherche de l’amour perdu, ou la mort retrouvée dans la trilogie policière de Jean-Claude Izzo, par Aziza BENZID
4. Desseins assassins : Après le Mur, à l’Est, interférences, amours et crimes, Paul BLETON
5. La belle inconnue : génétique de la femme fatale dans des productions littéraires et cinématographiques, par Cédric HANNEDOUCHE
6. À cause des garçons ? Les femmes détectives face aux flèches de Cupidon : résistance et autodéfense !, par Caroline GRANIER
7. Amour et case prison : Oz, ou la passion empêchée, par Isabelle Rachel CASTA
8. Hannibal ou le trouble amoureux : de la “femme du vampire” aux “amants tueurs”, par Beverly MARCHAND
9. L'amour à mort !, par Thierry JANDROK
Commander en ligne ici.
3. À la recherche de l’amour perdu, ou la mort retrouvée dans la trilogie policière de Jean-Claude Izzo, par Aziza BENZID
4. Desseins assassins : Après le Mur, à l’Est, interférences, amours et crimes, Paul BLETON
5. La belle inconnue : génétique de la femme fatale dans des productions littéraires et cinématographiques, par Cédric HANNEDOUCHE
6. À cause des garçons ? Les femmes détectives face aux flèches de Cupidon : résistance et autodéfense !, par Caroline GRANIER
7. Amour et case prison : Oz, ou la passion empêchée, par Isabelle Rachel CASTA
8. Hannibal ou le trouble amoureux : de la “femme du vampire” aux “amants tueurs”, par Beverly MARCHAND
9. L'amour à mort !, par Thierry JANDROK
Commander en ligne ici.
Séries policières 1
“Enquêtes et réels : en quête du réel ?”
|
« Dans la puissance, la sensation est anesthésie, la pensée non pensée, l'œuvre le désœuvrement » (Giorgio Agemben)
La première livraison de “Séries policières” concernera les nombreuses et récentes réécritures (ou ré-élaborations) de faits sociétaux troubles et troublants, ce qu'il est convenu de nommer, faute d'une catégorie moins nébuleuse, les faits divers. Si le grand modèle reste Truman Capote dans In Cold Blood, les récits d'Anne Rule, expertisant toujours les “événements” criminels à teneur traumatogène, peuvent également servir de pierre d'achoppement ; mais c'est vers les écritures françaises que nous aimerions plus spécifiquement porter notre attention, englobant aussi bien les “romans” Emmanuel Carrère que ceux de Morgan Sportès. La caractérisation de policier s'attache au versant criminel des événements relatés, puisque aussi bien la modalité de l'enquête semble bien informer la plupart des régies narratives qui vont en découler. |
Lorsque Ivan Jablonka écrit Laëtitia, ou que Harold Cobert entre dans la tête de Monique Fourniret (La Mésange et l’ogresse), excipent-ils encore du polar, ou du reportage post-mortem, mâtiné de Ubi sunt ? Ainsi le Claustria de Jauffret (2012) est-il, si l’on veut, un “roman policier résolu”, puisqu’il commence quand la victime a refait surface ; la question est donc rétroactive : comment cela a-t-il pu se produire ainsi ? Jauffret nous prend par la main, pour revisiter l’enfer d’une famille autrichienne dysfonctionnelle, les Fritzl, et ce réalisme – vite métamorphosé en hyperréalisme stylisé – est particulièrement bien analysé par l’écrivain Bernard Pingaud : « Le roman fictionnalise la réalité en la racontant et, du même coup, la transforme en modèle. […] Tout se passe comme si, pour la plupart des romanciers, la question des rapports du réel et de la fiction ne se posait plus. »
En quoi s'agit-il de séries ? En ce qu'il y a regroupement de thèmes, de finalités, d'inspirations ; ici la série ne commence pas seulement à la collection ou à l'anthologie, mais au partage d'un même désir d'accéder au plausible, d'une même envie de jeter, dans “les” réels, l'éclairage qui, selon Françoise Lavocat, Alison James et Alexandre Gefen, est nécessaire pour séparer la fiction des fake news :
« Ainsi, la distinction entre faits et fictions est un rempart contre toutes les formes de révisionnisme, d'instrumentalisation de l'information, de brouillage des savoirs et des droits. » (« La fiction à la barre », Libération, 6 octobre 2017).
En quoi s'agit-il de séries ? En ce qu'il y a regroupement de thèmes, de finalités, d'inspirations ; ici la série ne commence pas seulement à la collection ou à l'anthologie, mais au partage d'un même désir d'accéder au plausible, d'une même envie de jeter, dans “les” réels, l'éclairage qui, selon Françoise Lavocat, Alison James et Alexandre Gefen, est nécessaire pour séparer la fiction des fake news :
« Ainsi, la distinction entre faits et fictions est un rempart contre toutes les formes de révisionnisme, d'instrumentalisation de l'information, de brouillage des savoirs et des droits. » (« La fiction à la barre », Libération, 6 octobre 2017).
Sommaire
Exeunt omnes, par Isabelle Rachel Casta
1. Quelques notes sur les liens du réalisme et de l’enquête et sur les questions qu’ils posent, ou :
des conditions minimales du roman policier et de leurs propriétés définitoires, par Jean BESSIÈRE
2. À l’ombre des jeunes filles en cave, par Christiane CONNAN-PINTADO
3. Comprendre les abysses du mal. Les tueurs en série Fred et Rose West dans la fiction de Phil Rickman, par Suzanne BRAY
4. L’enquête, entre désirs singuliers et demande politique, par Thierry JANDROK
5. « Il faut tuer utile ». Fait divers et parodie sanglante dans Les Contre-Enquêtes du Commissaire Liberty de Raphaël Majan,
par Luce ROUDIER
6. Tout est vrai. Les enquêtes d’Ann Rule, par Daniel COMPÈRE
7. La une comme fabrique du crime à la Belle Époque, un principe sériel, par Cédric HANNEDOUCHE
8. La vie à bout portant. Du polar à la sauce noire, par Désiré NYÉLA
9. Un cadavre dans le placard… Delphine de Vigan à l’épreuve du réel ?, par Guillaume GOMOT
Bibliographie – Filmographie
Commander en ligne ici.
1. Quelques notes sur les liens du réalisme et de l’enquête et sur les questions qu’ils posent, ou :
des conditions minimales du roman policier et de leurs propriétés définitoires, par Jean BESSIÈRE
2. À l’ombre des jeunes filles en cave, par Christiane CONNAN-PINTADO
3. Comprendre les abysses du mal. Les tueurs en série Fred et Rose West dans la fiction de Phil Rickman, par Suzanne BRAY
4. L’enquête, entre désirs singuliers et demande politique, par Thierry JANDROK
5. « Il faut tuer utile ». Fait divers et parodie sanglante dans Les Contre-Enquêtes du Commissaire Liberty de Raphaël Majan,
par Luce ROUDIER
6. Tout est vrai. Les enquêtes d’Ann Rule, par Daniel COMPÈRE
7. La une comme fabrique du crime à la Belle Époque, un principe sériel, par Cédric HANNEDOUCHE
8. La vie à bout portant. Du polar à la sauce noire, par Désiré NYÉLA
9. Un cadavre dans le placard… Delphine de Vigan à l’épreuve du réel ?, par Guillaume GOMOT
Bibliographie – Filmographie
Commander en ligne ici.
Séries policières 2
“Amour fou et crimes en séries : quand le polair ausculte les abîmes”
(en préparation)
On sait que comme le rappelle Sandra Provini dans sa réflexion sur la Lavinia de Ursula Le Guin (L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain, 2014), l'amour et l'épopée ne font pas trop bon ménage… n'en serait-il pas de même avec les séries policières, romanesques ou multimédiatiques ?
Eros et Thanatos obéissent souvent, dans le conventionnalisme narratif du polar, à des stéréotypies forcément “moins-disantes” ; si les aléas du roman d'amour l'emportent sur la rigueur de l'indagation, l'auteur risque de perdre les deux lectorats ; l'un sera frustré d'une romance plus complexe, l'autre égaré dans des affres sentimentales qui l'éloigneront du cœur noir de l'intrigue.
Pourtant, et paradoxalement, les plus grands romans policiers s'originent, ou s'achèvent, dans le chagrin d'un amour impossible, méconnu car méconnaissable...
C'est ainsi que Nestor Burma perdra Belita Morales la gitane, aussi terriblement que Rouletabille retrouvera son épouse assassinée, ou que le héros meurtri du Lune Sanglante de James Ellroy traquera Kathy en tuant ses doubles. Quant à la Némésis d'Agatha Christie, elle vengera une jeune fille trop aimée d'une passion qui, alors, ne disait pas son nom.
L'implication des codes du roman d'amour dans l'horizon d'attente de la sérialité policière (écrite, filmée…) demande une grammaire particulière, un (dés)équilibre, un tempo – toutes spécificités qui veulent analyse, explication et problématisation… à cause, à cause d'une femme ?
Eros et Thanatos obéissent souvent, dans le conventionnalisme narratif du polar, à des stéréotypies forcément “moins-disantes” ; si les aléas du roman d'amour l'emportent sur la rigueur de l'indagation, l'auteur risque de perdre les deux lectorats ; l'un sera frustré d'une romance plus complexe, l'autre égaré dans des affres sentimentales qui l'éloigneront du cœur noir de l'intrigue.
Pourtant, et paradoxalement, les plus grands romans policiers s'originent, ou s'achèvent, dans le chagrin d'un amour impossible, méconnu car méconnaissable...
C'est ainsi que Nestor Burma perdra Belita Morales la gitane, aussi terriblement que Rouletabille retrouvera son épouse assassinée, ou que le héros meurtri du Lune Sanglante de James Ellroy traquera Kathy en tuant ses doubles. Quant à la Némésis d'Agatha Christie, elle vengera une jeune fille trop aimée d'une passion qui, alors, ne disait pas son nom.
L'implication des codes du roman d'amour dans l'horizon d'attente de la sérialité policière (écrite, filmée…) demande une grammaire particulière, un (dés)équilibre, un tempo – toutes spécificités qui veulent analyse, explication et problématisation… à cause, à cause d'une femme ?