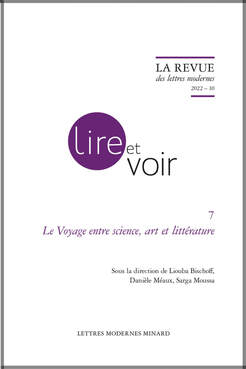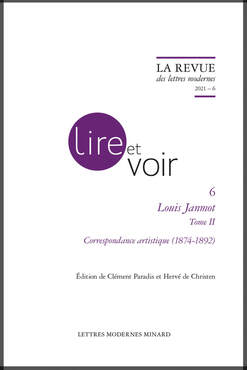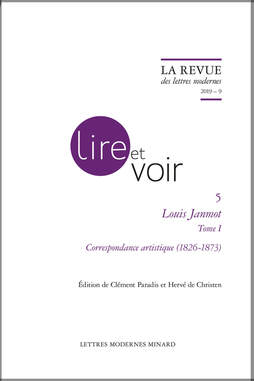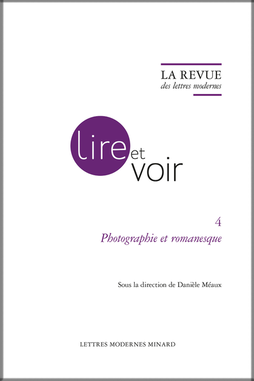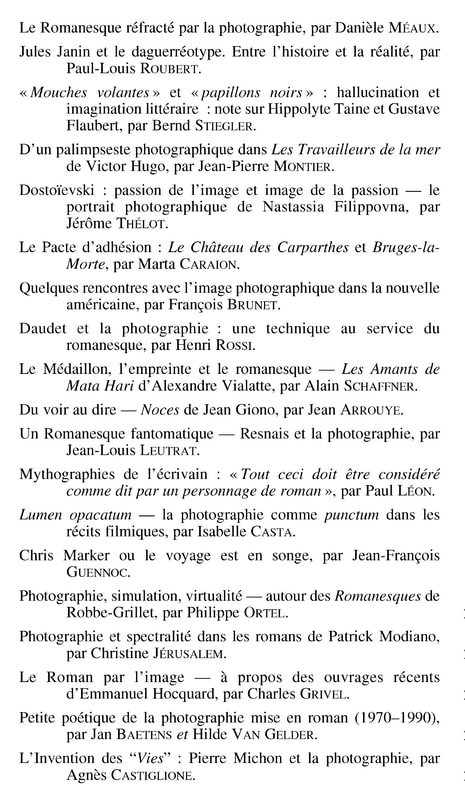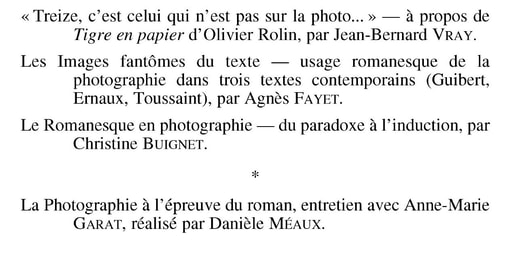Série Lire et voir
Dir. Danièle Méaux
La Série lire & voir est consacrée aux rapports d’interaction du texte et des images fixes; elle est centrée sur le XXe siècle et laisse hors de son champ les réalisations relevant du cinéma ou de la vidéo qui soulèvent des questions de nature différente. S’il est déjà des travaux sur la question, les relations du texte et des images sont encore souvent traitées de manière oblique : des stylisticiens analysent les mécanismes de l’ekphrasis; des bibliophiles ou des spécialistes de l’édition décrivent l’évolution des supports et des techniques; des historiens de l’art se penchent sur la réception des œuvres visuelles... Ces travaux, pour importants qu’ils sont, laissent insatisfait dans la mesure où l’interaction du texte et des images ne s’y trouve abordée qu’indirectement. Les sémiologues se sont, par le passé, intéressés aux domaines de la publicité, de la propagande, du photo-roman populaire ou de la presse qui leur permettaient de mener des analyses théoriques, mais ils ont le plus souvent délaissé des productions mixtes plus originales et créatives, dont la complexité mérite d’être explorée. Les spécialistes de la littérature abordent la question des livres illustrés d’écrivain, tandis que les chercheurs en esthétique étudient le carnet de peintre ou encore le “livre d’artiste”; mais il n’y a pas assez d’occasions de rencontre entre leurs travaux. La Série lire & voir veut cerner un domaine spécifique, qui ne se trouve plus situé à la périphérie d’autres champs et vers lequel les compétences des uns ou des autres puissent converger.
L’impact de l’image — la manière dont elle modifie l’appréhension du verbe et détermine le sens — doit être valorisé : le rapport des représentations visuelles et du texte reste encore fréquemment abordé de manière logocentrique. La Série lire & voir vise à donner à l’image la place qui lui revient. Qu’elle soit seulement évoquée par le texte ou bien qu’elle soit physiquement présente à son côté, la représentation visuelle joue un rôle essentiel :
— Quand une image est évoquée par les mots, c’est le verbe qui la fait exister, pour le lecteur. Mais, en retour, la représentation construite par le biais du langage rejaillit puissamment sur l’interprétation du texte : le mouvement est à double détente. Quelque chose se joue dans l’intervalle ménagé entre le lisible et le visible. La suggestion d’une image modalise pour le lecteur la réception du texte. C’est le rôle dynamique et opératoire de l’invocation d’une représentation visuelle qui peut être étudié.
— Les mécanismes de l’écriture sont susceptibles d’influer de diverses façons sur l’activité des peintres ou des photographes. Mais les processus de fabrication des images modélisent également, de manière souterraine, certaines pratiques scripturales.
— Une attention privilégiée doit être accordée aux réalisations mixtes qui combinent les mots et les images. À la période contemporaine, en raison d’une expansion des moyens techniques, les travaux hétérogènes sont de plus en plus nombreux. Des ensembles hybrides ménagent un dialogue entre le texte et les images qui — tout en formant un ensemble indissoluble — conservent l’un et l’autre leur identité et leur autonomie. Les réalisations, qui s’écartent des simples relations de commentaire ou d’illustration pour proposer un objet complexe, autorisent des modalités de lecture qui leur sont propres; une attention accrue est portée aux effets plastiques de la page imprimée; un positionnement neuf est adopté face aux représentations visuelles et face au texte; les mécanismes d’interférences, faits de contaminations réciproques et de rebonds infinis, sont très divers. Chaque examen est un événement qui laisse au lecteur une part de liberté.
Chaque livraison de la Série lire & voir sera centrée sur une problématique précise et accueillera les contributions de chercheurs de disciplines diverses. Une place sera également réservée à des entretiens d’artistes, d’écrivains, d’éditeurs ou de photographes... en rapport avec le sujet du volume.
Danièle Méaux
Lire et voir 7 : “Le Voyage, entre science, art et littérature”
dir. Liouba Bischoff, Danièle Méaux et Sarga Moussa
|
La pratique du voyage s’oriente dans deux directions distinctes à partir du XIXe siècle : d’un côté, le voyage d’exploration scientifique, qui rassemble des naturalistes, astronomes, géologues et cartographes, non plus pour découvrir de nouvelles terres, mais pour procéder à des relevés et faire progresser la connaissance des territoires, de la faune et de la flore ; de l’autre, le voyage littéraire et artistique, où prime la subjectivité de l’observateur. Or il n’est pas rare que des artistes se joignent aux voyages d’exploration scientifique, et le rêve humboldtien d’unir la science et l’esthétique est partagé par bien des écrivains. L’autonomisation des disciplines est loin d’avoir interrompu le dialogue entre science, art et littérature, de sorte qu’il convient d’interroger à la fois la place de la science dans le voyage littéraire et artistique, et la place de l’esthétique dans le récit de voyage scientifique. En littérature, les pratiques de collecte et d’arpentage resurgissent avec force depuis la fin du XXe siècle, à la faveur d’échanges multiples avec les sciences humaines et les sciences naturelles, l’exploration des écrivains prenant volontiers la forme de l’enquête et du jeu distancié avec les codes du voyage savant. Un mouvement analogue s’empare de la photographie, selon une temporalité spécifique : dès son avènement XIXe
|
siècle, ce médium est utilisé au cours des missions scientifiques, les prises de vue étant restituées sous forme d’albums ou de typologies ‒ non sans trahir des présupposés méthodologiques, des imaginaires scientifiques et des logiques de maîtrise et de domination. Aujourd’hui (particulièrement depuis le dernier quart du vingtième siècle), des photographes ou des artistes reviennent sur ces usages qu’ils reprennent pour partie, tout en s’en distinguant. La réplique ou l’emprunt de certaines manières de faire signent à la fois la volonté de renouer avec une soif de connaître le monde, et l’aspiration à des formes d’enquête plus libres, voire fantaisistes, donnant lieu à des questionnements épistémologiques.
Sommaire
Préface, par Danièle MÉAUX et Liouba BISCHOFF
I. ENTREMÊLER LES SAVOIRS
1. « Errer, en vraie Kalmouke, à travers le steppe » : le récit de voyage des Hommaire de Hell en Russie méridionale (1843-1845), par Virginie TELLIER
2. Alexander von Humboldt et Hercule Florence, des manières de faire des mondes, par Éric VALETTE
3. Philosophie du voyage alpin, par Pierre-Henry FRANGNE
4. Les montagnes japonaises au prisme de Walter Weston : entre Voyage romantique et rapport scientifique, par Amandine MARTIN
5. Explorer le Forez en scientifique ou en artiste : les éditions de Félix Thiollier, par Clément PARADIS
6. Un savant, un aventurier ou (juste) un écrivain ? Les multiples facettes de Henryk Sienkiewicz-voyageur et de ses Lettres d’Afrique, par Małgorzata SOKOLOWICZ
7. Max Tilke, voyageur, dessinateur et anthropologue : une approche scientifique du costume ? (Le Costume en Orient, 1922), par Betty ZEGHDANI
8. Les Archives de la planète : entre perspectives scientifiques et visées esthétiques, par Fabienne MAILLARD
II. INTERROGER LES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES
9. « Histoire de l’anthropologue incompris ». Une critique de l’enquête ethnographique par Georges Perec, par ÉlÉonore DEVEVEY
10. Robert Smithson : un voyage en entropie, par Jonathan TICHIT
11. Entre hommage et dérision. Figurations du voyageur érudit en contexte touristique dans le roman français contemporain, par Stéphane ANDRÉ
12. L’aporie du voyage impossible : de quelques récritures romanesques contemporaines du voyage scientifique, par Anne-Gaëlle WEBER
13. Universels reportages. La poésie documentaire sur le terrain, par Émilie FRÉMOND
14. Suppléments au voyage au Pôle Nord. Retrouvailles, reprises et suppléments dans Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy, par Laurent DEMANZE
15. Comme un corps étranger dans le Haut-Arctique : l’artiste embarquée dans une expédition militaire, par Aline CAILLET et Emmanuelle Léonard, par Laurent DEMANZE
Commander en ligne ici.
I. ENTREMÊLER LES SAVOIRS
1. « Errer, en vraie Kalmouke, à travers le steppe » : le récit de voyage des Hommaire de Hell en Russie méridionale (1843-1845), par Virginie TELLIER
2. Alexander von Humboldt et Hercule Florence, des manières de faire des mondes, par Éric VALETTE
3. Philosophie du voyage alpin, par Pierre-Henry FRANGNE
4. Les montagnes japonaises au prisme de Walter Weston : entre Voyage romantique et rapport scientifique, par Amandine MARTIN
5. Explorer le Forez en scientifique ou en artiste : les éditions de Félix Thiollier, par Clément PARADIS
6. Un savant, un aventurier ou (juste) un écrivain ? Les multiples facettes de Henryk Sienkiewicz-voyageur et de ses Lettres d’Afrique, par Małgorzata SOKOLOWICZ
7. Max Tilke, voyageur, dessinateur et anthropologue : une approche scientifique du costume ? (Le Costume en Orient, 1922), par Betty ZEGHDANI
8. Les Archives de la planète : entre perspectives scientifiques et visées esthétiques, par Fabienne MAILLARD
II. INTERROGER LES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES
9. « Histoire de l’anthropologue incompris ». Une critique de l’enquête ethnographique par Georges Perec, par ÉlÉonore DEVEVEY
10. Robert Smithson : un voyage en entropie, par Jonathan TICHIT
11. Entre hommage et dérision. Figurations du voyageur érudit en contexte touristique dans le roman français contemporain, par Stéphane ANDRÉ
12. L’aporie du voyage impossible : de quelques récritures romanesques contemporaines du voyage scientifique, par Anne-Gaëlle WEBER
13. Universels reportages. La poésie documentaire sur le terrain, par Émilie FRÉMOND
14. Suppléments au voyage au Pôle Nord. Retrouvailles, reprises et suppléments dans Un monde sans rivage d’Hélène Gaudy, par Laurent DEMANZE
15. Comme un corps étranger dans le Haut-Arctique : l’artiste embarquée dans une expédition militaire, par Aline CAILLET et Emmanuelle Léonard, par Laurent DEMANZE
Commander en ligne ici.
Lire et voir 6 : “Louis Janmot – t. II : Correspondance artistique (1874-1892)”
éd. Clément Paradis et Hervé de Christen
|
Élève d’Ingres et ami de Delacroix, Louis Janmot (1814-1892) fut un peintre respecté, mais un artiste incompris. Quarante ans furent nécessaires à la complétion de son Poème de l’âme, cycle composé de 18 tableaux, 16 grands dessins et de 2 800 vers ‒ pendant lesquelles Janmot traversa le siècle des Révolutions et des Contre-révolutions, dont il fut à la fois l’héritier et la victime.
Ce deuxième volume de correspondance artistique couvre les quinze dernières années de la vie de Louis Janmot, qui voient son œuvre picturale et littéraire finalement donnée à lire et à voir à travers un livre illustré, le premier travaillé par le photographe et éditeur Félix Thiollier. Commander en ligne ici.
|
Lire et voir 5 : “Louis Janmot – t. I : Correspondance artistique (1826-1873)”
éd. Clément Paradis et Hervé de Christen
|
Admiré par Maurice Denis et Odilon Redon, Louis Janmot (1814-1892) fut un peintre respecté mais un artiste incompris. Son Poème de l’âme rappelle plus les ambitions de William Blake ou des partisans de l’œuvre d’art totale que la peinture académique des ateliers parisiens. Quarante ans furent nécessaires à la complétion de ce “poème”, pendant lesquelles Janmot traversa le siècle des révolutions et des contre-révolutions, dont il fut à la fois l’héritier et la victime. Cette édition rassemble la correspondance artistique de Louis Janmot pendant la période de maturation de sa grande œuvre. Se côtoient ainsi au fil des pages commentaires de l’actualité, confidences, négociations ; mais aussi les réflexions qui alimentent le travail sur son Poème.
Commander en ligne ici.
|
Lire et voir 4 : “photographie et romanesque”
|
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
|
Lire et voir 3 : “portraits de pays illustrés : un genre phototextuel”
dir. Anne Reverseau
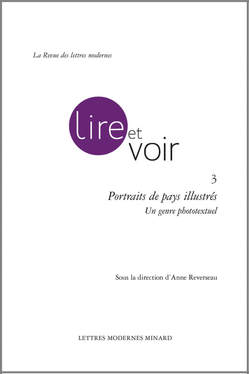
Comment évoquer un pays en mots et en images ? La masse de livres illustrés portant sur des lieux ne doit pas faire oublier à quel point faire le portrait d’un pays est un défi tant pour la photographie que pour l’écriture. De la Mission héliographique de 1851 à La France de Raymond Depardon de 2010, le portrait de pays constitue un véritable genre photoillustré, sous la forme du beau livre, de l’ouvrage bon marché ou encore du reportage. Ces objets ne jouent-ils pas un rôle crucial dans la constitution et les transformations de l’identité d’un pays ? Cet ouvrage retrace l’histoire du genre du portrait de pays photoillustré, et s’intéresse aussi à la question des supports et de la valeur de ces livres souvent relégués dans les marges.
SOMMAIRE
1. Enjeux des portraits de pays photoillustrés : une introduction à un genre phototextuel,
par Anne Reverseau
2. Autour d’Au pays d’Hamlet (1894) : l’émergence du portrait de pays photoillustré,
entre ambitions esthétiques et affirmations nationalistes, par Laureline Meizel
3. De la Grèce fragmentée à la constitution d’une Méditerranée odysséenne : Le portrait paysager
dans l’œuvre de Victor Bérard, par Laury-Nuria André
4. Portraits de pays réservés au corps médical, par Myriam Boucharenc
5. Mac Orlan et la Tunisie : portrait d'un pays en mutation dans la presse de l’entre-deux-guerres, par Zacharie Signoles-Beller
6. Portraits de villes et portraits de pays : une simple différence d’échelle ?, par Susana S. Martins
7. La collection « Merveilles de la Suisse » des éditions Jean Marguerat, un portrait illustré de la Suisse romande, par Alessandra Panigada
8. Portrait du pays en jeune État : L’Encyclopédie d’Israël en images 1950-1952, par Galia Yanoshevsky
9. La France de profil : du portrait de pays au territoire photolittéraire, par Jean-Pierre Montier
10. L’hier et l’aujourd’hui dans le portrait de pays. Neutralisations de l’historicité, par David Martens
11. Nicolas Bouvier : Les visages du Japon, par Jean-Michel Rietsch
12. La Mission Photographique Transmanche : « Défense et illustration » d’un territoire, par Danièle Méaux
13. Tours et détours en France : Sur la route avec Jean-Christophe Bailly et Raymond Depardon, par Ari J. Blatt
14. « Des livres qui donnent envie de voyager » : Xavier Canonne évoque des portraits de pays, de villes et des livres de voyage
15. En bord de pays : « le territoire, c’est l’autre » : Entretien avec Chantal Vey, artiste photographe
Commander en ligne ici.
SOMMAIRE
1. Enjeux des portraits de pays photoillustrés : une introduction à un genre phototextuel,
par Anne Reverseau
2. Autour d’Au pays d’Hamlet (1894) : l’émergence du portrait de pays photoillustré,
entre ambitions esthétiques et affirmations nationalistes, par Laureline Meizel
3. De la Grèce fragmentée à la constitution d’une Méditerranée odysséenne : Le portrait paysager
dans l’œuvre de Victor Bérard, par Laury-Nuria André
4. Portraits de pays réservés au corps médical, par Myriam Boucharenc
5. Mac Orlan et la Tunisie : portrait d'un pays en mutation dans la presse de l’entre-deux-guerres, par Zacharie Signoles-Beller
6. Portraits de villes et portraits de pays : une simple différence d’échelle ?, par Susana S. Martins
7. La collection « Merveilles de la Suisse » des éditions Jean Marguerat, un portrait illustré de la Suisse romande, par Alessandra Panigada
8. Portrait du pays en jeune État : L’Encyclopédie d’Israël en images 1950-1952, par Galia Yanoshevsky
9. La France de profil : du portrait de pays au territoire photolittéraire, par Jean-Pierre Montier
10. L’hier et l’aujourd’hui dans le portrait de pays. Neutralisations de l’historicité, par David Martens
11. Nicolas Bouvier : Les visages du Japon, par Jean-Michel Rietsch
12. La Mission Photographique Transmanche : « Défense et illustration » d’un territoire, par Danièle Méaux
13. Tours et détours en France : Sur la route avec Jean-Christophe Bailly et Raymond Depardon, par Ari J. Blatt
14. « Des livres qui donnent envie de voyager » : Xavier Canonne évoque des portraits de pays, de villes et des livres de voyage
15. En bord de pays : « le territoire, c’est l’autre » : Entretien avec Chantal Vey, artiste photographe
Commander en ligne ici.
lire et voir 2 : “de l’autoportrait à l’autobiographie”
dir. Jan BAETENS et Alexander Streitberger
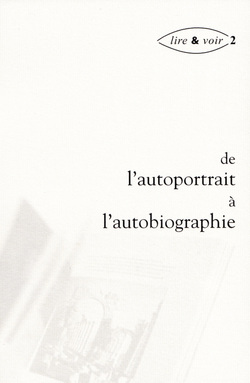
De l’autoportrait à l’autobiographie, par Jan Baetens et Alexander Streitberger.
1. Figuration d’une vie imag(inair)e : mémoire et narrativité intermédiale dans L’Amant
de Marguerite Duras, par Andrea Oberhuber.
2. Le Retour impossible. Quelli di Bagheria de Ferdinando Scianna, par Antonio Ansón.
3. « Manifeste photobiographique » : la vie à relire, par Jan Baetens et Anneleen Masschelein.
4. « Coiffure dames ». La photographie dans le parcours autobiographique de Perec, par Chiara
Nannicini.
5. Entre textes et photographies : l’autofiction chez Hervé Guibert, par Arnaud Genon
et Guillaume Ertaud.
6. Fictions autobiographiques hybrides. Notes sur Alix Cléo Roubaud et Denis Roche, par Luigi
Magno.
7. Jean Le Gac, mythomane, par Danièle Méaux.
8. Les Échappées de l’image fixe : corps et visages en mouvement de l’autobiographie mixte,
par Chloé Conant-Ouaked.
9. Passer inaperçu dans l’autobiographie. Autrui et moi dans l’Autobiography de Robert Barry,
par Leszek Brogowski.
10. Allan Sekula. Lire l’artiste dans l’œuvre, par Hilde Van Gelder.
11. Une Pratique d’anamnèse discontinue. Autobiographie et photographie chez Robert Morris, par Alexander Streitberger.
12. Piqûres de cœur. Broder et se raconter dans Douleur exquise de Sophie Calle, par Stefanie Rentsch.
13. De la mise en scène du « je » et du jeu de la mise en scène. Le cas de Samuel Fosso, par Ingrid Hölzl.
Notices biographiques.
1. Figuration d’une vie imag(inair)e : mémoire et narrativité intermédiale dans L’Amant
de Marguerite Duras, par Andrea Oberhuber.
2. Le Retour impossible. Quelli di Bagheria de Ferdinando Scianna, par Antonio Ansón.
3. « Manifeste photobiographique » : la vie à relire, par Jan Baetens et Anneleen Masschelein.
4. « Coiffure dames ». La photographie dans le parcours autobiographique de Perec, par Chiara
Nannicini.
5. Entre textes et photographies : l’autofiction chez Hervé Guibert, par Arnaud Genon
et Guillaume Ertaud.
6. Fictions autobiographiques hybrides. Notes sur Alix Cléo Roubaud et Denis Roche, par Luigi
Magno.
7. Jean Le Gac, mythomane, par Danièle Méaux.
8. Les Échappées de l’image fixe : corps et visages en mouvement de l’autobiographie mixte,
par Chloé Conant-Ouaked.
9. Passer inaperçu dans l’autobiographie. Autrui et moi dans l’Autobiography de Robert Barry,
par Leszek Brogowski.
10. Allan Sekula. Lire l’artiste dans l’œuvre, par Hilde Van Gelder.
11. Une Pratique d’anamnèse discontinue. Autobiographie et photographie chez Robert Morris, par Alexander Streitberger.
12. Piqûres de cœur. Broder et se raconter dans Douleur exquise de Sophie Calle, par Stefanie Rentsch.
13. De la mise en scène du « je » et du jeu de la mise en scène. Le cas de Samuel Fosso, par Ingrid Hölzl.
Notices biographiques.
Lire et voir 1 : "livres de photographies et de mots"
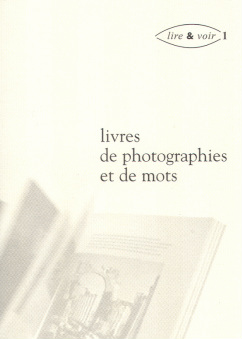
Le Livre de photographies et de mots : un espace de brouillages et d’interférences, par
Danièle Méaux.
1. Le Feu : présence au monde, incandescence de la parole, par Jean-Pierre Montier.
2. Comment mentir en disant deux fois la vérité : photographie et autobiographie, par
Véronique Montémont.
3. Un Nouvel art de dire et de montrer, par Jean Arrouye.
4. Les Petits arrangements de la réalité et de la fiction, par Chloé Conant.
5. François Hers/Récit : pour une poétique de l’étalement, par Jan Baetens et Mike Bleyen.
6. Notes sur quelques recueils de mots et d’images de rêves, par Christine Buignet.
7. L’Image telle qu’elle s’énonce, par Jacinto Lageira.
8. Coprésence et coproduction. Usages de la photographie et du texte dans les livres d’artistes
« conceptuels », par Jérôme Dupeyrat.
9. L’Exposition des mots et des images dans l’espace du livre (les exemples de Lothar Baumgarten,
Hamish Fulton et Sophie Ristelhueber), par Christophe Viart.
10. De l’image décrite à l’image de l’écrit : la réciproque photo-romanesque, par Alexandra Koeniguer.
11. De l’intempestif au temps gelé des calendriers, par Boris Eizykman.
12. Le Livre photo-illustré dans les éditions de luxe de la musique Post Punk, par Paul Edwards.
lire & voir 1 : “Livres de photographies et de mots”. Danièle Méaux ed.. Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 254 p. 26 € ISBN 978-2-256-91149-1
Commander en ligne ici.
Danièle Méaux.
1. Le Feu : présence au monde, incandescence de la parole, par Jean-Pierre Montier.
2. Comment mentir en disant deux fois la vérité : photographie et autobiographie, par
Véronique Montémont.
3. Un Nouvel art de dire et de montrer, par Jean Arrouye.
4. Les Petits arrangements de la réalité et de la fiction, par Chloé Conant.
5. François Hers/Récit : pour une poétique de l’étalement, par Jan Baetens et Mike Bleyen.
6. Notes sur quelques recueils de mots et d’images de rêves, par Christine Buignet.
7. L’Image telle qu’elle s’énonce, par Jacinto Lageira.
8. Coprésence et coproduction. Usages de la photographie et du texte dans les livres d’artistes
« conceptuels », par Jérôme Dupeyrat.
9. L’Exposition des mots et des images dans l’espace du livre (les exemples de Lothar Baumgarten,
Hamish Fulton et Sophie Ristelhueber), par Christophe Viart.
10. De l’image décrite à l’image de l’écrit : la réciproque photo-romanesque, par Alexandra Koeniguer.
11. De l’intempestif au temps gelé des calendriers, par Boris Eizykman.
12. Le Livre photo-illustré dans les éditions de luxe de la musique Post Punk, par Paul Edwards.
lire & voir 1 : “Livres de photographies et de mots”. Danièle Méaux ed.. Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. « La Revue des Lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 254 p. 26 € ISBN 978-2-256-91149-1
Commander en ligne ici.