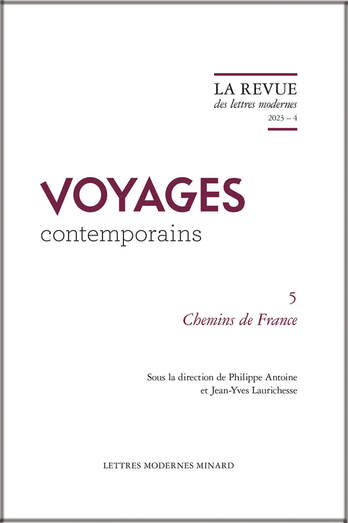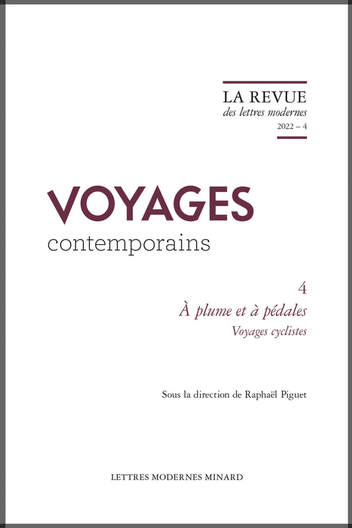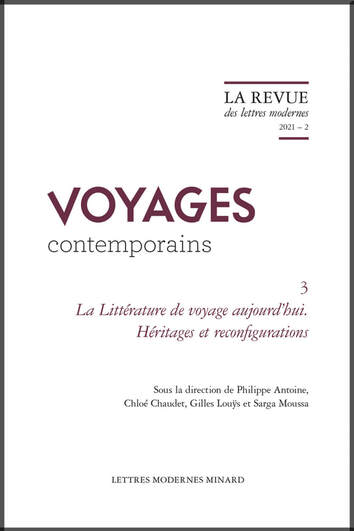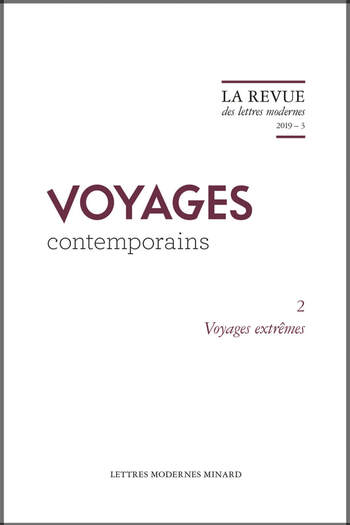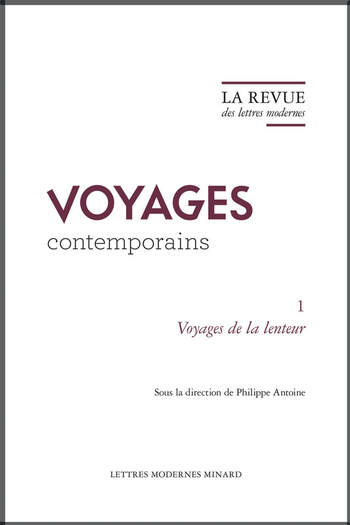Série Voyages contemporains
Dir. Philippe Antoine (2009)
Les professionnels de l’écriture ont progressivement investi un domaine qui était auparavant réservé aux marins, aux missionnaires, aux pèlerins... à ceux qui en d’autres termes avaient de bonnes raisons de voyager. Une distinction s’est alors établie entre les écrivains voyageurs, qui partent pour écrire, et les voyageurs écrivant. La frontière ainsi dessinée repose sur des critères assez peu sûrs. On attend ainsi de l’auteur qui compose une œuvre avec ses voyages autre chose qu’un relevé de lignes et de surfaces, aussi séduisant soit-il. Mais le fait d’être poète n’implique pas qu’on puisse totalement négliger les devoirs du voyageur. Cette oscillation entre la «poésie» et l’«histoire» constitue l’un des traits structurant du genre. La Série Voyages contemporains, tout en privilégiant des approches de type esthétique, ne voudrait pas se cantonner aux grands noms de la “littérature voyageuse” (Segalen, Michaux, Leiris, Bouvier...), ni même à ces œuvres dont on se dit qu’elles ont été produites dans une intention d’art. Dans la mesure où elle souhaite contribuer à une caractérisation des “arts du voyage”, c’est-à-dire, conjointement, à des pratiques et à leur mise en mots ou en images, elle se voudrait accueillante, sans exclusive, à la vaste production des relations viatiques qui permettent de définir une culture du voyage inscrite dans notre modernité.
Il faut surmonter bien des obstacles pour oser voyager aujourd’hui, et plus encore pour publier une relation. Un lieu commun s’impose avec insistance pour la période contemporaine : il n’y aurait plus rien à découvrir dans un monde parcouru en tous sens et voué à l’uniformité. Ce constat désabusé s’étend au récit lui-même, devenu inutile dès lors que l’ailleurs n’existe plus. Tous les voyages ont été faits. Tous les récits de voyages ont été écrits. Il vaut la peine, bien sûr, de comprendre les enjeux de telles affirmations, éminemment paradoxales puisqu’elles sont immédiatement démenties par l’existence même du livre que nous tenons entre les mains ou de l’image que nous regardons. Remarquons que le sentiment qu’il n’existait plus de tache blanche sur la carte fut assez tôt exprimé, comme l’idée selon laquelle il n’était plus de mise de composer un Voyage. Au début du XIXe siècle prend corps l’idée selon laquelle l’expérience itinérante vaut avant tout pour les impressions ou le supplément d’être qu’elle procure, comme prêts à se convertir en mots. Il n’est pas sûr que nous soyons totalement sortis, aujourd’hui, de ce paradigme.
La condamnation du voyage et de son récit est un moyen particulièrement efficace de valoriser en retour un livre singulier dont on peut être assuré qu’il prendra ses distances avec les manières habituelles d’être, de faire, de voir et de dire. Il s’agit ici de stratégies de distinction. On songe, en particulier, à celui auquel il ne faut absolument pas ressembler : le touriste. Au demeurant, ces infractions volontaires à la norme se déclinent selon de multiples modalités : la lenteur sera préférée à la vitesse, l’errance au parcours à l’avance balisé, l’ordinaire à ce qui vaut la peine d’être vu, le proche au lointain... tous partis pris consistant à jouer avec des modèles et à proposer des manières de voyager qui se démarquent radicalement des usages courants. Il serait faux de réduire à un simple refus ou à un jeu ce qui relève également de l’éthique ou de préoccupations proprement ontologiques. Certains cherchent à se débarrasser de la peau du vieil homme, à se trouver ou à se perdre. D’autres entendent se tenir au plus près des réalités humaines ou naturelles qu’ils appréhendent. Il est bien possible que l’histoire du genre soit partiellement réductible à la série des solutions que chacun trouve pour relever les défis posés par la transcription de l’expérience itinérante. Les considérations sur la fin des voyages ne sont d’ailleurs que l’une des manifestations les plus visibles de l’inquiétude qui saisit tout relateur un tant soit peu conscient des tenants et aboutissants de sa production : interrogations quant aux insuffisances du langage, impossibilité de se départir de sa propre culture et de son histoire personnelle, difficulté à déchiffrer un monde complexe et dépourvu de centre... Les arguments ne manquent pas qui devraient conduire les voyageurs à cesser d’écrire et, surtout, de publier leurs récits ou de montrer leurs images. On sait qu’il n’en est rien et que prolifèrent aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire, des «récits de voyages» écrits, photographiés ou filmés. La Série Voyages contemporains aimerait écouter ce qu’ils ont à nous dire, en étant attentive à leur inscription dans une histoire des idées et des formes des XXe et XXIe siècles.
Philippe ANTOINE
Voyages contemporains 5 : “Chemins de France”
Philippe Antoine et Jean-Yves Laurichesse (dir.)
|
Si le développement des routes, et a fortiori des autoroutes, au long du xxe siècle, en même temps que celui de l’automobile, a considérablement rétréci le territoire national, le « voyage en France » n’étant plus l’aventure qu’il était encore par exemple pour Stendhal au temps des Mémoires d’un touriste, le pays n’en a pas moins conservé un vaste réseau de chemins hérités d’une très ancienne histoire des déplacements, attachés à un étroit territoire auquel se cantonnait généralement une population bien plus rurale et sédentaire qu’aujourd’hui. Ces « voie[s] de communication terrestre d'intérêt local, le plus souvent à la campagne, d'importance secondaire par rapport à la route » (Trésor de la langue française), si elles ont été malmenées par la modernité (par destruction, abandon, ou transformation en routes) au fil de l’évolution du monde rural, n’en font pas moins – et sans doute pour cette raison même – l’objet d’un intérêt persistant, voire d’une passion de la part des citadins désormais dominants démographiquement.
C’est cette réalité diverse des « chemins de France » aujourd’hui que ce numéro de la série « Voyages contemporains » souhaite explorer, à travers des œuvres écrites pour la plupart des années Soixante-dix à nos jours, alors que le monde rural séculaire avait définitivement basculé dans la modernité, entre zones « rurbaines » grignotées par la ville et zones désertifiées par l’exode rural, ce qui ne manquait pas de modifier les formes et les usages des chemins ; alors aussi que la littérature, qui avait largement délaissé, voire dédaigné dans |
l’après-guerre toute représentation de la ruralité, renouait progressivement avec elle dans le cadre d’un mouvement plus large de « retour au réel », après la grande période des expérimentations formelles. C’est pourquoi les œuvres étudiées ici appartiendront pour la plupart à ce qu’il est convenu d’appeler la non-fiction, relevant d’un régime référentiel qui semble être privilégié dans la mesure où les écrivains concernés relatent pour la plupart des expériences vécues de cheminement.
Sommaire
Introduction / Introduction, par Jean-Yves LAURICHESSE
1. Chemins et routes dans l’œuvre de Julien Gracq. Une géographie mythique et sentimentale / Roads and Paths in the Works of Julien Gracq. A Mythical and Sentimental Landscape, par Patrick MAROT
2. Imaginaire du chemin creux et chemin creux imaginaire. Esthétique de l’écriture de la nature chez Pierre Gascar / Imaginary of the Sunken Lane and Imaginary Sunken Lane. Aesthetics of the Writing of Nature in Pierre Gascar, par Pierre SCHOENTIES
3. Trassard en chemin / Trassard on the Way, par Jean-Yves LAURICHESSE
4. L’ivresse du cheminement. Sur l’œuvre provinciale de Jacques Réda / The Exhilaration of Strolling. On Jacques Réda’s Provincial Works, par Théo SOULA
5. Le livre des chemins. La France de Jacques Lacarrière / The Book of Paths. Jacques Lacarrière’s France, par Philippe ANTOINE
6. Sur les chemins noirs. Le viatique de Sylvain Tesson / Sur les chemins noirs. The Viaticum of Sylvain Tesson, par Sylviane COYAULT
7. « Ô saisons, ô canaux ! ». Rives et dérives du cheminement selon Jean Rolin / “Ô saisons, ô canaux!”. Shores and Excesses of the Path According to Jean Rolin, par Laurent DEMANZE
8. Et à côté coule une rivière. Remonter la Marne de Jean-Paul Kauffmann / A River Runs Beside It. Remonter la Marne by Jean-Paul Kauffmann, par Sylvie VIGNES
9. Une affaire d’échelle / A Matter of Scale, par Danièle MÉAUX
10. Cheminer comme dans la vie. Chemins et « lignes d’erre » selon Fernand Deligny / Walking as in Life. Pathways and “lignes d’erre” According to Fernand Deligny, par Rodolphe OLCÈSE
11. Cheminer comme un autre. approche multispécifique du chemin, d’après la philosophie du pistage de Baptiste Morizot / Walk like any other. Multi-species approach to the path, according to the tracking philosophy of Baptiste Morizot, par Alain ROMESTAING
12. Chemins de très petite randonnée. Trains à petite vitesse (TPV) / Very Short Hiking Trails. Low-Speed Trains, par Martin de LA SOUDIÈRE
Conclusion / Conclusion, par Philippe ANTOINE
Commander en ligne ici.
1. Chemins et routes dans l’œuvre de Julien Gracq. Une géographie mythique et sentimentale / Roads and Paths in the Works of Julien Gracq. A Mythical and Sentimental Landscape, par Patrick MAROT
2. Imaginaire du chemin creux et chemin creux imaginaire. Esthétique de l’écriture de la nature chez Pierre Gascar / Imaginary of the Sunken Lane and Imaginary Sunken Lane. Aesthetics of the Writing of Nature in Pierre Gascar, par Pierre SCHOENTIES
3. Trassard en chemin / Trassard on the Way, par Jean-Yves LAURICHESSE
4. L’ivresse du cheminement. Sur l’œuvre provinciale de Jacques Réda / The Exhilaration of Strolling. On Jacques Réda’s Provincial Works, par Théo SOULA
5. Le livre des chemins. La France de Jacques Lacarrière / The Book of Paths. Jacques Lacarrière’s France, par Philippe ANTOINE
6. Sur les chemins noirs. Le viatique de Sylvain Tesson / Sur les chemins noirs. The Viaticum of Sylvain Tesson, par Sylviane COYAULT
7. « Ô saisons, ô canaux ! ». Rives et dérives du cheminement selon Jean Rolin / “Ô saisons, ô canaux!”. Shores and Excesses of the Path According to Jean Rolin, par Laurent DEMANZE
8. Et à côté coule une rivière. Remonter la Marne de Jean-Paul Kauffmann / A River Runs Beside It. Remonter la Marne by Jean-Paul Kauffmann, par Sylvie VIGNES
9. Une affaire d’échelle / A Matter of Scale, par Danièle MÉAUX
10. Cheminer comme dans la vie. Chemins et « lignes d’erre » selon Fernand Deligny / Walking as in Life. Pathways and “lignes d’erre” According to Fernand Deligny, par Rodolphe OLCÈSE
11. Cheminer comme un autre. approche multispécifique du chemin, d’après la philosophie du pistage de Baptiste Morizot / Walk like any other. Multi-species approach to the path, according to the tracking philosophy of Baptiste Morizot, par Alain ROMESTAING
12. Chemins de très petite randonnée. Trains à petite vitesse (TPV) / Very Short Hiking Trails. Low-Speed Trains, par Martin de LA SOUDIÈRE
Conclusion / Conclusion, par Philippe ANTOINE
Commander en ligne ici.
Voyages contemporains 4 : “À plume et à pédales : voyages cyclistes”
Raphaël Piguet (dir.)
|
Comme le vélo lui-même, le voyage à vélo est généralement considéré avec une curiosité polie mais superficielle, ou relégué au rang de passe-temps pour les masochistes, les grands enfants et les moins fortunés, ou – le plus souvent – tout bonnement ignoré et absent des rayons de la littérature viatique. Dès son apparition cependant, ce premier véhicule mécanique autonome dont disposât le public s'imposa comme l'outil de choix tant des touristes débutants que des explorateurs chevronnés. L'engouement fut aussi passionné qu'éphémère : la voiture remplaça le vélo, non sans que les récits cyclistes n'aient eu le temps de se multiplier et de poser les jalons textuels d'une véritable pratique de l'espace, aussi discrète que révolutionnaire. Plus de cent ans après et dans un contexte fort différent, on redécouvre avec un émerveillement renouvelé les possibilités offertes par l'engin, et derechef les récits de voyage à vélo, de proximité ou au long cours, se remettent à proliférer.
Ce sont ces deux temps de l'histoire du voyage cycliste que le présent volume se propose d'explorer en suivant des axes historiques, sociologiques, politiques ou philosophiques. Mais il s'agit aussi d'étudier les deux temps de l'action du "moteur humain", qui appuie alternativement sur les pédales et sur la plume, et la connivence très tôt proclamée de ces deux objets qui, contre toute attente, semblent se soutenir mutuellement : on pédale pour mieux écrire, on écrit pour mieux pédaler, et la vieille analogie du Livre-Monde retrouve, dans le contexte cycliste, une fraîcheur et une pertinence inattendues. Le vélo, véhicule nécessaire du vrai voyage, instrument de la renaissance d'une |
littérature viatique sempiternellement agonisante, machine magique capable de s'élever contre les dérives d'un monde en perdition et d'entraîner avec lui ses usagers ? Moyen, pour le moins, d'une différence qui affecte le rapport à l'espace autant que le rapport au texte, produisant un léger décalage dont les études rassemblées ici tentent de mesurer les effets.
Sommaire
Introduction : En roue libre / Introduction : Freewheeling, par Raphaël PIGUET
1. Précyclule / Precycle, par Gérard BASTIDE
2. Un homme, une revue, un art du voyage : Vélocio et Le Cycliste (1887-1930) /
A Man, a Magazine, an Art of Travel. Vélocio and Le Cycliste (1887-1930), par Philippe ANTOINE
3. Le souffle épique de la littérature de voyage à vélo au service de l’engagement politique ? L’exemple méconnu d’Édouard de Perrodil (1860-1931) / The Epic Inspiration of Bicycle Travel Literature in the Service of Political Commitment? The Little-Known Example of Édouard de Perrodil (1860-1931), par Céline PIOT
4. Les premiers récits de voyages cyclistes en Italie (fin XIXe – début XXe). Immersion dans le réel ou échappées littéraires ? /
The First Accounts of Cycling Trips in Italy (late 19th – early 20th Century). Immersion in Reality or Literary Escape?, par Michela TOPPANO
5. Les roues de l’infortune. Récits cyclistes humoristiques / The Wheels of Misfortune. Humorous Cycling Stories, par Hélène DUBAIL
6. Bicyclette et sexualité féminine dans les discours sociaux de la Belle-Époque /
Bicycle and Female Sexuality in Belle-Époque Social Discourses, par Lucie NIZARD
7. La bicyclette s’en va-t-en guerre. Les récits de voyage à vélo dans la France des années 1940 /
The Bicycle Goes to War. Bicycle Travelogues in 1940s France, par Ariane DUPONT-KIEFFER et Anna KRUKUN
8. La bicyclette, instrument hétérotopique : l’entraînement poétique d’une machine à écrire /
The Bicycle as Heterotopic Instrument. The Poetic Momentum of a Writing Machine, par Laura CARVIGAN-CASSIN
9. Le Japon à vélo : expérience spatiale, de la tête aux pieds / Japan by Bike : Spatial Experience, from Head to Toe, par Sabrina MESSING
10. Le corps à l’ouvrage : Contribution à une poétique de l’effort cycliste /
Body and Soul at Work : A Contribution to the Poetics of Cycling Exertion, par Gilles LOUŸS
11. « La cadence effrénée de la route ». La vitesse réhabilitée par Emmanuel Ruben et Jean-Acier Danès /
“The Unbridled Pace of the Road”. Speed Restored by Emmanuel Ruben and Jean-Acier Danès, par Liouba BISCHOFF
12. Le vélo et la mort. Autopsie d’une passion cycliste / Bicycle and Death. Autopsy of a Cycling Passion, par Raphaël PIGUET
13. En résonance avec le monde / Resonating with the World, par Claude MARTHALER
Commander en ligne ici.
1. Précyclule / Precycle, par Gérard BASTIDE
2. Un homme, une revue, un art du voyage : Vélocio et Le Cycliste (1887-1930) /
A Man, a Magazine, an Art of Travel. Vélocio and Le Cycliste (1887-1930), par Philippe ANTOINE
3. Le souffle épique de la littérature de voyage à vélo au service de l’engagement politique ? L’exemple méconnu d’Édouard de Perrodil (1860-1931) / The Epic Inspiration of Bicycle Travel Literature in the Service of Political Commitment? The Little-Known Example of Édouard de Perrodil (1860-1931), par Céline PIOT
4. Les premiers récits de voyages cyclistes en Italie (fin XIXe – début XXe). Immersion dans le réel ou échappées littéraires ? /
The First Accounts of Cycling Trips in Italy (late 19th – early 20th Century). Immersion in Reality or Literary Escape?, par Michela TOPPANO
5. Les roues de l’infortune. Récits cyclistes humoristiques / The Wheels of Misfortune. Humorous Cycling Stories, par Hélène DUBAIL
6. Bicyclette et sexualité féminine dans les discours sociaux de la Belle-Époque /
Bicycle and Female Sexuality in Belle-Époque Social Discourses, par Lucie NIZARD
7. La bicyclette s’en va-t-en guerre. Les récits de voyage à vélo dans la France des années 1940 /
The Bicycle Goes to War. Bicycle Travelogues in 1940s France, par Ariane DUPONT-KIEFFER et Anna KRUKUN
8. La bicyclette, instrument hétérotopique : l’entraînement poétique d’une machine à écrire /
The Bicycle as Heterotopic Instrument. The Poetic Momentum of a Writing Machine, par Laura CARVIGAN-CASSIN
9. Le Japon à vélo : expérience spatiale, de la tête aux pieds / Japan by Bike : Spatial Experience, from Head to Toe, par Sabrina MESSING
10. Le corps à l’ouvrage : Contribution à une poétique de l’effort cycliste /
Body and Soul at Work : A Contribution to the Poetics of Cycling Exertion, par Gilles LOUŸS
11. « La cadence effrénée de la route ». La vitesse réhabilitée par Emmanuel Ruben et Jean-Acier Danès /
“The Unbridled Pace of the Road”. Speed Restored by Emmanuel Ruben and Jean-Acier Danès, par Liouba BISCHOFF
12. Le vélo et la mort. Autopsie d’une passion cycliste / Bicycle and Death. Autopsy of a Cycling Passion, par Raphaël PIGUET
13. En résonance avec le monde / Resonating with the World, par Claude MARTHALER
Commander en ligne ici.
Voyages contemporains 3 : “la littérature de voyage aujourd'hui : héritages et reconfigurations”
Philippe Antoine, Chloé Chaudet, Gilles Louÿs et Sarga Moussa (dir.)
|
Héritière du XIXe siècle, la littérature de voyage est devenue aujourd’hui un genre ouvert, pas seulement hybride (ce que le récit de voyage est depuis longtemps), mais plus libre qu’avant, que ce soit dans ses acteurs, dans ses destinations, dans ses représentations, dans ses styles et ses parlures, peut-être aussi dans ses formes narratives et dans ses supports médiatiques. Elle est désormais dotée d’une forte conscience de soi, fût-ce pour contester ses propres usages, pour déjouer les attentes de ses lecteurs en se mettant elle-même en cause – tout en continuant à dire le monde dans sa beauté, mais aussi dans sa fragilité.
Les contributions réunies dans ce volume ont mis l’accent sur de telles démarches critiques en analysant et en théorisant quelques-unes des reconfigurations qui sont à l’œuvre dans les littératures de voyage en langue française du temps présent – compte tenu de la dette qu’elles contractent vis-à-vis du passé. Elles jouent, notamment, sur trois paramètres : celui de la ou des voix qui portent le récit, de la distance qui est ménagée entre les pratiques du voyage et leur mise en intrigue, et des motifs et destinations du voyage. Il s’agit désormais d’inventer une langue et des formes, des modalités d’enquête, et un usage du monde qui soient à même de rendre compte de l’expérience complexe et plurielle de l’ailleurs. Une série d’énigmes est posée. Les textes et les images permettent de les formuler, à défaut de les résoudre. |
Sommaire
Préface, par Sarga MOUSSA
I. POÉTIQUES
1. De la « littérature voyageuse » à la littérature migrante ? / From « Travel Literature » to migrant literature ?, par Charles FORSDICK
2. Ce que raconter veut dire. Récits de voyage et vérités du voyage / What telling means. Travelogues and travel truth, par Jean-Didier URBAIN
3. Les stratégies du vide des voyageurs contemporains / Strategies of the void of contemporary travellers, par Jean-Xavier RIDON
4. Récit de voyage et genres littéraires. Une littérature à orientation géographique ? /
Travel narrative and literary genres. Geographic literature?, par Guillaume THOUROUDE
5. D’un corpus sans bords : la littérature de voyage au miroir de ses éditeurs français /
An Unlimited Corpus: French Travel Literature in its Publisher’s Mirror, par Gilles LOUŸS
II. GENRES ET MEDIA
6. Des écrivains à bord du Transsibérien / Writers aboard the Trans-Siberian, par Philippe ANTOINE
7. Le voyage-haïku ou comment résoudre la tension entre récit de voyage et poésie /
Haiku-Journey or How to Resolve the Tension between Travel Narrative and Poetry, par Muriel DÉTRIE
8. Théâtres en voyages : quelques pistes pour l’exploration de Terræ Incognitæ de la littérature viatique /
Travelling Theatre: Some Tracks for the Exploration of Terræ Incognitæ in Travel Literature, par Claudine LE BLANC
9. Le voyage décanté. Le Mystère Koumiko (Chris Marker, 1965) /
Decantation of Travel. The Koumiko Mystery (Chris Marker, 1965), par Guillaume SOULEZ
10. Voyages au cœur de la catastrophe / Journeys to the Heart of Catastrophe, par Danièle MÉAUX
III. CRISES ET CONTRE-NARRATIONS
11. Voyages sans ailleurs pour routards mondialisés / No Elsewhere Travels for Global-Trotters, par Olivier PENOT-LACASSAGNE
12. Voies de disparition : le mythe du voyage / Vanishing Ways. The Myth of Travel, par Raphaël PIGUET
13. Routes de la migration irrégulière : épreuves et récits (1974-2019) /
Roads of undocumented Migration: Trials and Narratives, par Catherine MAZAURIC
14. Le récit de voyage en palimpseste. Contre-narrations et récits de substitution dans les littératures francophones. /
Traveler’s Tales as a Palimpsest. Counter-narratives and Alternate Narrations in Francophone Literature, par Véronique PORRA
Conclusion, par Philippe ANTOINE
Commander en ligne ici.
I. POÉTIQUES
1. De la « littérature voyageuse » à la littérature migrante ? / From « Travel Literature » to migrant literature ?, par Charles FORSDICK
2. Ce que raconter veut dire. Récits de voyage et vérités du voyage / What telling means. Travelogues and travel truth, par Jean-Didier URBAIN
3. Les stratégies du vide des voyageurs contemporains / Strategies of the void of contemporary travellers, par Jean-Xavier RIDON
4. Récit de voyage et genres littéraires. Une littérature à orientation géographique ? /
Travel narrative and literary genres. Geographic literature?, par Guillaume THOUROUDE
5. D’un corpus sans bords : la littérature de voyage au miroir de ses éditeurs français /
An Unlimited Corpus: French Travel Literature in its Publisher’s Mirror, par Gilles LOUŸS
II. GENRES ET MEDIA
6. Des écrivains à bord du Transsibérien / Writers aboard the Trans-Siberian, par Philippe ANTOINE
7. Le voyage-haïku ou comment résoudre la tension entre récit de voyage et poésie /
Haiku-Journey or How to Resolve the Tension between Travel Narrative and Poetry, par Muriel DÉTRIE
8. Théâtres en voyages : quelques pistes pour l’exploration de Terræ Incognitæ de la littérature viatique /
Travelling Theatre: Some Tracks for the Exploration of Terræ Incognitæ in Travel Literature, par Claudine LE BLANC
9. Le voyage décanté. Le Mystère Koumiko (Chris Marker, 1965) /
Decantation of Travel. The Koumiko Mystery (Chris Marker, 1965), par Guillaume SOULEZ
10. Voyages au cœur de la catastrophe / Journeys to the Heart of Catastrophe, par Danièle MÉAUX
III. CRISES ET CONTRE-NARRATIONS
11. Voyages sans ailleurs pour routards mondialisés / No Elsewhere Travels for Global-Trotters, par Olivier PENOT-LACASSAGNE
12. Voies de disparition : le mythe du voyage / Vanishing Ways. The Myth of Travel, par Raphaël PIGUET
13. Routes de la migration irrégulière : épreuves et récits (1974-2019) /
Roads of undocumented Migration: Trials and Narratives, par Catherine MAZAURIC
14. Le récit de voyage en palimpseste. Contre-narrations et récits de substitution dans les littératures francophones. /
Traveler’s Tales as a Palimpsest. Counter-narratives and Alternate Narrations in Francophone Literature, par Véronique PORRA
Conclusion, par Philippe ANTOINE
Commander en ligne ici.
Voyages contemporains 2 : “voyages de l'extrême”
Gilles Louÿs (dir.)
|
Les récits de voyages extrêmes fascinent en ce qu’ils transmettent l’expérience d’hommes ou de femmes confrontés à des situations limites. Que ces limites soient géographiques (l’attirance des confins), environnementales (l’intensité paroxystique des éléments en certains endroits de la terre), physiologiques (le seuil vital en-deçà ou au-delà duquel la vie est compromise), comportementales (la prise de risque), psychologiques (la capacité à faire face à ce qui nous déborde), ou d’ordre cognitif (l’altérité radicale d’univers symboliques éloignés du nôtre), l’extrême est ce par quoi nous nommons ce qui nous excède ou nous effraie. Le présent ouvrage en évalue l’impact sur la sensibilité et la pensée à travers des expériences remarquables des XXe et XXIe siècles.
Sommaire
Introduction : Explorations ultimes, franchissements de soi : voyages extrêmes,
par Gilles LOUŸS 1. Le désert, espace de l’extrême chez Isabelle Eberhardt, par Rachel BOUVET 2. À la recherche de l’Ultima Thulé. Quelques voyageurs contemporains dans le Nord-Ouest groenlandais, par Jan BORM 3. Sylvain Tesson, de l’extrême comme nostalgie conquérante, par Jean-Xavier RIDON |
4. Dans la forêt profonde. Trois voyageurs français aux confins de l’expérience chamanique, par Gilles LOUŸS
5. Entre les lignes du sertão : la « leçon d’écriture » chamanique de Claude Lévi-Strauss, par Raphaël PIGUET
6. « Au bord d’un mystère» : De Ceylan au Tibet, David-Neel, Segalen et le bouddhisme, par Samuel THÉVOZ
7. « Il me restait l’Aventure… » : les voyageuses et l’extrême (1918-1939), par Valérie Boulain RENAUD
8. Le rouge et le blanc : Raymonde Carasco au pays des Tarahumaras, par Emmanuelle SAUVAGE
9. « Arpenter un désastre. » : voyage et témoignage (sur Fukushima de Michaël Ferrier), par Sarga MOUSSA
Commander en ligne ici.
5. Entre les lignes du sertão : la « leçon d’écriture » chamanique de Claude Lévi-Strauss, par Raphaël PIGUET
6. « Au bord d’un mystère» : De Ceylan au Tibet, David-Neel, Segalen et le bouddhisme, par Samuel THÉVOZ
7. « Il me restait l’Aventure… » : les voyageuses et l’extrême (1918-1939), par Valérie Boulain RENAUD
8. Le rouge et le blanc : Raymonde Carasco au pays des Tarahumaras, par Emmanuelle SAUVAGE
9. « Arpenter un désastre. » : voyage et témoignage (sur Fukushima de Michaël Ferrier), par Sarga MOUSSA
Commander en ligne ici.
Série Voyages contemporains
Voyages contemporains 1 : "voyages de la lenteur"
|
Voyager lentement, alors qu’il est aujourd’hui possible de se rendre en quelques heures en (à peu près) n’importe quel lieu de la planète, est avant tout une réaction — et une manière de se distinguer de ceux qui arpentent le monde en tous sens, en collectionnant à la hâte ces vues dont les guides s’accordent à dire qu’elles valent à elles seules le déplacement. Il est probable, en effet, que la vitesse soit aujourd’hui du côté de la norme. Il suffit de consulter n’importe quelle brochure vantant les merveilles de destinations offertes à l’homme pressé pour s’en convaincre : le temps est révolu des voyages qui accordaient, par nécessité, une place prépondérante au déplacement — au moins sur le plan quantitatif. Il est inutile aujourd’hui de déployer des trésors d’ingéniosité ou de faire preuve d’un quelconque esprit d’aventure pour atteindre et contempler des espaces prêts à s’offrir à l’admiration collective, et organisés pour accueillir un flux toujours croissant de curieux. En un sens, le voyage a été débarrassé du parcours et devient la somme des séjours parfois très brefs qui ont été sélectionnés dans un catalogue, au demeurant très riche, qui offre au consommateur potentiel une série de promesses souvent alléchantes. Il ne s’agit certes pas, ici, de moquer le touriste, et encore moins de le condamner : on ne voit pas très bien pourquoi le livre du monde devrait être la propriété exclusive d’oisifs fortunés, de voyageurs professionnels ou d’esthètes... Reste cependant l’agacement légitime que peut susciter la marchandisation de l’ailleurs et parfois, ce qui est plus grave, de l’autre.
|
Sans doute est-il étroitement corrélé à une forme de nostalgie : celle d’un temps où il était encore possible de croire aux découvertes de première main ou aux impressions inédites. Il est en tout cas fécond, car il donne lieu à des détournements subversifs qui renouvellent en profondeur la pratique et l’écriture du voyage.
S’attarder en un lieu donné, c’est choisir de l’appréhender différemment. Marcher en couvrant de longues distances conduit nécessairement à se montrer attentif au détail ou à l’ordinaire. Se promener, avec ce que ce terme implique de totale gratuité, revient à se rendre disponible aux sollicitations du monde et aux pensées qui traversent l’esprit. Les voyages de la lenteur ont vraisemblablement ceci de particulier qu’ils se prêtent à une saisie particulière de l’espace. Ils rendent en tout cas possible une rencontre véritable entre un homme et un lieu.
S’attarder en un lieu donné, c’est choisir de l’appréhender différemment. Marcher en couvrant de longues distances conduit nécessairement à se montrer attentif au détail ou à l’ordinaire. Se promener, avec ce que ce terme implique de totale gratuité, revient à se rendre disponible aux sollicitations du monde et aux pensées qui traversent l’esprit. Les voyages de la lenteur ont vraisemblablement ceci de particulier qu’ils se prêtent à une saisie particulière de l’espace. Ils rendent en tout cas possible une rencontre véritable entre un homme et un lieu.
Sommaire
voyages de la lenteur, par Philippe Antoine
1. Lenteur et étrangeté, par Jean-Xavier Ridon.
2. La Marche ou la passion de l’ordinaire. De quelques marcheurs en France : Lacarrière, Rolin, Picard, par Philippe Antoine.
3. En route avec Jacques Lacarrière ou la redécouverte de la France à pied, par Jan Borm.
4. Bernard Ollivier : le marcheur en point de mire, par Gérard Cogez.
5. Quand la lenteur du voyage mène à la profondeur. Un escargot sur l’autoroute du soleil, par Olivier Hambursin.
6. Les Passagers du Roissy-Express de François Maspero et Anaïk Frantz : « Laisser couler le temps », par Jean-Bernard Vray.
7. Le Fragment comme forme de la lenteur : l’art viatique de Julien Gracq, par Guillaume Pajon.
8. Derniers voyages avant disparition : voyage et conscience de la fin chez Dominique Noguez, par Fabien Gris.
9. Les Arrêts du temps ou le voyage en spirale. Nicolas Bouvier et Chris Marker, par Jean-François Guennoc.
10. Une autre manière de voyager. Les itinéraires du photographe Thierry Girard, par Danièle Méaux.
11. Mon Voyage d’hiver de Vincent Dieutre, sehr langsam, par Paul Léon.
Voyages contemporains 1 : “Voyages de la lenteur”. Philippe Antoine ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2010. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 232 p. 20 € ISBN 978-2-256-91157-6
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.