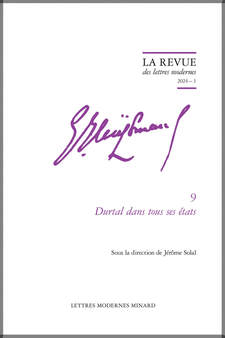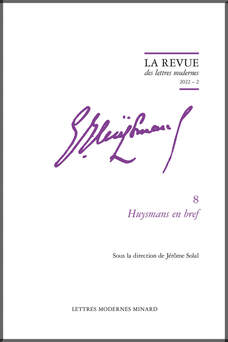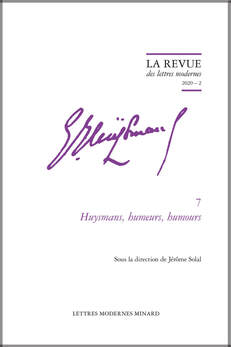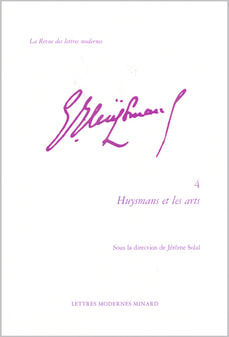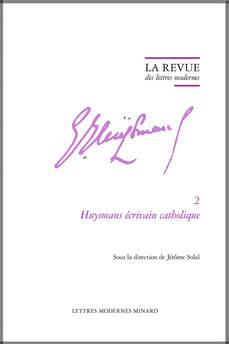Série Joris-Karl Huysmans
Dir. Jérôme Solal (2010)
Joris-Karl Huysmans occupe une place particulière dans la littérature française. Foncièrement lié à un mouvement littéraire, le Naturalisme, auquel dans une certaine mesure il restera fidèle toute sa vie, il donne cependant à son œuvre d’insignes changements d’orientation. On segmente ainsi souvent son parcours en phases successives. Après le naturalisme de ses débuts, on l’associe au décadentisme (dont il signe l’œuvre maîtresse, À rebours), au symbolisme dont il se rapproche par la recherche subtile de l’au-delà des choses, et au renouveau littéraire catholique de la période de l’« intersiècle ».
Huysmans est un romancier qui expérimente et qui provoque, mais aussi un poète en prose, un chroniqueur et un critique d’art que Fénéon qualifiera d’« inventeur de l’impressionnisme ». À travers ses sources d’inspiration et ses maîtres affichés — la figure paternelle des débuts, Zola, et la référence de toujours, Baudelaire —, il accompagne les grandes mutations du XIXe siècle moderne, tiraillé entre science et spiritualité. Il trouve ses marques dans ce débat et affiche une sensibilité aiguë à la société de son temps. Le dégoût est un aiguillon sûr, le sarcasme artiste se doit d’aimer son objet, en bien ou en mal.
Huysmans se montre également curieux des formes artistiques émergentes et, tout autant qu’il remet en cause la tradition littéraire, il la poursuit à sa manière. Lui qui aime se situer en dehors du monde des lettres sera aussi le premier président de l’Académie Goncourt. Il est ici et ailleurs, à l’écart et en dialogue avec les autres, en dehors de l’institution et en son sein le plus sûr. Ces facettes contradictoires dessinent une identité à la fois enracinée et mobile, tout en lui conférant une envergure qui légitime que lui soit consacrée une Série dans la collection « La Revue des lettres modernes ».
Parcourant le dernier quart du XIXe siècle (son premier livre, Le Drageoir à épices, voit le jour en 1874) et couvrant trente années d’activités jusqu’au début du XXe siècle (le dernier livre publié de son vivant, Les Foules de Lourdes, paraît en 1906), l’œuvre de Huysmans trouve naturellement sa place dans une collection dans le champ historique des lettres modernes. De même, la singularité de Huysmans entre en résonance avec la très grande majorité de ces Séries qui mettent l’accent sur la particularité irréductible de l’écrivain puisque, par principe, et dans leur nom même, elles portent sur lui en tant qu’auteur.
Pour avancer, la Série Huysmans tiendra compte à la fois de l’état d’une production contemporaine riche de la parution forcément dispersée d’éditions et d’ouvrages critiques, tout autant que de la pérennité du Bulletin Huysmans. Elle trouve en tout cas un terrain propice dans l’intérêt élargi dont témoigne la recherche universitaire et érudite à l’égard des multiples pans de l’œuvre de Huysmans, et peut ainsi être assurée de s’appuyer sur un large réseau d’auteurs d’horizons divers.
La Série Huysmans définira son territoire par sa capacité d’une part à s’organiser dans la durée en se donnant des perspectives de programmation, et d’autre part à coordonner de nouvelles études huysmansiennes qu’elle rassemblera autour d’axes spécifiques. Cette double démarche lui donnera son identité. Elle privilégiera une appréhension littéraire du corpus huysmansien, en se montrant ouverte à la pluralité des approches (génétique, générique, stylistique, sociologique, historique, thématique, psychanalytique, comparative…), sans négliger l’apport de documents rares ou inédits.
Jérôme Solal
Huysmans est un romancier qui expérimente et qui provoque, mais aussi un poète en prose, un chroniqueur et un critique d’art que Fénéon qualifiera d’« inventeur de l’impressionnisme ». À travers ses sources d’inspiration et ses maîtres affichés — la figure paternelle des débuts, Zola, et la référence de toujours, Baudelaire —, il accompagne les grandes mutations du XIXe siècle moderne, tiraillé entre science et spiritualité. Il trouve ses marques dans ce débat et affiche une sensibilité aiguë à la société de son temps. Le dégoût est un aiguillon sûr, le sarcasme artiste se doit d’aimer son objet, en bien ou en mal.
Huysmans se montre également curieux des formes artistiques émergentes et, tout autant qu’il remet en cause la tradition littéraire, il la poursuit à sa manière. Lui qui aime se situer en dehors du monde des lettres sera aussi le premier président de l’Académie Goncourt. Il est ici et ailleurs, à l’écart et en dialogue avec les autres, en dehors de l’institution et en son sein le plus sûr. Ces facettes contradictoires dessinent une identité à la fois enracinée et mobile, tout en lui conférant une envergure qui légitime que lui soit consacrée une Série dans la collection « La Revue des lettres modernes ».
Parcourant le dernier quart du XIXe siècle (son premier livre, Le Drageoir à épices, voit le jour en 1874) et couvrant trente années d’activités jusqu’au début du XXe siècle (le dernier livre publié de son vivant, Les Foules de Lourdes, paraît en 1906), l’œuvre de Huysmans trouve naturellement sa place dans une collection dans le champ historique des lettres modernes. De même, la singularité de Huysmans entre en résonance avec la très grande majorité de ces Séries qui mettent l’accent sur la particularité irréductible de l’écrivain puisque, par principe, et dans leur nom même, elles portent sur lui en tant qu’auteur.
Pour avancer, la Série Huysmans tiendra compte à la fois de l’état d’une production contemporaine riche de la parution forcément dispersée d’éditions et d’ouvrages critiques, tout autant que de la pérennité du Bulletin Huysmans. Elle trouve en tout cas un terrain propice dans l’intérêt élargi dont témoigne la recherche universitaire et érudite à l’égard des multiples pans de l’œuvre de Huysmans, et peut ainsi être assurée de s’appuyer sur un large réseau d’auteurs d’horizons divers.
La Série Huysmans définira son territoire par sa capacité d’une part à s’organiser dans la durée en se donnant des perspectives de programmation, et d’autre part à coordonner de nouvelles études huysmansiennes qu’elle rassemblera autour d’axes spécifiques. Cette double démarche lui donnera son identité. Elle privilégiera une appréhension littéraire du corpus huysmansien, en se montrant ouverte à la pluralité des approches (génétique, générique, stylistique, sociologique, historique, thématique, psychanalytique, comparative…), sans négliger l’apport de documents rares ou inédits.
Jérôme Solal
“Durtal dans tous ses états”
Série J.-K. Hysmans, vol. 9
|
Écrivain parisien, célibataire, Durtal est le héros peu héroïque de plusieurs romans de Huysmans qui forment une pentalogie : de Là-bas à L’Oblat, en passant par Là-haut, En route et La Cathédrale, Huysmans trace un itinéraire spirituel animé par l’idéal mystique. Durtal peine toutefois à trouver l’aise pérenne tant recherchée et ses séjours dans des lieux de foi restent guettés par l’indécision, l’ennui, l’usure et la précarité. Le cycle Durtal tourne dans le cercle maudit de cette infortune.
La première session du volume présente Durtal en général, dans la totalité de sa quête, circulant d’un roman à l’autre. Les textes de la seconde partie, qui saisissent Durtal en particulier, s’arrêtent à telle ou telle station de son parcours. Sommaire
Avant-propos, par Jérôme SOLAL
I. DURTAL, EN GÉNÉRAL 1. Durtal, héros de l’anti-modernité, par Jocelyn GODIVEAU |
2. Le Songe de Durtal, par Pascaline HAMON
3. Durtal musicien, par Dominique MILLET-GÉRARD
4. Deus absconditus : Huysmans, une spiritualité négative ?, par Alexandra DELATTRE
5. Durtal, catholique malade du catholicisme, par Émilie SERMADIRAS
6. La Disparition de Durtal (écrivain malgré lui), par Marc SMEETS
II. DURTAL, EN PARTICULIER
7. Le Chemin de Durtal ou la mystique à l’œuvre, par Vincent PETITJEAN
8. Le “petit roman” dans le roman de Durtal, par Marie PORTIER
9. Notre Dame des gouffres : Huysmans et La Salette, par François GADEYNE
10. L’Espace de Là-haut ou Durtal perché, par Jérôme SOLAL
11. En route, roman de formation ?, par Charles BRION
12. Un Augustin fin-de-siècle : Durtal au miroir des Confessions, par Édouard GARANCHER
13. Vie contemplative ou vie active ? Durtal et la cathédrale, par Nadia FARTAS
Commander en ligne ici.
3. Durtal musicien, par Dominique MILLET-GÉRARD
4. Deus absconditus : Huysmans, une spiritualité négative ?, par Alexandra DELATTRE
5. Durtal, catholique malade du catholicisme, par Émilie SERMADIRAS
6. La Disparition de Durtal (écrivain malgré lui), par Marc SMEETS
II. DURTAL, EN PARTICULIER
7. Le Chemin de Durtal ou la mystique à l’œuvre, par Vincent PETITJEAN
8. Le “petit roman” dans le roman de Durtal, par Marie PORTIER
9. Notre Dame des gouffres : Huysmans et La Salette, par François GADEYNE
10. L’Espace de Là-haut ou Durtal perché, par Jérôme SOLAL
11. En route, roman de formation ?, par Charles BRION
12. Un Augustin fin-de-siècle : Durtal au miroir des Confessions, par Édouard GARANCHER
13. Vie contemplative ou vie active ? Durtal et la cathédrale, par Nadia FARTAS
Commander en ligne ici.
“Huysmans en bref”
Série J.-K. Hysmans, vol. 8
|
Pour Huysmans, la concision littéraire offre un gain de temps, de sens et de beauté. Elle intensifie. Moins c’est plus. Réduire un roman à un poème en prose, c’est le faire rayonner davantage. Mais la brièveté chez Huysmans ne suit pas la seule voie de la poésie en prose, elle emprunte d’autres pistes d’écriture – autoportraits, articles de presse, nouvelles, préfaces, critique d’art, pantomime – où s’exercent en bref quatre pouvoirs de l’écrivain : Brosser, Raconter, Expliciter et Fantasmer.
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme SOLAL
I. BROSSER – AUTOPORTRAITS ET CROQUIS 1. Huysmans sur Huysmans, par Per BUVIK 2. L’Œil de Huysmans : l’art de la description entre journalisme et littérature, par Alexia KALANTZIS 3. Huysmans et la « mélancolique Bièvre », par Jérôme SOLAL |
II. RACONTER – NOUVELLES
4. Huysmans ou l’art moderne de la nouvelle, par Bertrand BOURGEOIS
5. Huysmans en bref : le goût pour l’excentricité dans les nouvelles, par Alexandre LEROY
6. Les Soirées de Médan, trois modes ironiques : Zola, Huysmans, Maupassant, par Kelly BENOUDIS BASILIO
7. Un dilemme (1887) ou la tentation du bonheur bourgeois, par Arnaud VAREILLE
8. La Retraite de Monsieur Bougran ou l’emprise d’un habitus culturel, par Marie-France AMARA
III. EXPLICITER – PRÉFACES ET CRITIQUE D’ART
9. Huysmans préfacier : Jalons à l’histoire de l’art sacré au xixe siècle, par Alexandra DELATTRE
10. Du coup de pinceau au coup d’œil : la description de tableau, par Aude JEANNEROD
11. Joris-Karl Huysmans au Louvre : l’enchantement de l’énigme, par Florence PETTELAT
IV. FANTASMER – PANTOMIME
12. Pierrot sceptique, introuvable pantomime, par Renaud OULIÉ
13. Le Bref et l’Infini dans Pierrot au sérail et Pierrot sceptique, par Mohamed Yosri BEN HEMDENE
Commander en ligne ici.
4. Huysmans ou l’art moderne de la nouvelle, par Bertrand BOURGEOIS
5. Huysmans en bref : le goût pour l’excentricité dans les nouvelles, par Alexandre LEROY
6. Les Soirées de Médan, trois modes ironiques : Zola, Huysmans, Maupassant, par Kelly BENOUDIS BASILIO
7. Un dilemme (1887) ou la tentation du bonheur bourgeois, par Arnaud VAREILLE
8. La Retraite de Monsieur Bougran ou l’emprise d’un habitus culturel, par Marie-France AMARA
III. EXPLICITER – PRÉFACES ET CRITIQUE D’ART
9. Huysmans préfacier : Jalons à l’histoire de l’art sacré au xixe siècle, par Alexandra DELATTRE
10. Du coup de pinceau au coup d’œil : la description de tableau, par Aude JEANNEROD
11. Joris-Karl Huysmans au Louvre : l’enchantement de l’énigme, par Florence PETTELAT
IV. FANTASMER – PANTOMIME
12. Pierrot sceptique, introuvable pantomime, par Renaud OULIÉ
13. Le Bref et l’Infini dans Pierrot au sérail et Pierrot sceptique, par Mohamed Yosri BEN HEMDENE
Commander en ligne ici.
“Huysmans, Humeurs, humours”
Série J.-K. Hysmans, vol. 7
|
L’orthographe quasi jumelle d’humeur et d’humour témoigne de leur origine commune. Après des siècles et quelques migrations, le mot latin s’est découplé, l’humeur naviguant entre médecine et psychologie, l’humour s’amusant des incongruités du réel. Écrivain naturaliste, Huysmans explore les sanies de son époque, mauvais esprit, il lâche la bride à ses humeurs. Il invente l’humour noir et pointe dans ses textes un monde où le rire, après quelques secousses, nous laisse sur le qui-vive. (à paraître le 19 février 2020)
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme SOLAL
PREMIÈRE PARTIE : HUMEURS 1. Éléments pour une « hygrologie » huysmansienne : codes naturalistes et phénoménologie mystique, par Laure de LA TOUR 2. Le Colérique et l’atrabilaire : Bloy, Huysmans et la théorie des humeurs, par Gaëlle GUYOT-ROUGE |
3. Huysmans gourmand ?, par Alexandre LEROY
4. Miss Urania, l’Américaine, par Philippe GEINOZ
5. La Sensibilité aristocratique de Huysmans, par Élise SOREL
6. Huysmans polémiste anticlérical : Les Rêveries d’un croyant grincheux, par Jean-Marie SEILLAN
7. « Un bénédictin qui serait très artiste » : Huysmans et la passion du Moyen Âge, par Elizabeth EMER
DEUXIÈME PARTIE : HUMOURS
8. Le Comble de la mélancolie, par Sylvie THOREL
9. Crise capillaire et humour blanc : Huysmans et le merlan, par Jérôme SOLAL
10. La Guerre de 1870 par les entrailles : rires, humour et ironie dans une contre-épopée naturaliste, Sac au dos de J.-K. Huysmans,
par Nicolas BIANCHI
11. L’Humour de J.-K. Huysmans dans les récits de voyage, par Laurence DECROOCQ
12. L’Hagiographie comique dans « Sainte Débarras » et « Célestin Godefroy Chicard », par Régis Mikail ABUD FILHO
13. Ironiser avec Huysmans : l’écriture comique de Houellebecq dans Soumission, par Bertrand BOURGEOIS
Commander en ligne ici.
4. Miss Urania, l’Américaine, par Philippe GEINOZ
5. La Sensibilité aristocratique de Huysmans, par Élise SOREL
6. Huysmans polémiste anticlérical : Les Rêveries d’un croyant grincheux, par Jean-Marie SEILLAN
7. « Un bénédictin qui serait très artiste » : Huysmans et la passion du Moyen Âge, par Elizabeth EMER
DEUXIÈME PARTIE : HUMOURS
8. Le Comble de la mélancolie, par Sylvie THOREL
9. Crise capillaire et humour blanc : Huysmans et le merlan, par Jérôme SOLAL
10. La Guerre de 1870 par les entrailles : rires, humour et ironie dans une contre-épopée naturaliste, Sac au dos de J.-K. Huysmans,
par Nicolas BIANCHI
11. L’Humour de J.-K. Huysmans dans les récits de voyage, par Laurence DECROOCQ
12. L’Hagiographie comique dans « Sainte Débarras » et « Célestin Godefroy Chicard », par Régis Mikail ABUD FILHO
13. Ironiser avec Huysmans : l’écriture comique de Houellebecq dans Soumission, par Bertrand BOURGEOIS
Commander en ligne ici.
“À rebours”, attraction, désastre : 2–Désastre”
Série J.-K. Hysmans, vol. 6
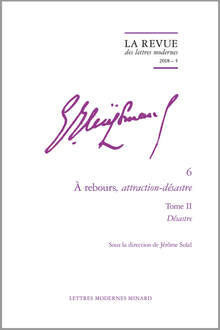
Dans le ciel brouillé de 1884, Huysmans impose l’éclat d’À rebours. Jouant avec les codes et les savoirs, il écrit un roman à la fois exemplaire et antidote du naturalisme. Le Mal fleurit sous toutes ses formes dans les vitrines d’un récit apparemment sans intrigue. Homo duplex, son héros, solitaire reclus, oscille entre aise et malaise. Mis au supplice par la loi du Corps physiologique et social, il quitte le sublime étouffoir qu’il s’est construit. Second volet du numéro double À rebours, attraction-désastre, ce volume examine ce qui dans le chef-d’œuvre de Huysmans fait désastre.
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme Solal
PREMIÈRE PARTIE — DÉSACCORDS
La Médecine d’À rebours, par Sylvie Thorel
Zola et la « lanterne magique » d’À rebours, par Soundouss El Kettani
J.-K. Huysmans face a la critique italienne : Matilde Serao contre À rebours, Francesca Guglielmi
DEUXIÈME PARTIE — DUPLICITÉ, DÉCHIREMENTS
Des Esseintes en son « cloître profane » : Une expérimentation vouée au désastre, par Benoîte de Montmorillon-Boutron
L’« horrible charme » du réel dans À rebours, par Émilie Pezard
Des Esseintes au secret : Entre élection et déréliction, par Amandine Lefèvre
À rebours : l’attraction du désastre, par Laurence Decroocq
À rebours : œuvre romantique ou romanesque ? Une lecture girardienne des désirs de Des Esseintes, par Éléonore Sibourg
TROISIÈME PARTIE — DÉROUTE
De la défaillance à la faille : Deux aspects de la névrose de Des Esseintes, par Laure de La Tour
Gastronomie, deuil et ritualité, par Geneviève Sicotte
Des hommes et des dieux : Des Esseintes face au Mal, Agata Sadkowska-Fidala
Le Désastre de la femme dans À rebours, par Cecilia Carlander
À rebours : vie et mort désastreuse d’une tortue, par Gaëlle Guyot-Rouge
Commander en ligne ici.
PREMIÈRE PARTIE — DÉSACCORDS
La Médecine d’À rebours, par Sylvie Thorel
Zola et la « lanterne magique » d’À rebours, par Soundouss El Kettani
J.-K. Huysmans face a la critique italienne : Matilde Serao contre À rebours, Francesca Guglielmi
DEUXIÈME PARTIE — DUPLICITÉ, DÉCHIREMENTS
Des Esseintes en son « cloître profane » : Une expérimentation vouée au désastre, par Benoîte de Montmorillon-Boutron
L’« horrible charme » du réel dans À rebours, par Émilie Pezard
Des Esseintes au secret : Entre élection et déréliction, par Amandine Lefèvre
À rebours : l’attraction du désastre, par Laurence Decroocq
À rebours : œuvre romantique ou romanesque ? Une lecture girardienne des désirs de Des Esseintes, par Éléonore Sibourg
TROISIÈME PARTIE — DÉROUTE
De la défaillance à la faille : Deux aspects de la névrose de Des Esseintes, par Laure de La Tour
Gastronomie, deuil et ritualité, par Geneviève Sicotte
Des hommes et des dieux : Des Esseintes face au Mal, Agata Sadkowska-Fidala
Le Désastre de la femme dans À rebours, par Cecilia Carlander
À rebours : vie et mort désastreuse d’une tortue, par Gaëlle Guyot-Rouge
Commander en ligne ici.
“À rebours”, attraction, désastre : 1–Attraction
Série J.-K. Hysmans, vol. 5
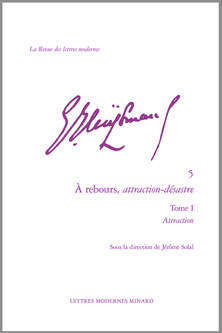
Avec À rebours, Huysmans écrit son chef-d’œuvre : récit de la singularité, roman expérimental, œuvre-somme et livre-phare. Plantant le décor fin-de-siècle, À rebours porte haut la fantaisie et l’ascèse, la floraison des désirs et la soif d’idéal. Avec l’étude d’un cas clinique de névrose il déconstruit la narration. Il retire de son milieu un sujet pour l’observer hors contexte : comment peut-on vivre souverainement dans la bulle d’une « thébaïde raffinée » dont l’attraction est aussi irrésistible qu’inéluctable le désastre auquel elle prépare ? Appariements, affinités, aspirations : le premier volet du numéro double À rebours, attraction-désastre scrute ce qui dans le roman fait attraction.
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme SOLAL
I – APPARIEMENTS
Monsieur Rien de Commun et Monsieur Comme tout le Monde, par Jean BORIE
J.-K. Huysmans et ses masques. L’anti-héros des Esseintes et le non-héros Durtal, par Carine ROUCAN
Des Esseintes lecteur de Huysmans, par Marc SMEETS
Décadence d’un archétype du décadentisme. Jean Lorrain lecteur d’À rebours, par Morgane LERAY
II–AFFINITÉS
À rebours comme « poème du désert », une anachorèse avortée ?, par Delphine DURAND
À rebours, roman de la délectation morose, par Bernard GENDREL
Tirer À rebours vers l’au-delà. Une attraction catholique antinaturaliste, par Bertrand BOURGEOIS
« Dans À rebours la rage paraît ». Huysmans, l’anarchie et l’attraction du désastre, par Jean-Marie SEILLAN
III–ASPIRATIONS
L’Homosexualité dans À rebours. Synthèse et perspectives, par Romain COURAPIED
Ni tout à fait sérieuse, ni tout à fait comique. À propos de la représentation de la perversion dans le chapitre 9, par Per BUVIK
Les « Végétations monstrueuses de la pensée ». Aux racines de l’attraction, par Valérie ROUX
Une tortue qui s’évade par la fenêtre. Attrait et vertige de l’aération dans À rebours, par Sophie PELLETIER
Des Esseintes en quête de joie. À rebours, de l’euphorie à l’enthousiasme, par Samuel LAIR
Commander en ligne ici.
I – APPARIEMENTS
Monsieur Rien de Commun et Monsieur Comme tout le Monde, par Jean BORIE
J.-K. Huysmans et ses masques. L’anti-héros des Esseintes et le non-héros Durtal, par Carine ROUCAN
Des Esseintes lecteur de Huysmans, par Marc SMEETS
Décadence d’un archétype du décadentisme. Jean Lorrain lecteur d’À rebours, par Morgane LERAY
II–AFFINITÉS
À rebours comme « poème du désert », une anachorèse avortée ?, par Delphine DURAND
À rebours, roman de la délectation morose, par Bernard GENDREL
Tirer À rebours vers l’au-delà. Une attraction catholique antinaturaliste, par Bertrand BOURGEOIS
« Dans À rebours la rage paraît ». Huysmans, l’anarchie et l’attraction du désastre, par Jean-Marie SEILLAN
III–ASPIRATIONS
L’Homosexualité dans À rebours. Synthèse et perspectives, par Romain COURAPIED
Ni tout à fait sérieuse, ni tout à fait comique. À propos de la représentation de la perversion dans le chapitre 9, par Per BUVIK
Les « Végétations monstrueuses de la pensée ». Aux racines de l’attraction, par Valérie ROUX
Une tortue qui s’évade par la fenêtre. Attrait et vertige de l’aération dans À rebours, par Sophie PELLETIER
Des Esseintes en quête de joie. À rebours, de l’euphorie à l’enthousiasme, par Samuel LAIR
Commander en ligne ici.
Huysmans et les arts
Série J.-K. Hysmans, vol. 4
|
Quatrième volume de la Série « Joris-Karl Huysmans » de la collection « La Revue des lettres modernes », Huysmans et les arts offre treize contributions qui éclairent la relation de Huysmans à l’art, spécialement la peinture, sans oublier la musique et l’architecture.
Huysmans est un œil qui jouit de voir et d’imaginer. Il pratique la critique d’art avec constance, s’intéressant à la fois aux artistes de son temps – impressionnistes, peintres des marges de la société, symbolistes – et à ceux du passé – Primitifs, peintres de l’âge d’or flamand. Son discours sur les arts l’ouvre à une libre réflexion sur la modernité et sur les pouvoirs de la littérature qui, comme la peinture, explore son siècle et s’en échappe. SommaireAvant-propos, par Jérôme Solal.
I – ART CONTEMPORAIN : PEINTURE ET MUSIQUE 1. “Se débrouiller l’œil” : Huysmans face à Monet et Pissarro, par Aude Jeannerod. |
2. Huysmans et Degas briseurs d’images : les miroirs de la représentation, par Éléonore Sibourg.
3. Huysmans et Raffaëlli : regards croisés, par Clément Siberchicot.
4. Joris-Karl Huysmans et Jean-Louis Forain : conversions croisées, par Chantal Vinet.
5. Peindre les ruines de l’Empire : Huysmans et Zola face à l’œuvre de Gustave Moreau, par Nicolas Valazza.
6. De l’épiphanie du poison à la danse des tréponèmes : une contamination picturale huysmansienne, par Delphine Durand.
7. Huysmans-Whistler : de “lestes et profonds accords”, par Ludmila Virassamynaïken.
8. « L’Ouverture de Tannhäuser » ou l’imagination concrète de Huysmans, par Arnaud Vareille.
II – ART ANCIEN : PEINTURE ET ARCHITECTURE
9. Huysmans esthète et antisémite : hantise à Francfort, par Jérôme Solal.
10. Ut pictura poesis : Huysmans, la critique d’art et le poème en prose, par Bernard Bourgeois.
11. Le Drageoir : un objet littéraire et artistique, par Jonathan Devaux.
12. Huysmans et l’art religieux, par Gaël Prigent.
13. Huysmans et l’architecture, par Joëlle Prungnaud
Commander en ligne ici.
3. Huysmans et Raffaëlli : regards croisés, par Clément Siberchicot.
4. Joris-Karl Huysmans et Jean-Louis Forain : conversions croisées, par Chantal Vinet.
5. Peindre les ruines de l’Empire : Huysmans et Zola face à l’œuvre de Gustave Moreau, par Nicolas Valazza.
6. De l’épiphanie du poison à la danse des tréponèmes : une contamination picturale huysmansienne, par Delphine Durand.
7. Huysmans-Whistler : de “lestes et profonds accords”, par Ludmila Virassamynaïken.
8. « L’Ouverture de Tannhäuser » ou l’imagination concrète de Huysmans, par Arnaud Vareille.
II – ART ANCIEN : PEINTURE ET ARCHITECTURE
9. Huysmans esthète et antisémite : hantise à Francfort, par Jérôme Solal.
10. Ut pictura poesis : Huysmans, la critique d’art et le poème en prose, par Bernard Bourgeois.
11. Le Drageoir : un objet littéraire et artistique, par Jonathan Devaux.
12. Huysmans et l’art religieux, par Gaël Prigent.
13. Huysmans et l’architecture, par Joëlle Prungnaud
Commander en ligne ici.
Huysmans, ou comment extraire la poésie de la prose
Série J.-K. Hysmans, vol. 3
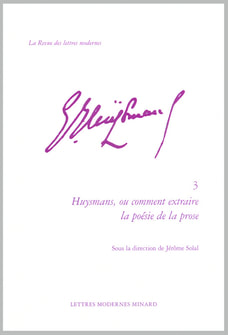
L’appartenance générique n’y fait rien : avènement de spiritualité et de rythme, la poésie peut investir tout texte, en vers comme en prose. Huysmans rejette la tentation poétique qui s’enferre dans le vers et, à deux reprises, s’essaye à la “poésie en prose”, née au mitan du siècle, puis l’abandonne : c’est dans l’étoffe romanesque qu’il trouvera son souffle propre et ses visions en mettant en forme, poétiquement, la réalité brutale et triviale.
Les treize textes qui composent ce volume questionnent la nature du lien entre le poétique et le prosaïque, entre l’obsession de la beauté et la conscience d’une réalité dégradée : Huysmans, ou comment extraire la poésie de la prose.
Les treize textes qui composent ce volume questionnent la nature du lien entre le poétique et le prosaïque, entre l’obsession de la beauté et la conscience d’une réalité dégradée : Huysmans, ou comment extraire la poésie de la prose.
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme Solal.
I – PREMIERS PAS
1. Poésie en prose et prose poétique : le cas du Drageoir aux épices de Huysmans, par Patrice Locmant.
2. De l’“of meat” poétique chez Huysmans : le poème en prose et la description picturale, par Jérémy Lambert.
3. Poétique picturale de la prose dans Le Drageoir aux épices et les « Croquis et eaux-fortes », par Aude Jeannerod.
II – PROMENADES PARISIENNES
4. Croquis quotidien (Croquis parisiens), par Marc Smeets.
5. Croquis parisiens : la différence de Huysmans, par Éléonore Reverzy.
6. Chemins de prose : Huysmans et l’écriture déambulatoire, par Henri Scepi.
III – PRINCIPES
7. À rebours, un nouvel art (poétique) moderne ?, par Benoîte Boutron.
8. Poétique du plein chant : du latin profane à l’“idiome catholique”, par Catherine Haman-Dhersin.
9. La Poétique huysmansienne du poème en prose, entre théorie et pratique, par Émilie Pezard.
IV – PASSERELLES
10. À la recherche d’une poétique : les poèmes en prose du Drageoir aux épices face aux romans, par Stéphanie Guérin-Marmigère.
11. Pour une poésie administrative, par Alice De George-Métral.
12. Le Cercle des poetae minores, par Sylvie Thore.
13. Le Poème en prose au risque des images, par Camille Fillot.
INDEX DES NOMS
INDEX DES ŒUVRES
RÉSUMÉ DES TEXTES
Commander en ligne ici.
I – PREMIERS PAS
1. Poésie en prose et prose poétique : le cas du Drageoir aux épices de Huysmans, par Patrice Locmant.
2. De l’“of meat” poétique chez Huysmans : le poème en prose et la description picturale, par Jérémy Lambert.
3. Poétique picturale de la prose dans Le Drageoir aux épices et les « Croquis et eaux-fortes », par Aude Jeannerod.
II – PROMENADES PARISIENNES
4. Croquis quotidien (Croquis parisiens), par Marc Smeets.
5. Croquis parisiens : la différence de Huysmans, par Éléonore Reverzy.
6. Chemins de prose : Huysmans et l’écriture déambulatoire, par Henri Scepi.
III – PRINCIPES
7. À rebours, un nouvel art (poétique) moderne ?, par Benoîte Boutron.
8. Poétique du plein chant : du latin profane à l’“idiome catholique”, par Catherine Haman-Dhersin.
9. La Poétique huysmansienne du poème en prose, entre théorie et pratique, par Émilie Pezard.
IV – PASSERELLES
10. À la recherche d’une poétique : les poèmes en prose du Drageoir aux épices face aux romans, par Stéphanie Guérin-Marmigère.
11. Pour une poésie administrative, par Alice De George-Métral.
12. Le Cercle des poetae minores, par Sylvie Thore.
13. Le Poème en prose au risque des images, par Camille Fillot.
INDEX DES NOMS
INDEX DES ŒUVRES
RÉSUMÉ DES TEXTES
Commander en ligne ici.
Joris-Karl Huysmans 2 : “Huysmans écrivain catholique”
|
La conversion est le retournement de l’erreur impie en pieuse vérité. Après la tentation de Satan, dont Là-bas fait le récit, Huysmans écrit le livre « blanc » de Là-haut et se met en route vers Dieu. Toutefois l’écrivain, converti, restera un littérateur célibataire avançant à pas comptés.
Le volume propose d’abord d’examiner le corpus de l’auteur du cycle romanesque de Durtal, qui use aussi de l’hagiographie et, avant la conversion, écrit un À rebours qu’infuse déjà la question religieuse. Puis il s’intéresse au ciment contextuel et intertextuel à partir duquel s’est bâtie l’œuvre « catholique », et pour finir apporte un éclairage plus précis sur la relation de Huysmans aux écrivains catholiques de son temps. Sommaire
Avant-propos, par Jérôme Solal
I. CORPUS 1. Huysmans et la trilogie, par Alain VIRCONDELET. 2. Durtal, d’une mystique personnelle à la mystique de son temps, par Romain JALABERT |
3. Esquisse biographique sur Don Bosco : une œuvre cachée par Huysmans, par Francesca GUGLIELMI, avec treize comptes rendus et une lettre inédite de Huysmans (notes et traduction par Francesca GUGLIELMI).
4. Le Pédophile et le pédophobe : Don Bosco et Huysmans, par Jérôme SOLAL.
5. Art de la religion et religion de l’art dans À rebours, par Emmanuelle ROIG.
II. CIMENT
6. L’Abbé Mugnier, correspondant, confesseur, confident, par Samuel LAIR.
7. Le « sélam pieux ». Le jardin liturgique de Ligugé dans le Carnet vert et dans tous ses états, par Sylvie DURAN.
8. Huysmans et Job, par Gaël PRIGENT.
9. Huysmans et les Christs décadents, par Jean-Marie SEILLAN.
III. CATHOLIQUES
10. Les deux voies parallèles de l’écriture romanesque : une mise en pratique du naturalisme spiritualiste chez Barbey d’Aurevilly et Huysmans, par Alice DE GEORGES-MÉTRAL.
11. Le Catholique de désir et le catholique d’instinct. Huysmans et Villiers de l’Isle-Adam au temps du « Concile des Gueux » (1886-1889), par Marc BÉGHIN.
12. Huysmans et Verlaine. Deux écritures de l’expérience religieuse, par Michel VIEGNES.
13. Delacroix sous le regard catholique de Huysmans et de Claudel, par Marie-Victoire NANTET.
Commander en ligne ici.
4. Le Pédophile et le pédophobe : Don Bosco et Huysmans, par Jérôme SOLAL.
5. Art de la religion et religion de l’art dans À rebours, par Emmanuelle ROIG.
II. CIMENT
6. L’Abbé Mugnier, correspondant, confesseur, confident, par Samuel LAIR.
7. Le « sélam pieux ». Le jardin liturgique de Ligugé dans le Carnet vert et dans tous ses états, par Sylvie DURAN.
8. Huysmans et Job, par Gaël PRIGENT.
9. Huysmans et les Christs décadents, par Jean-Marie SEILLAN.
III. CATHOLIQUES
10. Les deux voies parallèles de l’écriture romanesque : une mise en pratique du naturalisme spiritualiste chez Barbey d’Aurevilly et Huysmans, par Alice DE GEORGES-MÉTRAL.
11. Le Catholique de désir et le catholique d’instinct. Huysmans et Villiers de l’Isle-Adam au temps du « Concile des Gueux » (1886-1889), par Marc BÉGHIN.
12. Huysmans et Verlaine. Deux écritures de l’expérience religieuse, par Michel VIEGNES.
13. Delacroix sous le regard catholique de Huysmans et de Claudel, par Marie-Victoire NANTET.
Commander en ligne ici.
Joris-Karl Huysmans 1 : “figures et fictions du Naturalisme”
|
Les treize contributions de ce premier numéro de la Série Huysmans font d’abord surgir différentes figures du naturalisme familières de Huysmans, puis scrutent les fictions du jeune écrivain. Par la minutie de la documentation, la mise à plat des ressorts narratifs et le souci de fidélité au réel, Huysmans noue un lien fort et durable avec l’esthétique naturaliste. Le document ne suffisant pas à faire littérature, le naturalisme se nourrit de fictions et celles de Huysmans tournent autour des vicissitudes du besoin et du désir. Aimanté par les au-delà, le disciple zélé construit peu à peu ses propres tropismes, avançant avec et contre l’école littéraire dont il est issu.
Sommaire
Avant-propos, par Jérôme SOLAL
I. FIGURES 1. Huysmans, naturaliste malgré lui ?, par René-Pierre COLIN. 2. Huysmans et Goncourt : le naturalisme artiste, par Pierre-Jean DUFIEF. |
3. Huysmans et l’affaire du journal Les Cloches de Paris, par Philippe BARASCUD, suivi de « Dig-Din-Don » et de « La Demi-douzaine », par A. Tilsitt (notes par Philippe BARASCUD).
4. À l’aune du naturalisme : J.-K. Huysmans aux Pays-Bas, par Marc SMEETS.5. Les Paysans dans l’œuvre de Huysmans : à rebours de ceux de Maupassant ?, par Noëlle BENHAMOU.
6. Le Diable est dans les détails : Huysmans et Mirbeau en marge, par Samuel LAIR.
II. FICTIONS
7. Gastronomie naturaliste et bœuf à la mode huysmansienne, par Laurence DECROOCQ.
8. Huysmans et la femme de “La Faim”, par Jérôme SOLAL.
9. Huysmans naturaliste. Prostitution et littérature, par Éléonore REVERZY.
10. La Madone et la putain, par Jeannine PAQUE.
11. Là-bas, livre noir de l’hystérie ? Pour une esthétique de la déchirure et de l’inversion, par Céline GRENAUD.
12. L’Art de la compassion, par Sylvie THOREL.
13. Des Esseintes, Barnabooth, le luxe, le voyage, par Jean BORIE.
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
4. À l’aune du naturalisme : J.-K. Huysmans aux Pays-Bas, par Marc SMEETS.5. Les Paysans dans l’œuvre de Huysmans : à rebours de ceux de Maupassant ?, par Noëlle BENHAMOU.
6. Le Diable est dans les détails : Huysmans et Mirbeau en marge, par Samuel LAIR.
II. FICTIONS
7. Gastronomie naturaliste et bœuf à la mode huysmansienne, par Laurence DECROOCQ.
8. Huysmans et la femme de “La Faim”, par Jérôme SOLAL.
9. Huysmans naturaliste. Prostitution et littérature, par Éléonore REVERZY.
10. La Madone et la putain, par Jeannine PAQUE.
11. Là-bas, livre noir de l’hystérie ? Pour une esthétique de la déchirure et de l’inversion, par Céline GRENAUD.
12. L’Art de la compassion, par Sylvie THOREL.
13. Des Esseintes, Barnabooth, le luxe, le voyage, par Jean BORIE.
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
Autres titres publiés sur Joris-Karl Huysmans
SOLAL, Jérôme. Huysmans et l'homme de la fin. Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. « La Thèsothèque » 35. Un volume broché, rogné 21,5 cm. 392 p. 50€. ISBN 978-2-85210-065-7.
GLAUDES, Pierre (dir.). Bloy-Huysmans. La Revue des Lettres modernes, Série « Léon Bloy », 2019.
GLAUDES, Pierre (dir.). Bloy-Huysmans. La Revue des Lettres modernes, Série « Léon Bloy », 2019.