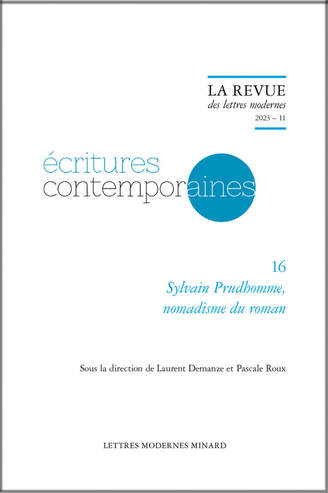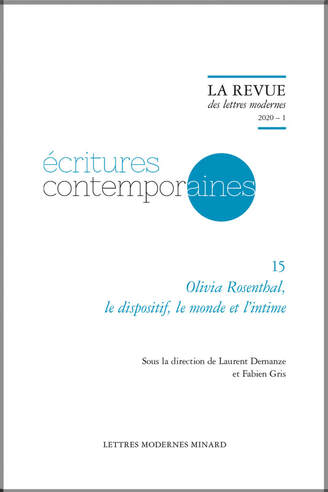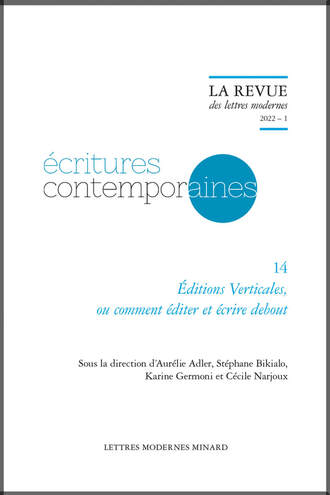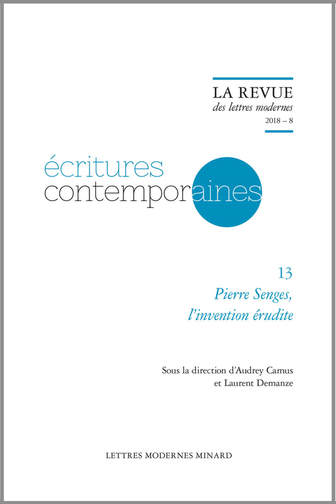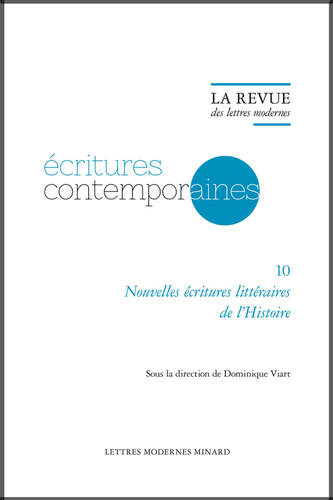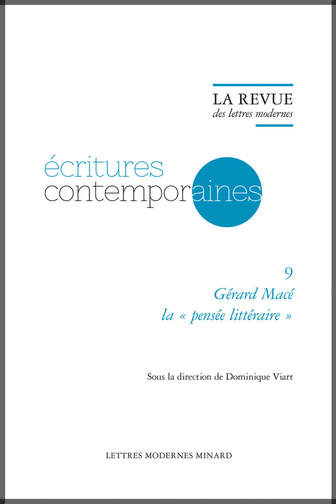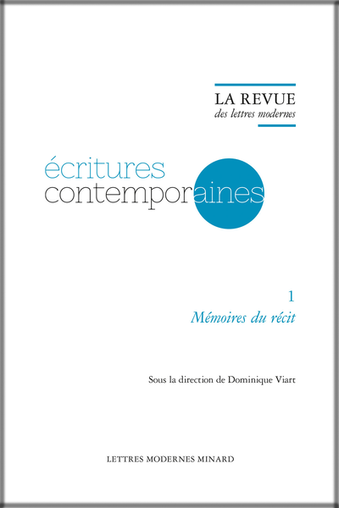Série Écritures contemporaines
Dir. Laurent Demanze (2011)
La littérature actuelle, quoi qu’aient pu en dire certains ouvrages récents, n’est ni morte ni moribonde. Bien au contraire, le champ littéraire contemporain est traversé de mutations profondes qui attestent sa vitalité. Mais ces mutations paraissent aujourd’hui moins identifiables que lors des décennies passées. C’est que peu d’entre elles sont soutenues ou sous-tendues par des réflexions théoriques qui viendraient en baliser les avancées. La production littéraire contemporaine se déploie en effet hors des théories et des écoles, chaque écrivain frayant sa propre voie dans la solitude de ses préoccupations. Les rares chercheurs qui se sont rendus attentifs à cette création littéraire contemporaine en ont du reste marqué le constat dans le titre de leurs ouvrages : Nouveaux territoires romanesques (Claude Prévost et Jean-Claude Lebrun, 1990), Terrains de lecture (Jean-Pierre Richard, 1996). Les pluriels sont ici significatifs de la diversité des expériences et des pratiques.
Alors que certains écrivains poursuivent leur travail de recherches formelles et d’expérimentations, d’autres, peut-être aujourd’hui plus nombreux, tentent de renouer avec la vocation lyrique, le plaisir du récit, l’expression du sujet ou la rencontre du réel. Ils ne font pas pour autant l’économie de ces critiques radicales qui, à l’époque du structuralisme et du “Nouveau Roman”, ont démontré les illusions de la représentation et l’inauthenticité de toute écriture de soi. Loin d’être délivrés du soupçon, les écrivains de notre temps en assument la présence et travaillent avec la conscience même des difficultés et des vicissitudes de la parole, qu’il s’agisse de les moquer ou de les affronter.
Dès lors comment y voir clair ? Comment décrire et étudier l’état présent des Lettres ? Comment mesurer ce qui est à l’œuvre aujourd’hui dans la littérature ? Quelques revues ont risqué sur ces questions des numéros spéciaux. Pour importantes qu’elles soient, ces contributions demeurent souvent ponctuelles et disparates, des bribes de fictions voisinant avec des études, des essais avec des manifestes. On sort de ces lectures partagé entre l’égarement et la conviction que quelque chose d’important agite la création littéraire. Les classifications avancées ici ou là — “œuvres postmodernes”, “extrême contemporain”, “autofictions”, “romans impassibles”, “écriture blanche”, “minimalisme littéraire”, “essais-fictions”, “néo-lyrisme”, “nouvelle fiction”… — se révèlent bien souvent problématiques, ce qui n’est pas, du reste, le moindre de leurs intérêts. Toutes ces questions nous ont semblé dignes des exigences du travail universitaire — et c’est à elles qu’entend se vouer la Série Écritures contemporaines en prolongement de L’Icosathèque (20th) dans La Revue des lettres modernes.
La réflexion sur la littérature actuelle est sans doute plus « risquée » que celle qui s’attache aux littératures passées : les œuvres sont en cours, pour longtemps privées de la complétude de leur achèvement, aucune vulgate ne s’est constituée qui serve de référence au travail. Les méthodes de critique universitaire n’en seront que plus utiles par leur sérieux et leur efficacité. Car il ne s’agit pas simplement de signaler une œuvre à l’attention des lecteurs, ni d’en évaluer la qualité, mais de chercher comment elle s’insère dans un ensemble de questions que la littérature s’adresse à elle-même et destine à son temps, quelles que soient les époques. La création contemporaine — qui n’est jamais que l’état ultime d’une mise en œuvre esthétique des perplexités humaines — a en outre la particularité de revisiter le passé, de convoquer au cours de ses pages les grandes œuvres dont elle assume ou récuse l’héritage. Étudier les textes contemporains, c’est souvent être conduit à relire ceux d’autrefois sous de bien étranges lumières.
Alternant sans préférences génériques les livraisons consacrées à des auteurs ou à des œuvres singulières et celles organisées autour de problématiques plus générales, la Série “Écritures contemporaines” devrait permettre de dessiner, au fil de ses parutions, le paysage critique, esthétique, voire idéologique de la littérature présente, de mesurer les relations qu’elle entretient avec les autres disciplines intellectuelles ou artistiques et avec le monde dans lequel elle s’élabore. La Série souhaite ainsi constituer pour l’étude du domaine contemporain un véritable pôle de référence et soutenir sans exclusive ni exclusion, les recherches qui se déploient dans cette voie en leur donnant l’occasion de se faire connaître. Au moment où la critique littéraire connaît elle-même une certaine remise en question de ses élaborations théoriques, cette Série offrira ainsi une réponse à qui déplore la trop grande dilution du travail universitaire dans des études isolées, trop partielles ou particulières, l’ensemble des livraisons successives construisant peu à peu un véritable « état critique » de la littérature contemporaine.
Dominique VIART
Alors que certains écrivains poursuivent leur travail de recherches formelles et d’expérimentations, d’autres, peut-être aujourd’hui plus nombreux, tentent de renouer avec la vocation lyrique, le plaisir du récit, l’expression du sujet ou la rencontre du réel. Ils ne font pas pour autant l’économie de ces critiques radicales qui, à l’époque du structuralisme et du “Nouveau Roman”, ont démontré les illusions de la représentation et l’inauthenticité de toute écriture de soi. Loin d’être délivrés du soupçon, les écrivains de notre temps en assument la présence et travaillent avec la conscience même des difficultés et des vicissitudes de la parole, qu’il s’agisse de les moquer ou de les affronter.
Dès lors comment y voir clair ? Comment décrire et étudier l’état présent des Lettres ? Comment mesurer ce qui est à l’œuvre aujourd’hui dans la littérature ? Quelques revues ont risqué sur ces questions des numéros spéciaux. Pour importantes qu’elles soient, ces contributions demeurent souvent ponctuelles et disparates, des bribes de fictions voisinant avec des études, des essais avec des manifestes. On sort de ces lectures partagé entre l’égarement et la conviction que quelque chose d’important agite la création littéraire. Les classifications avancées ici ou là — “œuvres postmodernes”, “extrême contemporain”, “autofictions”, “romans impassibles”, “écriture blanche”, “minimalisme littéraire”, “essais-fictions”, “néo-lyrisme”, “nouvelle fiction”… — se révèlent bien souvent problématiques, ce qui n’est pas, du reste, le moindre de leurs intérêts. Toutes ces questions nous ont semblé dignes des exigences du travail universitaire — et c’est à elles qu’entend se vouer la Série Écritures contemporaines en prolongement de L’Icosathèque (20th) dans La Revue des lettres modernes.
La réflexion sur la littérature actuelle est sans doute plus « risquée » que celle qui s’attache aux littératures passées : les œuvres sont en cours, pour longtemps privées de la complétude de leur achèvement, aucune vulgate ne s’est constituée qui serve de référence au travail. Les méthodes de critique universitaire n’en seront que plus utiles par leur sérieux et leur efficacité. Car il ne s’agit pas simplement de signaler une œuvre à l’attention des lecteurs, ni d’en évaluer la qualité, mais de chercher comment elle s’insère dans un ensemble de questions que la littérature s’adresse à elle-même et destine à son temps, quelles que soient les époques. La création contemporaine — qui n’est jamais que l’état ultime d’une mise en œuvre esthétique des perplexités humaines — a en outre la particularité de revisiter le passé, de convoquer au cours de ses pages les grandes œuvres dont elle assume ou récuse l’héritage. Étudier les textes contemporains, c’est souvent être conduit à relire ceux d’autrefois sous de bien étranges lumières.
Alternant sans préférences génériques les livraisons consacrées à des auteurs ou à des œuvres singulières et celles organisées autour de problématiques plus générales, la Série “Écritures contemporaines” devrait permettre de dessiner, au fil de ses parutions, le paysage critique, esthétique, voire idéologique de la littérature présente, de mesurer les relations qu’elle entretient avec les autres disciplines intellectuelles ou artistiques et avec le monde dans lequel elle s’élabore. La Série souhaite ainsi constituer pour l’étude du domaine contemporain un véritable pôle de référence et soutenir sans exclusive ni exclusion, les recherches qui se déploient dans cette voie en leur donnant l’occasion de se faire connaître. Au moment où la critique littéraire connaît elle-même une certaine remise en question de ses élaborations théoriques, cette Série offrira ainsi une réponse à qui déplore la trop grande dilution du travail universitaire dans des études isolées, trop partielles ou particulières, l’ensemble des livraisons successives construisant peu à peu un véritable « état critique » de la littérature contemporaine.
Dominique VIART
Écritures contemporaines 16 :
Sylvain Prudhomme : nomadisme du roman
|
Le numéro 16 de la série “Écritures contemporaines” de La Revue des lettres modernes est le premier ouvrage universitaire entièrement consacré à l’œuvre de Sylvain Prudhomme. Il compose depuis 2007 une œuvre qui s’élabore entre l’ici et l’ailleurs, entre la France et l’Afrique. Ses romans, récits et reportages proposent une œuvre nomade, ponctuée de portraits empathiques et lestée d’un goût du concret. Il dessine avec humanité des silhouettes dans les périphéries, pour lutter contre la domination politique des centres. Au fil de l’œuvre, s’élabore un éloge joyeux de la vie, dans son caractère imprévisible et bouleversant.
Sommaire
Introduction / Introduction, par Laurent DEMANZE, Pascale ROUX
1. Figures du voyageur. Une anthropologie du nomadisme / Figures of the Traveler. An Anthropology of Nomadism, par Liouba BISCHOFF 2. Raconter/penser l’Afrique en contexte décolonial. Dialogue entre Ngugi wa Thiong’o et Sylvain Prudhomme / Telling/thinking Africa in a Decolonial Context. Dialogue between Ngugi wa Thiong’o and Sylvain Prudhomme, par Ridha BOULAÂBI 3. Raconter en traduisant. Le créole dans Les Grands (2014) / Telling by Translating. Creole in Les Grands (2014), par Pascale ROUX |
4. Hommes-brebis et hommes-papillons ou les épuisements du terrain / Ewe-men and Butterfly-men or the Exhaustions of the Field, par Mathilde ROUSSIGNÉ
5. Au bivouac des voix / In the Bivouac of Voices, par Aline MARCHAND
6. « Contrefeux dans la forêt ». Imaginaires politiques et résistances de l’habiter / “Contrefeux dans la forêt”. Political Imaginaries and Resistance of Habitation, par Laurent DEMANZE
7. Retenir la lumière. Illuminations, épiphanies et vita nova dans Les Orages / Holding back the Light. Illuminations, Epiphanies and Vitanova in LesOrages, par Maud LECACHEUR
8. La fuite et l’utopie. Photographies et autres images dans les récits de Sylvain Prudhomme / Escape and Utopia. Photographs and Other Images in the Narratives of Sylvain Prudhomme, par Cécile CHATELET
9. « Ultimes repousses du Mwanza Project » / “MwanzaProject’s Final Regrowth”, par Sylvain PRUDHOMME
10. Polaroids. Trois portraits à la frontière mexicaine / Polaroids. Three Portraits on the Mexican Border, par Sylvain PRUDHOMME
11. « Je crois la sensation de fendre l’espace profondément jumelle de celle d’écrire. » Entretien avec Sylvain Prudhomme / “Je crois la sensation de fendre l’espace profondément jumelle de celle d’écrire.” Interview with Sylvain Prudhomme
Commander en ligne ici.
5. Au bivouac des voix / In the Bivouac of Voices, par Aline MARCHAND
6. « Contrefeux dans la forêt ». Imaginaires politiques et résistances de l’habiter / “Contrefeux dans la forêt”. Political Imaginaries and Resistance of Habitation, par Laurent DEMANZE
7. Retenir la lumière. Illuminations, épiphanies et vita nova dans Les Orages / Holding back the Light. Illuminations, Epiphanies and Vitanova in LesOrages, par Maud LECACHEUR
8. La fuite et l’utopie. Photographies et autres images dans les récits de Sylvain Prudhomme / Escape and Utopia. Photographs and Other Images in the Narratives of Sylvain Prudhomme, par Cécile CHATELET
9. « Ultimes repousses du Mwanza Project » / “MwanzaProject’s Final Regrowth”, par Sylvain PRUDHOMME
10. Polaroids. Trois portraits à la frontière mexicaine / Polaroids. Three Portraits on the Mexican Border, par Sylvain PRUDHOMME
11. « Je crois la sensation de fendre l’espace profondément jumelle de celle d’écrire. » Entretien avec Sylvain Prudhomme / “Je crois la sensation de fendre l’espace profondément jumelle de celle d’écrire.” Interview with Sylvain Prudhomme
Commander en ligne ici.
Écritures contemporaines 15 :
Olivia Rosenthal : le dispositif, le monde et l'intime
|
Le numéro 15 de la série “Écritures contemporaines” de La Revue des lettres modernes est le premier ouvrage universitaire entièrement consacré à l’œuvre d'Olivia Rosenthal. Écrivaine, performeuse, investissant le livre comme la scène, Olivia Rosenthal déploie depuis plus de vingt ans une œuvre importante, essentiellement publiée aux Éditions Verticales. Ce collectif tente d'en dresser un premier bilan, en analysant cette poétique originale qui se situe à la croisée des chemins : entre fiction et documentaire, entre écriture personnelle et recueil de témoignages, entre intertextualité et intermédialité, entre pratique de dispositifs formels et interrogation sur les possibilités de dire l'intime. Ce qui frappe, en effet, dans les ouvrages d'Olivia Rosenthal, c'est le fait qu'ils nous parlent avec acuité de notre monde et de nos préoccupations les plus actuelles, tout en représentant cette matière vive à travers des dispositifs littéraires exigeants. L'écriture d'Olivia Rosenthal est ainsi l'expérience concomitante de la saisie et du débordement du monde et de l'intime.
Sommaire
Introduction, par Fabien GRIS
1. Early Modern O. R. : cinq notes sur les vies littéraires d’Olivia Rosenthal, par Michel JOURDE 2. Les réinventions de soi dans Mes Petites Communautés, par Jean-Marc BAUDE |
3. Olivia Rosenthal : « à la lisière de la médecine », par Laurent DEMANZE
4. L’émancipation par trahison dans les fictions d’Olivia Rosenthal, par Aurélie ADLER
5. Le pathos intelligent : rire avec Olivia Rosenthal, par Stéphane CHAUDIER
6. Olivia Rosenthal : ce que le montage fait au ressassement, par Marie-Odile ANDRÉ
7. Olivia Rosenthal défait le genre, par Évelyne LEDOUX-BEAUGRAND
8. Viande froide : de la réappropriation de la parole à l’architecture d’un lieu, par par Maud LECACHEUR
9. Les fonctions de l’identification, Dominique RABATÉ
10. Filmo-biographie et récit de vie, par Jean-Max COLARD
11. « Il y a de drôles de fruits qui pendent aux arbres », par Olivia ROSENTHAL
12. Sortir du livre : enjeux d’une rencontre de la littérature avec d’autres pratiques artistiques et formes de vie, par Nancy MURZILLI
13. Entretien avec Olivia Rosenthal, par Fabien GRIS
14. Notes pour l’écriture de Mécanismes de survie en milieu hostile, par Olivia ROSENTHAL
Commander en ligne ici.
4. L’émancipation par trahison dans les fictions d’Olivia Rosenthal, par Aurélie ADLER
5. Le pathos intelligent : rire avec Olivia Rosenthal, par Stéphane CHAUDIER
6. Olivia Rosenthal : ce que le montage fait au ressassement, par Marie-Odile ANDRÉ
7. Olivia Rosenthal défait le genre, par Évelyne LEDOUX-BEAUGRAND
8. Viande froide : de la réappropriation de la parole à l’architecture d’un lieu, par par Maud LECACHEUR
9. Les fonctions de l’identification, Dominique RABATÉ
10. Filmo-biographie et récit de vie, par Jean-Max COLARD
11. « Il y a de drôles de fruits qui pendent aux arbres », par Olivia ROSENTHAL
12. Sortir du livre : enjeux d’une rencontre de la littérature avec d’autres pratiques artistiques et formes de vie, par Nancy MURZILLI
13. Entretien avec Olivia Rosenthal, par Fabien GRIS
14. Notes pour l’écriture de Mécanismes de survie en milieu hostile, par Olivia ROSENTHAL
Commander en ligne ici.
Écritures contemporaines 14 :
Éditions verticales, ou comment éditer et écrire debout
Sommaire
I. IDENTITÉ(S) ET POLITIQUE(S) ÉDITORIALES / EDITORIAL IDENTITY/IES AND POLITICS
1. L’identité éditoriale de Verticales. Table ronde avec Claro, Jeanne Guyon, Yves Pagès et Pierre Senges / The Editorial Identity of Verticales. Round table with Claro, Jeanne Guyon, Yves Pagès, and Pierre Senges, par Aurélie ADLER 2. Les éditions Verticales. Sociohistoire de la construction d’une position emblématique dans le champ littéraire / Verticales. A Sociohistory of the Construction of an Emblematic Position in the Literary Field, par Lilas BASS 3. Verticales Phase 1 – un situationnisme esthétique / Verticales Phase One—An Aesthetic Situationism, par Stéphane BIKIALO 4. Frédéric Ciriez, écrire paillettes et déchets / Frédéric Ciriez, Writing Glitter and Waste, par Sylvie DUCAS 5. Peut-on parler d’une « Génération Verticales » ? / Can We Speak of a “Verticales Generation”? , par Alain NICOLAS 6. Le collectif Inculte et les éditions Verticales. Étude d’une rencontre posturale / The Inculte collective and Verticales. A Look at a Postural Encounter, par Jean-Marc BAUD 7. Philippe Bretelle, l’œil de Verticales / Philippe Bretelle, the Eye of Verticales, par Stéphane BIKIALO, Martin RASS |
8. Donner corps au multiple. La communication à 360° des éditions Verticales / Giving Body to the Multiple. Verticales’ 360-Degree Communication, par Mathile BONAZZI
II. FICTION, DOCUMENT ET HISTOIRE(S) /FICTION, DOCUMENT AND HISTORY(IES)
9. Définir la littérature par ses marges. La non-fiction chez Verticales / Defining LIterature by its Margins. Nonfiction at Verticales, par Julien LEFORT-FAVREAU
10. Les histoires potentielles de Philippe Artières / The Potential Histories of Philippe Artières, par Laurent DEMANZE
11. Raconter des « histoires vraies ». Entretien avec Jane Sautière et François Beaune / Telling “true stories”. An interview with Jane Sautière and François Beaune, par Raphaëlle GUIDÉE
12. Verticales, écrire au « singulier collectif » ? L’exemple de François Beaune / Verticales, Writing in the “collective singular”? The Example of François Beaune, par Catherine RANNOUX
13. Vivre à la verticale. Poétiques pour un monde en crise / Living Vertically. Poetics for a World in Crisis, par Maïté SNAUWAERT
III. L’ARTISANAT DU STYLE CHEZ VERTICALES : UNE SOMME DE SINGULARITÉS / THE ARTISANSHIP OF VERTICALES’ STYLE: A SUM OF SINGULARITIES
14. Travailler la langue chez Verticales, une aventure humaine, engagée et singulière. Table ronde avec Maylis de Kerangal, Noémi Lefebvre et Yves Pagès / Working with language at Verticales, a human, engaged, and singular adventure. Round table with Maylis de Kerangal, Noémi Lefebvre, and Yves Pagès, par Karine GERMONI, Cécile NARJOUX
15. Chevaucher des tigres ou suivre les rêves / Riding tigers or following dreams, par Elitza GUEORGUIEVA
16. Écrire aux côtés / Writing side by side, par Aliona GLOUKHOVA
17. L’esthétique de la scorie ou l’exception contre la règle. Dialogue avec Arno Bertina et Marie-Hélène Massardier / The aesthetics of slag or the exception to the rule. Dialogue with Arno Bertina and Marie-Hélène Massardier, par Karine GERMONI
18. Pour une écriture verticale du corps / For a vertical writing of the body, par Laurent SUSINI
19. « De multiples et nouvelles pistes apparaissent ». L’expérience du récit et celle du temps chez Olivia Rosenthal / “Multiple new paths appear”. Olivia Rosenthal’s experience of narrative and time, par Cécile NARJOUX
IV. VERS UNE LITTÉRATURE EXPOSÉE : INTER- ET TRANSMÉDIALITÉS / TOWARD A LITERATURE ON DISPLAY: INTER- AND TRANSMEDIALITIES
20. Gaëlle Théval Intermédialités. Table ronde avec Anne-James Chaton, Frédéric Ciriez, Jean-Charles Massera et Olivia Rosenthal / Intermedialities. Round table with Anne-James Chaton, Frédéric Ciriez, Jean-Charles Massera and Olivia Rosenthal, par Gaëlle THÉVAL
21. Fabien Gris Rester Verticales. Le cinéma et les éditions Verticales / Staying Verticales. Cinema and the Verticales publishing house, par Fabien GRIS
22. Michel Briand Concordan(s)e / Verticales. Sous la peau (Arno Bertina / Daniel Larrieu), une transmédiation / Concordan(s)e/Verticales. Sous la peau (Arno Bertina/Daniel Larrieu), a transmediation, par Michel BRIAND
23. Judith Mayer Écrivains Verticales, écritures transversales / Verticales authors, transversal writing, par Judith MAYER
II. FICTION, DOCUMENT ET HISTOIRE(S) /FICTION, DOCUMENT AND HISTORY(IES)
9. Définir la littérature par ses marges. La non-fiction chez Verticales / Defining LIterature by its Margins. Nonfiction at Verticales, par Julien LEFORT-FAVREAU
10. Les histoires potentielles de Philippe Artières / The Potential Histories of Philippe Artières, par Laurent DEMANZE
11. Raconter des « histoires vraies ». Entretien avec Jane Sautière et François Beaune / Telling “true stories”. An interview with Jane Sautière and François Beaune, par Raphaëlle GUIDÉE
12. Verticales, écrire au « singulier collectif » ? L’exemple de François Beaune / Verticales, Writing in the “collective singular”? The Example of François Beaune, par Catherine RANNOUX
13. Vivre à la verticale. Poétiques pour un monde en crise / Living Vertically. Poetics for a World in Crisis, par Maïté SNAUWAERT
III. L’ARTISANAT DU STYLE CHEZ VERTICALES : UNE SOMME DE SINGULARITÉS / THE ARTISANSHIP OF VERTICALES’ STYLE: A SUM OF SINGULARITIES
14. Travailler la langue chez Verticales, une aventure humaine, engagée et singulière. Table ronde avec Maylis de Kerangal, Noémi Lefebvre et Yves Pagès / Working with language at Verticales, a human, engaged, and singular adventure. Round table with Maylis de Kerangal, Noémi Lefebvre, and Yves Pagès, par Karine GERMONI, Cécile NARJOUX
15. Chevaucher des tigres ou suivre les rêves / Riding tigers or following dreams, par Elitza GUEORGUIEVA
16. Écrire aux côtés / Writing side by side, par Aliona GLOUKHOVA
17. L’esthétique de la scorie ou l’exception contre la règle. Dialogue avec Arno Bertina et Marie-Hélène Massardier / The aesthetics of slag or the exception to the rule. Dialogue with Arno Bertina and Marie-Hélène Massardier, par Karine GERMONI
18. Pour une écriture verticale du corps / For a vertical writing of the body, par Laurent SUSINI
19. « De multiples et nouvelles pistes apparaissent ». L’expérience du récit et celle du temps chez Olivia Rosenthal / “Multiple new paths appear”. Olivia Rosenthal’s experience of narrative and time, par Cécile NARJOUX
IV. VERS UNE LITTÉRATURE EXPOSÉE : INTER- ET TRANSMÉDIALITÉS / TOWARD A LITERATURE ON DISPLAY: INTER- AND TRANSMEDIALITIES
20. Gaëlle Théval Intermédialités. Table ronde avec Anne-James Chaton, Frédéric Ciriez, Jean-Charles Massera et Olivia Rosenthal / Intermedialities. Round table with Anne-James Chaton, Frédéric Ciriez, Jean-Charles Massera and Olivia Rosenthal, par Gaëlle THÉVAL
21. Fabien Gris Rester Verticales. Le cinéma et les éditions Verticales / Staying Verticales. Cinema and the Verticales publishing house, par Fabien GRIS
22. Michel Briand Concordan(s)e / Verticales. Sous la peau (Arno Bertina / Daniel Larrieu), une transmédiation / Concordan(s)e/Verticales. Sous la peau (Arno Bertina/Daniel Larrieu), a transmediation, par Michel BRIAND
23. Judith Mayer Écrivains Verticales, écritures transversales / Verticales authors, transversal writing, par Judith MAYER
Écritures contemporaines 13 :
Pierre Senges : l'invention érudite
|
Entre inquiétude et jubilation, l’exploration des savoirs est inséparable chez Pierre Senges d’une exploration des ressources de la fiction. L’appétit de savoir s’accompagnant de la mise en cause du savoir, l’œuvre apparaît tout entière tendue entre thésaurisation et dissémination, et entretient une relation à l’érudition fait d’admiration et d’irrévérence. Hospitalière et généreuse à maints égards, elle n’en est pas moins en lutte perpétuelle contre le réel, contre les codes, et contre le lecteur qui s’y plie. Le jeu sur les possibles narratifs et la manière de construire une histoire, tout comme le maniement de l’intertexte ou le travail de sape de l’auctorialité appellent en effet une réception active du lecteur. Sous les traits de l’autodidacte, l’individu contemporain ainsi portraituré apparaît de la sorte comme un lecteur non seulement averti mais aussi affranchi de l’esprit de sérieux, que l’œuvre érudite et inventive de Pierre Senges engage dans une relation féconde tant au savoir qu’à la littérature.
Sommaire
Avant-propos, par Laurent Demanze
Introduction, par Audrey Camus et Laurent DEMANZE 1. « La chute était leur trajectoire », erreurs et échecs chez Pierre Senges, par Fabien GRIS |
2. La voix polémique du faussaire dans Fragments de Lichtenberg, par Aurélie ADLER
3. Dans la bibliothèque, avec une clé anglaise. Enquête policière et enquête érudite dans l’œuvre de Pierre Senges, par Mathilde BARRABAND
4. Variations contraintes, par Anne ROCHE
5. Les miroitements du vestige. Décomposition et recomposition romanesque dans Fragments de Lichtenberg, par Anne SENNHAUSER
6. L’Utopie revisitée : l’œuvre-parergon de Pierre Senges, par Audrey CAMUS
7. La carence et l’excès. Information et lacune dans l’œuvre de Pierre Senges, par Hugues MARCHAL
8. Suites et poursuites. Une « écriture d’ébauches, de projets et de variations », par Laurent DEMANZE
9. Consistency. Pierre Senges ou l’esprit de suite. Un sixième memorandum pour l’actuel millénaire, par Emmanuel BOUJU
Documents
10. « Préférer Pergame à Alexandrie » : entretien avec Pierre Senges, réalisé par Audrey CAMUS et Laurent DEMANZE
11. Utopie – commentaires sur les chemins de ronde (extrait), par Pierre SENGES
Postface, par Bruno Blanckeman
Commander en ligne ici.
3. Dans la bibliothèque, avec une clé anglaise. Enquête policière et enquête érudite dans l’œuvre de Pierre Senges, par Mathilde BARRABAND
4. Variations contraintes, par Anne ROCHE
5. Les miroitements du vestige. Décomposition et recomposition romanesque dans Fragments de Lichtenberg, par Anne SENNHAUSER
6. L’Utopie revisitée : l’œuvre-parergon de Pierre Senges, par Audrey CAMUS
7. La carence et l’excès. Information et lacune dans l’œuvre de Pierre Senges, par Hugues MARCHAL
8. Suites et poursuites. Une « écriture d’ébauches, de projets et de variations », par Laurent DEMANZE
9. Consistency. Pierre Senges ou l’esprit de suite. Un sixième memorandum pour l’actuel millénaire, par Emmanuel BOUJU
Documents
10. « Préférer Pergame à Alexandrie » : entretien avec Pierre Senges, réalisé par Audrey CAMUS et Laurent DEMANZE
11. Utopie – commentaires sur les chemins de ronde (extrait), par Pierre SENGES
Postface, par Bruno Blanckeman
Commander en ligne ici.
Écritures contemporaines 12 :
Le Romain contemporain de la famille
|
La famille connaît depuis un quart de siècle des mutations considérables qui tiennent à des facteurs très divers (économiques, historiques, sociologiques). La vie privée est également de plus en plus médiatisée, dans ses formes extrêmes d’aliénations ou de psychoses et fournit un matériau fécond pour la littérature autobiographique et romanesque. Les études rassemblées dans ce volume entendent observer ce qu’en dit le roman depuis les années 1980, quand le retour au récit coïncide avec un retour en force de la famille dans la fiction. On découvre aussi que l’imagination formelle mise en œuvre est à la mesure des chaos, désunions et recompositions qui caractérisent ces infamilles.
Sommaire
avant-propos par Laurent DEMANZE
Introduction par Sylviane COYAULT I. FILIATIONS ET HÉRITAGE Introduction par Christine JÉRUSALEM 1. Fictions familiales versus Récits de filiation : pour une topographie de la famille en littérature, par Dominique VIART |
2. Sang d’encre - Filiation et mélancolie dans la littérature contemporaine, par Laurent DEMANZE
3. « Tous les héritages vides ». La déliquescence de la structure familiale dans Mariage mixte de Marc Weitzmann, par Émilie BRIERE
4. L’héritage de François Bon : trois générations ou « l’éternité ici-bas », par Jean-Bernard VRAY
5. La maladie d'Alzheimer et l’oubli de la famille : On n'est pas là pour disparaître d'Olivia Rosenthal, par Fabien GRIS.
6. Le fils prodigue dans Vies minuscules de Pierre Michon, par Véronique LÉONARD
7. Filiation, identité et appartenance dans Le Testament français d’Andrei Makine, par Rennie YOTOVA.
II. ORIGINE ET IDENTITÉ
Introduction par Gaspard TURN
8. « Tous les hommes naissent… » : Jean Rouaud et la question des origines, par Michel LANTELME.
9. Nom de famille, nom propre, pseudonyme : Rivalités assassines, par Claude BURGELIN.
10. Entre Sans famille et En famille : l’exemple de Patrick Modiano, par Ivan FARRON.
11. Vers la famille, par le métro, par Wolfram NITSCH.
12. Dans la famille nombreuse de la littérature de jeunesse, je ne demande que quelques orphelin(e)s, par Nelly CHABROL-GAGNE.
13. L’individu face à la famille : femmes à la (re)conquête de leur identité, par Annie BESNARD.
III. DES FAMILLES OU DÉFAMILLE
Introduction par Sylviane COYAULT
14. La gloire de l’infamille, par Dominique RABATÉ.
15. La famille entre guillemets dans les romans de Tanguy Viel, par Jutta FORTIN.
16. « Devenir escargot ». Hyperboles familiales chez NDiaye et Jauffret, Gaspard TURIN.
17. La famille, le cloaque, la langue, Noël CORDONIER.
18. « Mère et fils dans l’œuvre d’Anne Godard et Marie NDiaye », Christine JÉRUSALEM.
19. La fratrie : de la fusion à l’enfermement et l’aliénation, Nathalie WACKER.
20. La sœur l’épouse et la mère dans les romans de Richard Millet, Madalina GRIGORE-MURESAN.
21. Familles en deuil chez François Bon, Frédéric MARTIN-ACHARD.
22. Mères, sœurs et tantes, Isabelle DANGY.
Commander en ligne ici.
3. « Tous les héritages vides ». La déliquescence de la structure familiale dans Mariage mixte de Marc Weitzmann, par Émilie BRIERE
4. L’héritage de François Bon : trois générations ou « l’éternité ici-bas », par Jean-Bernard VRAY
5. La maladie d'Alzheimer et l’oubli de la famille : On n'est pas là pour disparaître d'Olivia Rosenthal, par Fabien GRIS.
6. Le fils prodigue dans Vies minuscules de Pierre Michon, par Véronique LÉONARD
7. Filiation, identité et appartenance dans Le Testament français d’Andrei Makine, par Rennie YOTOVA.
II. ORIGINE ET IDENTITÉ
Introduction par Gaspard TURN
8. « Tous les hommes naissent… » : Jean Rouaud et la question des origines, par Michel LANTELME.
9. Nom de famille, nom propre, pseudonyme : Rivalités assassines, par Claude BURGELIN.
10. Entre Sans famille et En famille : l’exemple de Patrick Modiano, par Ivan FARRON.
11. Vers la famille, par le métro, par Wolfram NITSCH.
12. Dans la famille nombreuse de la littérature de jeunesse, je ne demande que quelques orphelin(e)s, par Nelly CHABROL-GAGNE.
13. L’individu face à la famille : femmes à la (re)conquête de leur identité, par Annie BESNARD.
III. DES FAMILLES OU DÉFAMILLE
Introduction par Sylviane COYAULT
14. La gloire de l’infamille, par Dominique RABATÉ.
15. La famille entre guillemets dans les romans de Tanguy Viel, par Jutta FORTIN.
16. « Devenir escargot ». Hyperboles familiales chez NDiaye et Jauffret, Gaspard TURIN.
17. La famille, le cloaque, la langue, Noël CORDONIER.
18. « Mère et fils dans l’œuvre d’Anne Godard et Marie NDiaye », Christine JÉRUSALEM.
19. La fratrie : de la fusion à l’enfermement et l’aliénation, Nathalie WACKER.
20. La sœur l’épouse et la mère dans les romans de Richard Millet, Madalina GRIGORE-MURESAN.
21. Familles en deuil chez François Bon, Frédéric MARTIN-ACHARD.
22. Mères, sœurs et tantes, Isabelle DANGY.
Commander en ligne ici.
Écritures contemporaines 11 :
“Valère Novarina — le langage en scène”
|
Issu du colloque « La voix étrangère de Valère Novarina » organisé en 2005 à l’Université d’État de Moscou, le présent volume collectif explore l’œuvre novarinienne du point de vue de ses enjeux dramaturgiques et traductologiques. Si cette écriture polyglotte et disruptive bouleverse les coordonnées traditionnelles du drame, elle invite aussi à penser chaque idiome comme une « langue en partage » où notre réalité personnelle, sociale et politique se crée et se réinvente continuellement. Par son expérience de recherche internationale et interdisciplinaire, Valère Novarina, le langage en scène vise à rendre compte de l’“étrangèreté” du verbe novarinien et de la force critique – et comique – d’une œuvre-phare de la littérature contemporaine.
Sommaire
avant-propos, par Frédérik Detue et Olivier Dubouclez
1. Personne. À propos des personnages dans La Scène, par Marco Baschera. 2. Le Cercle et le carré (géométries de l’écriture et du plateau), par Céline Hersant. 3. Le Théâtre de la parole : remarques sur la «poésie» au théâtre chez Novarina à partir d’Artaud et de Vitrac, par Elena Galtsova. 4. Poétique de la transgression, de Georges Bataille à Valère Novarina, par Désirée Lorenz et Tatiana Weiser. |
5. Le Jardin de reconnaissance. Penser le théâtre de Valère Novarina, par Katia Dmitrieva.
6. Se désaliéner du réel : invitation à la (re)lecture de Vous qui habitez le temps, par Didier Plassard.
7. Dans le cabinet du néologue, par Nadia Buntman.
8. Nom de personne. L’écriture des noms propres chez Valère Novarina, par Olivier Dubouclez.
9. Slogan, inventaire, information : de la politique dans l’œuvre de Valère Novarina, par Julie Sermon.
10. Le Théâtre de Valère Novarina ou la littérature en résistance, par Frédérik Detue.
Document : «En face de l’archaïque et du conscient» : entretien avec Christophe Feutrier, réalisé par Olivier Dubouclez.
Écritures contemporaines 11 : “Valère Novarina — le langage en scène”. Frédérik Detue et Olivier Dubouclez eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. « La Revue des Lettres modernes » . Un volume broché, rogné 19 cm. 220 p. 19 € ISBN 978-2-256-91148-4
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
6. Se désaliéner du réel : invitation à la (re)lecture de Vous qui habitez le temps, par Didier Plassard.
7. Dans le cabinet du néologue, par Nadia Buntman.
8. Nom de personne. L’écriture des noms propres chez Valère Novarina, par Olivier Dubouclez.
9. Slogan, inventaire, information : de la politique dans l’œuvre de Valère Novarina, par Julie Sermon.
10. Le Théâtre de Valère Novarina ou la littérature en résistance, par Frédérik Detue.
Document : «En face de l’archaïque et du conscient» : entretien avec Christophe Feutrier, réalisé par Olivier Dubouclez.
Écritures contemporaines 11 : “Valère Novarina — le langage en scène”. Frédérik Detue et Olivier Dubouclez eds. Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. « La Revue des Lettres modernes » . Un volume broché, rogné 19 cm. 220 p. 19 € ISBN 978-2-256-91148-4
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 10
nouvelles écritures littéraires de l’Histoire
|
avant-propos, par Dominique Viart
I. ÉCRIRE L’HISTOIRE AUJOURD’HUI 1. Nouveaux modèles de représentation de l’Histoire en littérature contemporaine, par Dominique Viart. 2. Le Nouveau Roman et l’Histoire après 1980, par Francine Dugast. 3. Nouvelle Histoire, autre roman : le détail, le corps, la langue, par Agnès Disson. 4. Didier Daeninckx et l’événement fatal, par Flavio Sorrentino. II. AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE 5. La Grande Guerre vue par les auteurs de romans policiers, par Pierre Gauyat. 6. La Grande Guerre en perspective 2000, par Gianfranco Rubino. 7. Dans la guerre, Alice Ferney et ses prédécesseurs : Henri Barbusse, Roland Dorgelès et Jean Giono, par Griet Theeten. 8. La Représentation de la Grande Guerre chez Marie-Paul Armand, par Françoise Kuczaj. III. TRAUMATISMES 9. “Comment on meurt et comment on tue” : la Grande Guerre et la mort dans le roman contemporain (1980–2005), par Pierre Schoentjes. |
10. Jorge Semprún et Patrick Modiano : histoire, expérience et écriture mémorielle : le trop-plein et le vide, par Gianfranca Giro.
11. Versus : confronter Les Bienveillantes et Le Rapport de Brodeck, par Philippe Mesnard.
12. Arno Bertina : la “Migration des truites” en dehors de l’Histoire, par Valerio Cordiner.
13. La Drôle de guerre d’Algérie de Bernard-Marie Koltès, par Catherine Douzou.
IV. IDÉAUX ET DÉSILLUSIONS : QUE RESTE-T-IL DES UTOPIES?
14. Gérard Macé et le voyage vers “l’autre hémisphère du temps”, par Federico Corradi.
15. Mai 68 dans le roman contemporain : des « événements » aux « histoires », par Tomaso Berni Canani.
16. La Ruine de l’utopie du progrès au XXe siècle : une étude de l’espace et du temps dans Dondog d’Antoine Volodine, par Mélanie Lamarre.
Écritures contemporaines 10 : “Nouvelles écritures littéraires de l’Histoire”. Dominique Viart ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2009. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 366 p. 18 € ISBN 978-2-256-91146-0
RÉIMPRESSION : commander en ligne ici.
écritures contemporaines 9
Gérard Macé — la “pensée littéraire”
Sommaire
Gérard Macé, colporteur de livres et de mondes, par Dominique Viart.
GÉRARD MACÉ, ALCHIMISTE DU VERBE. 1. Note sur « le livre muet », par Jean Starobinski. 2. Les Anges qui boitent, par Sylvie Thorel. 3. Bois dormant : traduction, critique, voix, par Timothy Mathews. GÉRARD MACÉ, FAUTEUR D’IMAGES. 4. Bois dormant ou les chambres du temps, par Agnès Castiglione. 5. Le Firmament photographique, par Karine Gros. 6. L’Humble objectif : photographie, voyage et mémoire dans Un Monde qui ressemble au monde, par Akane kawakami Davis. GÉRARD MACÉ, RÊVEUR DE VIES. 7. « Traduire, interpréter, rêver sa vie » : image et récit de vie chez Gérard Macé, par David Houston-Jones. 8. Sur « la piste romanesque » de Champollion, par Dominique Rabaté. 9. Les “beaux contresens” : Macé lecteur de Proust, par Stéphane Chaudier. 10. Manteaux de poupée, par Anne Roche. |
GÉRARD MACÉ, LECTEUR DE MONDES.
11. Gérard Macé, exote, par Charles Forsdick.
12. Éloges de l’ombre — Gérard Macé et l’esthétique japonaise, par Fumio Chiba.
13. Bibliothèques de route : trajets et parcours dans Babel, par Claude-Pierre Pérez.
14. L’Ogre et l’anthropologue, par Laurent Demanze.
Écritures contemporaines 9 : “Gérard Macé — la ‘pensée littéraire’ ”. Dominique Viart ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2007. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 246 p. 19 € ISBN 978-2-256-91125-5
Réimpression : commander ici.
11. Gérard Macé, exote, par Charles Forsdick.
12. Éloges de l’ombre — Gérard Macé et l’esthétique japonaise, par Fumio Chiba.
13. Bibliothèques de route : trajets et parcours dans Babel, par Claude-Pierre Pérez.
14. L’Ogre et l’anthropologue, par Laurent Demanze.
Écritures contemporaines 9 : “Gérard Macé — la ‘pensée littéraire’ ”. Dominique Viart ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2007. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 246 p. 19 € ISBN 978-2-256-91125-5
Réimpression : commander ici.
écritures contemporaines 8
Antoine Volodine – fictions du politique
|
Antoine Volodine est d’évidence, parmi tous les écrivains contemporains, l’un des plus singuliers. Auteur d’une œuvre polyphonique, publiée sous des noms divers et réunie sous la notion de « post-exotisme », il met en scène des futurs improbables, issus de l’échec des utopies révolutionnaires et des totalitarismes qui ont suivi. Les personnages y sont prisonniers d’espaces incertains, proches de ceux dans lesquels errent les âmes des morts du Bardo-Thödol tibétain. Cet ouvrage saisit l’œuvre au moment où s’affirme le système rigoureux qu’elle met en place et propose un entretien avec l’écrivain.
Sommaire
avant-propos, par Anne Roche.
1. Portrait de l’auteur en chiffonnier, par Anne Roche. 2. Situer Volodine ? Fictions du politique, esprit de l’Histoire et anthropologie littéraire du “post-exotisme”, par Dominique Viart. 3. « Pour une meilleure transparence de la désinformation » : le commentaire-fiction d’Antoine Volodine, par Joëlle Gleize. 4. Portrait du lecteur “post-exotique” en camarade (note sur la réception des fictions d’Antoine Volodine), par Frank Wagner. 5. Illusions et désillusions karmiques : lecture du récit “post-exotique”, par Charif Majdalani. |
6. Les « Scènes » d’Antoine Volodine, par Lionel Ruffel.
7. La Houle du virtuel : les non-lieux de Volodine, par Jean-Louis Hippolyte.
8. La Bibliothèque de Babel d’Antoine Volodine : un contre-monument baroque, par Frédérik Detue.
9. La Polyphonie mutilée : la faillite de la révolution russe selon Volodine, par Thierry Saint-Arnoult. –
10. Volodine dans le palais de la double hache ou De la nécessité de l’élaboration d’une Unterkritik, par Jean-Didier Wagneur.
11. Le Vindicatif présent : éthique de la vengeance dans l’univers de Volodine, par Pierre Ouellet.
12. Une Lecture de Bardo or not Bardo : mange tes morts (et dis bonjour à la poule), par Bruno Blanckeman.
Document : « On recommence depuis le début… » : entretien avec Antoine Volodine réalisé par Jean-Didier Wagneur.
Écritures contemporaines 8 : “Antoine Volodine — fictions du politique”. Avec un entretien d’Antoine Volodine. Anne Roche ed., en collaboration avec Dominique Viart. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 282 p. 25 € ISBN 978-2-256-91111-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
7. La Houle du virtuel : les non-lieux de Volodine, par Jean-Louis Hippolyte.
8. La Bibliothèque de Babel d’Antoine Volodine : un contre-monument baroque, par Frédérik Detue.
9. La Polyphonie mutilée : la faillite de la révolution russe selon Volodine, par Thierry Saint-Arnoult. –
10. Volodine dans le palais de la double hache ou De la nécessité de l’élaboration d’une Unterkritik, par Jean-Didier Wagneur.
11. Le Vindicatif présent : éthique de la vengeance dans l’univers de Volodine, par Pierre Ouellet.
12. Une Lecture de Bardo or not Bardo : mange tes morts (et dis bonjour à la poule), par Bruno Blanckeman.
Document : « On recommence depuis le début… » : entretien avec Antoine Volodine réalisé par Jean-Didier Wagneur.
Écritures contemporaines 8 : “Antoine Volodine — fictions du politique”. Avec un entretien d’Antoine Volodine. Anne Roche ed., en collaboration avec Dominique Viart. Caen, Lettres Modernes Minard, 2006. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 282 p. 25 € ISBN 978-2-256-91111-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 7
Effractions de la poésie
|
A l’opposé des théories de la poésie qui présentent ce genre comme solipsiste et enclos sur lui-même, cet ouvrage envisage l’ouverture au monde et la présence du « dehors » dans l’œuvre de nombreux poètes et prosateurs contemporains, explorateurs du langage et de ses formes : P. Alferi, J.-N. Chrisment, M. Desbiolles, L.-R. des Forêts, D. Fourcade, E. Hocquard, P. Jaccottet, G. Jouanard, C. Royet-Journoud, G. Luca, S. Macher, J.-L. Parent, A. Portugal, R. Queneau, J. Roubaud, J.-B. de Seynes, E. Tellerman, J.-P. Verheggen.
Sommaire
PROBLÉMATIQUES
Effractions de la poésie : la tentation du dehors, par Dominique Viart. Étrange beauté, par Christian Doumet. Continuer, par Élisabeth Cardonne-Arlyck. LITTÉRALITÉS Portrait du poète en gentleman-cambrioleur : Jacques Roubaud, par Véronique Montémont. Dominique Fourcade ou une poétique rhizome, par Jérôme Game. Ni frontière, ni limite : ma haie d’Emmanuel Hocquard, par James Petterson. Poésie de Claude Royet-Journoud : amours du Je avec le dehors, par Laurent Fourcaut. |
PHRASÉS
La Poésie de la prose chez Philippe Jaccottet dans La Promenade sous les arbres, par Cécile Alduy.
Louis-René des Forêts, poèmes : visage et voix dans Les Mégères de la mer, Poèmes de Samuel Wood, Ostinato, par Marie Joqueviel.
Dans la « compagnie » de Maryline Desbiolles, par Jean-Marie Barnaud.
PROSAÏSMES
Dans le quotidien — immersion, résistance, liberté : Raymond Queneau, Anne Portugal, par Michael Sheringham.
Autour de Sabine Macher et Gil Jouanard : le carnet poétique, repères et coordonnées, par Philippe Met.
Pierre Alferi : compactage et déliaison, par Agnès Disson.
TENSIONS
« Au vu, au su des chèvres » : sur Vent, une étude de Jean-Baptiste de Seynes, par Emmanuel Laugier.
Esther Tellermann : de l’effraction au refrain, par Peter Dorrington.
Histoire de langue(s) : Jean-Pierre Verheggen, de la francologomachie à la francacophonie, par Éliane Dalmolin.
L’Écriture de la diffraction : dans Extrémités de Jean-Noël Chrisment, par Anne Mairesse.
ÉPILOGUE : Du contemporain…, par Jean-Michel Maulpoix
Écritures contemporaines 7 : “Effractions de la poésie”. Élisabeth Cardonne-Arlyck et Dominique Viart eds. 2003. 336 p. 23 € ISBN 978-2-256-91066-1
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
La Poésie de la prose chez Philippe Jaccottet dans La Promenade sous les arbres, par Cécile Alduy.
Louis-René des Forêts, poèmes : visage et voix dans Les Mégères de la mer, Poèmes de Samuel Wood, Ostinato, par Marie Joqueviel.
Dans la « compagnie » de Maryline Desbiolles, par Jean-Marie Barnaud.
PROSAÏSMES
Dans le quotidien — immersion, résistance, liberté : Raymond Queneau, Anne Portugal, par Michael Sheringham.
Autour de Sabine Macher et Gil Jouanard : le carnet poétique, repères et coordonnées, par Philippe Met.
Pierre Alferi : compactage et déliaison, par Agnès Disson.
TENSIONS
« Au vu, au su des chèvres » : sur Vent, une étude de Jean-Baptiste de Seynes, par Emmanuel Laugier.
Esther Tellermann : de l’effraction au refrain, par Peter Dorrington.
Histoire de langue(s) : Jean-Pierre Verheggen, de la francologomachie à la francacophonie, par Éliane Dalmolin.
L’Écriture de la diffraction : dans Extrémités de Jean-Noël Chrisment, par Anne Mairesse.
ÉPILOGUE : Du contemporain…, par Jean-Michel Maulpoix
Écritures contemporaines 7 : “Effractions de la poésie”. Élisabeth Cardonne-Arlyck et Dominique Viart eds. 2003. 336 p. 23 € ISBN 978-2-256-91066-1
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 6
André du Bouchet et ses Autres
|
Poète important de l’après-guerre, André du Bouchet (1924 – 2001) présente une œuvre singulière, espacée et diffractée sur la page, conjuguant recueils de poèmes et carnets. Co-fondateur de la revue L’Ephémère, ce poète fut proche de nombreux peintres dont il a commenté les travaux avec talent. L’ensemble de son œuvre est ici envisagé dans tous ses aspects - poésie, écrits sur l’art - et dans son dialogue avec d’autres poètes majeurs du XXe siècle.
Sommaire
avant-propos, par Philippe Met.
1. André du Bouchet et la question de l’intime : l’Autre comme avènement de soi, par Franck Villain. 2. André du Bouchet : au bout du souffle, l’entretien infini, par Yasmine Getz. 3. Le Carnet et ses autres, par Daniel Leuwers. 4. « Hors de l’usage, et analogue à un lapsus » : Francis Ponge et André du Bouchet, par Philippe Met. 5. « Deux murs se font face » : Jacques Dupin et André du Bouchet — une écoute, par Valéry Hugotte. 6. « D’un trait qui figure et défigure » : Du Bouchet et Giacometti, par Michel Collot. 7. André du Bouchet et l’autre de l’esthétique : Segers, Poussin, Tal-Coat, par Michael Bishop. |
8. Distance et sensation : Du Bouchet, Wittgenstein, Hocquard, par Daniel Guillaume.
9. Singulière itérabilité : « Ce mot mort », par James Petterson.
10. Traduction : poétique inachevée de la relation, par Michel Favriaud
Document : Inédit d’André du Bouchet
Écritures contemporaines 6 : “André du Bouchet et ses Autres”. Philippe Met ed. . 2003. 224 p. 20 € ISBN 978-2-256-91051-7
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
9. Singulière itérabilité : « Ce mot mort », par James Petterson.
10. Traduction : poétique inachevée de la relation, par Michel Favriaud
Document : Inédit d’André du Bouchet
Écritures contemporaines 6 : “André du Bouchet et ses Autres”. Philippe Met ed. . 2003. 224 p. 20 € ISBN 978-2-256-91051-7
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 5
dramaturgies britanniques (1980-2000)
|
Ce cycle de onze études, consacrées à des auteurs (et autrices) de premier plan de la scène théâtrale britannique, Howard Barker, Steven Berkoff, Edward Bond, Jim Cartwright, Caryl Churchill, Martin Crimp, David Edgar, David Greig, Sarah Kane, Gregory Motton, Mark Ravenhill, rend compte de deux décennies majeures dans l'évolution des écritures théâtrales en Grande-Bretagne. Après l'engagement politique des années soixante-dix, qui relevait d'un certain esprit de l'utopie, les écrivains de théâtre se confrontent avec âpreté et virulence au triomphe du libéralisme, et, sous l'impulsion des minorités qui s'éveillent, inventent de nouvelles formes dramatiques répondant avec acuité aux violences, économiques ou guerrières, de cette fin de siècle.
Sommaire
Les Écritures théâtrales en Grande-Bretagne (1980–2000) : l’Âge d’or et la dame de fer, par Jean-Marc Lanteri. I. ÉTUDES 1. Howard Barker ou la déconsécration du sens : à propos de Maudit crépuscule, par Sarah Hirschmüller. 2. Orgie, orgasme et politique — le théâtre de Steven Berkoff, par Nathalie Hourmant Le Bever. 3. Edward Bond : une dramaturgie de l’état de guerre, par David Lescot. |
4. Road de Jim Cartwright : un théâtre politique sceptique, par Jean-Marc Lanteri.
5. Serious Money de Caryl Churchill ou la célébration de la théâtralité, par Suzan Blattes.
6. Le Traitement et Atteintes à sa vie de Martin Crimp : tricotage du texte et auto-engendrement, par Élisabeth Angel-Perez.
7. David Edgar, “secrétaire de son époque”, par Marianne Drugeon.
8. Gestes d’utopie : le théâtre de David Greig, par Dan Rebellato.
9. Anéantis de Sarah Kane ou le « Tout doit disparaître » de la littérature, par Isabelle Smadja.
10. Chutes de Gregory Motton ou l’invitation à la danse, par Christine Kiehl.
11. Some Explicit Polaroids de Mark Ravenhill : de l’écriture du néant à la néantisation de l’écriture, par Sabine Jean.
II. DOCUMENTS
Extraits de : Road de Jim Cartwright; Poupée brûlée de Chris Hannan; L’Horloge la plus rapide de l’univers de Philip Ridley ; Sardines et choucroute ou l’arithmétique de la mémoire de James Stock.
III. ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DE LA CRITIQUE
Écritures contemporaines 5 : “Dramaturgies britanniques (1980–2000)”. Jean-Marc Lanteri ed. . 2002. 228 p. 20 € ISBN 978-2-256-91047-0
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
5. Serious Money de Caryl Churchill ou la célébration de la théâtralité, par Suzan Blattes.
6. Le Traitement et Atteintes à sa vie de Martin Crimp : tricotage du texte et auto-engendrement, par Élisabeth Angel-Perez.
7. David Edgar, “secrétaire de son époque”, par Marianne Drugeon.
8. Gestes d’utopie : le théâtre de David Greig, par Dan Rebellato.
9. Anéantis de Sarah Kane ou le « Tout doit disparaître » de la littérature, par Isabelle Smadja.
10. Chutes de Gregory Motton ou l’invitation à la danse, par Christine Kiehl.
11. Some Explicit Polaroids de Mark Ravenhill : de l’écriture du néant à la néantisation de l’écriture, par Sabine Jean.
II. DOCUMENTS
Extraits de : Road de Jim Cartwright; Poupée brûlée de Chris Hannan; L’Horloge la plus rapide de l’univers de Philip Ridley ; Sardines et choucroute ou l’arithmétique de la mémoire de James Stock.
III. ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DE LA CRITIQUE
Écritures contemporaines 5 : “Dramaturgies britanniques (1980–2000)”. Jean-Marc Lanteri ed. . 2002. 228 p. 20 € ISBN 978-2-256-91047-0
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 4
L'Un et l'autre – figure du poème dans la poésie contemporaine de langue française
|
Au cœur des débats entre poésie formaliste et lyrisme critique, attentif aussi aux autres voies explorées par des esthétiques singulières, cet ouvrage envisage l’expression du sujet et de l’altérité par les poètes contemporains français et francophones. Les œuvres de quelques un des plus importants d’entre eux y sont étudiées : Tanella Boni, Tahar Bekri, Aimé Césaire, Michel Deguy, Antoine Emaz, Claude Esteban, Dominique Fourcade, Lorand Gaspar, Philippe Jaccottet, Jean-Michel Maulpoix, Henri Michaux, Pascalle Monnier, Anne Portugal, Nathalie Quintane, Jacques Roubaud, Georges Schéhadé, Gérard Titus-Carmel.
Sommaire
Je est un hôte, par Dominique Viart.
avant-propos, par Anne Struve-Debeaux. Comme une eau qui a soif… — notes sur l’identité et la figuration, par Jean-Michel Maulpoix. I. FONDEMENTS DU SUJET Éclatement et transfiguration du moi, par Claude Esteban. Lorand Gaspar : le monde écrit, par Michel Jarrety. L’Épreuve de l’altérité dans l’œuvre de Schehadé : le mensonge, la douleur et le rêve, par Anne Struve-Debeaux. |
II. MESURES DE L’AUTRE
Invoquer l’autre, par Élisabeth Cardonne-Arlyck.
Présence de l’autre : Antoine Emaz et Gérard Titus-Carmel, par Dominique Viart.
La Mort de l’autre ou l’altération du sujet — l’écriture du deuil dans les derniers ouvrages de Claude Esteban, par Benoît Conort.
Philippe Jaccottet et le haïku — sur la poétique du on, par Yasuaki Kawanabe.
III. FIGURES DE L’EXIL
« Une Poésie péléenne », par Dominique Combe.
« Le Mot juste » de Tanella Boni, poétesse de Côte d’Ivoire, par Irène Assiba d’Almeida.
Exil, errance et liberté : l’identité nomade dans l’œuvre du poète tunisien Tahar Bekri, par Sonia Lee.
IV. DÉCENTREMENTS
Transiter : une poésie du passage, par Éliane Dalmolin.
Être et temps dans L’Énergie du désespoir de Michel Deguy, ou les modes d’altération de l’identité par l’écriture poétique,
par Patrice Bougon.
Pour lire Le Sujet monotype de Dominique Fourcade : bonjour les Degas !, par Laurent Fourcaut.
L’Altérité au féminin : Anne Portugal, Pascalle Monnier, Nathalie Quintane, par Agnès Disson.
Écritures contemporaines 4 : “L’Un et l’autre — figures du poème dans la poésie contemporaine de langue française”. Anne Struve-Debeaux ed. . Introduction de Dominique Viart. 2001. 224 p. 20 € ISBN 978-2-256-91022-7
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
Invoquer l’autre, par Élisabeth Cardonne-Arlyck.
Présence de l’autre : Antoine Emaz et Gérard Titus-Carmel, par Dominique Viart.
La Mort de l’autre ou l’altération du sujet — l’écriture du deuil dans les derniers ouvrages de Claude Esteban, par Benoît Conort.
Philippe Jaccottet et le haïku — sur la poétique du on, par Yasuaki Kawanabe.
III. FIGURES DE L’EXIL
« Une Poésie péléenne », par Dominique Combe.
« Le Mot juste » de Tanella Boni, poétesse de Côte d’Ivoire, par Irène Assiba d’Almeida.
Exil, errance et liberté : l’identité nomade dans l’œuvre du poète tunisien Tahar Bekri, par Sonia Lee.
IV. DÉCENTREMENTS
Transiter : une poésie du passage, par Éliane Dalmolin.
Être et temps dans L’Énergie du désespoir de Michel Deguy, ou les modes d’altération de l’identité par l’écriture poétique,
par Patrice Bougon.
Pour lire Le Sujet monotype de Dominique Fourcade : bonjour les Degas !, par Laurent Fourcaut.
L’Altérité au féminin : Anne Portugal, Pascalle Monnier, Nathalie Quintane, par Agnès Disson.
Écritures contemporaines 4 : “L’Un et l’autre — figures du poème dans la poésie contemporaine de langue française”. Anne Struve-Debeaux ed. . Introduction de Dominique Viart. 2001. 224 p. 20 € ISBN 978-2-256-91022-7
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 3
Jacques Borel – l'imagination autobiographique
|
Celui qui ouvre un livre de Jacques Borel se trouve happé par la quête des images mémorielles, par leur précision hallucinée, par la nostalgie dont elles sont chargées, par la poésie qui les enveloppe ; il est saisi par les longues phrases chargées d’incises qui s’attachent à formuler cet « élusif secret » qui toujours se dérobe, il est plongé dans une infinie méditation sur le temps et les morts, sur les lieux et les objets, sur la dépossession que ces images manifestent. C’est à cette puissance de la mémoire que s’attache ce volume qui parcourt ses « romans » et récits depuis L’Adoration, ses journaux et ses nombreux essais critiques.
Sommaire
avant-propos, par Michel Braud et Joëlle de Sermet.
« LE PASSÉ, INGUÉRISSABLE » 1. La Mémoire, le supplice, par Joëlle de Sermet. 2. « Le Génie du ressouvenir » : rêver l’écriture de soi, par Michel Braud. 3. Une Écriture « saisissante », par Catherine Lépront. 4. Un Baroque janséniste, par Jean Roudaut. « AU BOUT DE SOI ALORS PEUT-ÊTRE » 5. Jacques Borel et les images : adoration et dépossession, par Dominique Rabaté. |
6. Autrui dans le discours autobiographique de Jacques Borel, par Joseph Brami.
7. Une Voix irrécusable : Jacques Borel à l’écoute du lyrisme, par Yves Charnet.
HISTOIRE D’UNE LECTURE
Toute une vie : en lisant Jacques Borel, par Benoît Peeters.
JOURNAL INÉDIT
Présentation, par Michel Braud.
Jacques Borel, Pages de Journal.
NOTICE BIOGRAPHIQUE PAR JACQUES BOREL
BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES BOREL
Écritures contemporaines 3 : “Jacques Borel — l’imagination autobiographique”. Michel Braud et Joëlle de Sermet eds. 2000. 174 p. 15,70 €
ISBN 978-2-256-91009-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
7. Une Voix irrécusable : Jacques Borel à l’écoute du lyrisme, par Yves Charnet.
HISTOIRE D’UNE LECTURE
Toute une vie : en lisant Jacques Borel, par Benoît Peeters.
JOURNAL INÉDIT
Présentation, par Michel Braud.
Jacques Borel, Pages de Journal.
NOTICE BIOGRAPHIQUE PAR JACQUES BOREL
BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES BOREL
Écritures contemporaines 3 : “Jacques Borel — l’imagination autobiographique”. Michel Braud et Joëlle de Sermet eds. 2000. 174 p. 15,70 €
ISBN 978-2-256-91009-8
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 2
États du roman contemporain
|
Issu du premier colloque consacré à la littérature contemporaine française (Fondation Noesis, Calaceite, Espagne, juillet 1996), cet ouvrage inaugure les études consacrées au renouvellement de la littérature narrative depuis la fin des années 1970. Nourri des débats entre littérature formaliste et littérature transitive, il demeure un ouvrage de référence où sont envisagées les œuvres de P. Bergounioux, F. Bon, J. Echenoz, S. Germain, J. Lahougue, C. Lépront, P. Michon, M. NDiaye, B. Peeters, J.-C. Pirotte, J.-B. Puech, P. Quignard, J. Rouaud, D. Sallenave, E. Savitzkaya, A. Volodine, où est discutée la notion de « postmodernité littéraire » et abordée pour la première fois la forme des Récits de filiation.
Sommaire
États du roman contemporain, par Jan Baetens et Dominique Viart.
Crise des romans ou crise du roman ? par Jean Baetens. UNE CONSTELLATION DE MINUIT Les Grandes blondes parmi les noirs — Jean Echenoz, par Sjef Houppermans. Eugène Savitzkaya à la croisée des chemins, par Lau-rent Demoulin. Antoine Volodine — résistance et subversion, par Almut Wilske. VARIATIONS SUR LE ROMANESQUE La Vie malgré tout — Jean-Claude Pirotte ou le romanesque des récits incertains, par Yves Charnet. |
À propos de Pascal Quignard, par Bruno Blanckeman.
Modes de conscience — Germain, N’Diaye, Lépront, Sallenave, par Michaël Bishop.
Filiations littéraires, par Dominique Viart.
PRÉSENCES DU SUJET
L’Écriture exhume — sur Jean Rouaud, par Peter Janssens.
Pierre Michon — le défaut et la grâce, par Sidonie Loubry.
Des mains mutilées et des vies prises — sur les romans de François Bon, par Valéry Hugotte.
ELLIPSES DU SUJET
Le Sujet s’évite — Jean-Benoît Puech, par Jan Baetens.
Texte qui de soi-même s’écrit — les «collaborations» de Benoît Peeters, par Adélaïde Russo.
Une Stratégie des contraintes, par Jean Lahougue.
Histoire littéraire et postmodernité, par Sémir Badir.
Écritures contemporaines 2 : “États du roman contemporain”. (Colloque Calaceite 1996). Jan Baetens et Dominique Viart eds. 1999. 268 p. 21,90 € ISBN 978-2-256-90986-3
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
Modes de conscience — Germain, N’Diaye, Lépront, Sallenave, par Michaël Bishop.
Filiations littéraires, par Dominique Viart.
PRÉSENCES DU SUJET
L’Écriture exhume — sur Jean Rouaud, par Peter Janssens.
Pierre Michon — le défaut et la grâce, par Sidonie Loubry.
Des mains mutilées et des vies prises — sur les romans de François Bon, par Valéry Hugotte.
ELLIPSES DU SUJET
Le Sujet s’évite — Jean-Benoît Puech, par Jan Baetens.
Texte qui de soi-même s’écrit — les «collaborations» de Benoît Peeters, par Adélaïde Russo.
Une Stratégie des contraintes, par Jean Lahougue.
Histoire littéraire et postmodernité, par Sémir Badir.
Écritures contemporaines 2 : “États du roman contemporain”. (Colloque Calaceite 1996). Jan Baetens et Dominique Viart eds. 1999. 268 p. 21,90 € ISBN 978-2-256-90986-3
RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.
écritures contemporaines 1
Mémoires du récit
|
présentation de la Série « Écritures contemporaines » par Dominique VIART
1. Mémoires du récit : questions à la modernité, par Dominique VIART 2. Mélancolie du roman : la fiction dans l’œuvre de Pascal Guignard, par Dominique RABATÉ 3. Alain Badaud : la remontée du sens, par Gianfranco RUBINO 4. Détours : Gérard Macé : lecture, rêve, mémoire, par Françoise ASSO 5. Pierre Michon, le monde en héritage, par Adeline WRONA 6. Péchés d’écriture – Claude Louis-Combet : Blesse, ronce noire, par Jean-Christophe MILLOIS 7. Le « Je me souviens » de Jean Rouaud, par Francine DUGAST 8. Écritures du tombeau – François Bon, C’était toute une vie, par Valéry HUGOTTE 9. La littérature et le reste : Gilbert Lascaut, Olivier Rolin, Jacques Roubaud, Antoine Volodine, par Frédéric BRIOT 10. Marie Redonnet et l’écriture de la mémoire, par Marie DARRIEUSECQ Écritures contemporaines 1 : “Mémoires du récit”. Dominique Viart ed. . 1998. iv + 198 p. 25 € ISBN 978-2-256-90972-6 RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici. |
série fondée par Dominique VIART (1998-2010)
dirigée par Laurent DEMANZE (2011-) dans La Revue des lettres modernes
dirigée par Laurent DEMANZE (2011-) dans La Revue des lettres modernes