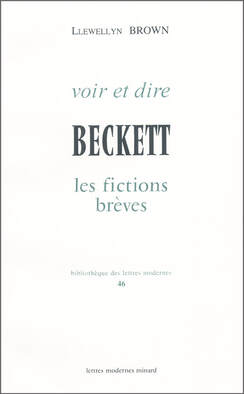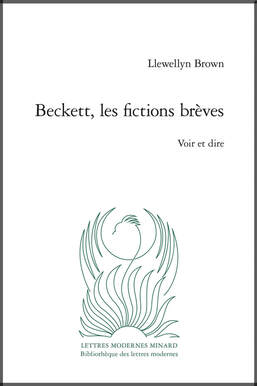Llewellyn BROWN : Beckett, les fictions brèves : Voir et dire.
(coll. « Bibliothèque des lettres modernes », n° 46), 2008.– 235 p. ISBN 978-2-256-91139-2.
|
Couverture d'origine
|
Réimpression 2021 ; commander ici.
|
Dans les fictions brèves de Samuel Beckett, lumière et obscurité alternent et déterminent l’expérience des personnages. Tandis que ces derniers se trouvent souvent condamnés à l’obscurité, ce qu’ils parviennent à voir prend la forme d’une image lisse et stéréotypée, voire inhumaine et mortifiée.
Ce partage peut se comprendre comme une conséquence du trait qui structure ces textes sur le plan de l’écriture : une dissociation entre les dimensions de voir et dire qui se décline suivant les deux propositions suivantes :
– d’un énoncé achevé, dont la ponctuation finale vient confirmer le sens, on affirme voir ce qu’il
veut dire ;
– d’une phrase qui ne parvient pas à l’achèvement, qui est pur dire, on déclare qu’elle est obscure :
on ne voit pas ce qu’elle signifie.
Une démarche orientée par le principe de vraisemblance nouerait ces propositions antithétiques ensemble au moyen d’une dialectique. Mais l’écriture fictionnelle de Beckett suit le chemin inverse, en consacrant leur divorce.
Toutefois, l’impossibilité de réconcilier ces deux registres témoigne de la fonction qu’ils conservent : celle de pallier la présence agissante d’un Vide innommable. L’œuvre de création, chez Beckett, est chargée de donner forme à cette dimension d’impossible, à la rendre enfin visible comme ce que l’auteur nomme l’« objet pur ».
ENGLISH
In Samuel Beckett’s short fictions, light and darkness alternate and determine the characters’ experience. While the latter are often condemned to darkness, the visions they see take the form of smooth and stereotyped images, or sometimes inhuman and mortified ones.
This divide can be understood as a consequence of the trait that structures the writing of these texts: a dissociation between the dimensions of seeing and saying, which can be analysed in terms of the two following antithetical propositions:
– an utterance whose meaning is confirmed by its final punctuation, allows us to see what it means;
– a sentence that fails to conclude, that is pure saying, is considered obscure: we do not see what it signifies.
An approach oriented by the principle of verisimilitude would bind these propositions together by means of a dialectical movement. However Beckett’s fictional writing follows the opposite path, consecrating their divorce.
The impossibility of reconciling these two registers nonetheless bears witness to the function they continue to accomplish: that of veiling the active presence of an unnameable Void. Beckett’s work of creation gives form to this dimension of the impossible, making it visible in the guise of what the author calls the “pure object”.
SOMMAIRE
INTRODUCTION : ÉNIGME ET RÉCIT
I. STRUCTURE DE L’ÉCRITURE
1. Un lieu non localisé.– 2. La scission.– 3. Image et énonciation
II. ÉNONCIATION
1. L’énonciateur en défaut d’identité.– 2. La voix.– 3. L’impératif de dire et l’impossible.– 4. Monologue.– 5. Équivoque et métonymie.–
a. De l’Un sans Autre à l’hypothèse– b. Atteindre l’envers– c. Progression dans l’infime.– 6. Recherche de la fin
III. IMAGE
1. Un univers fondé et vraisemblable.– 2. Objectivité.– 3. L’image et la chute.– 4. De la pureté grammaticale et géométrique à son échec.–
5. Matérialité de l’écriture.– 6. La tête et le corps.– 7. L’image fantomatique : entre image et énonciation
IV. L’OBJET PUR
1. Retournement de l’image pure.– 2. Visible et invisible : Mal vu mal dit.– 3. L’objet pur.– 4. Un dispositif de suppléance : « Horn venait ».–
5. L’image intérieure comme visibilité pure : « Se voir ».– 6. Inscrire la subjectivité : « La Falaise ».– 7. Regard et énonciation : Le Dépeupleur
CONCLUSION
Ce partage peut se comprendre comme une conséquence du trait qui structure ces textes sur le plan de l’écriture : une dissociation entre les dimensions de voir et dire qui se décline suivant les deux propositions suivantes :
– d’un énoncé achevé, dont la ponctuation finale vient confirmer le sens, on affirme voir ce qu’il
veut dire ;
– d’une phrase qui ne parvient pas à l’achèvement, qui est pur dire, on déclare qu’elle est obscure :
on ne voit pas ce qu’elle signifie.
Une démarche orientée par le principe de vraisemblance nouerait ces propositions antithétiques ensemble au moyen d’une dialectique. Mais l’écriture fictionnelle de Beckett suit le chemin inverse, en consacrant leur divorce.
Toutefois, l’impossibilité de réconcilier ces deux registres témoigne de la fonction qu’ils conservent : celle de pallier la présence agissante d’un Vide innommable. L’œuvre de création, chez Beckett, est chargée de donner forme à cette dimension d’impossible, à la rendre enfin visible comme ce que l’auteur nomme l’« objet pur ».
ENGLISH
In Samuel Beckett’s short fictions, light and darkness alternate and determine the characters’ experience. While the latter are often condemned to darkness, the visions they see take the form of smooth and stereotyped images, or sometimes inhuman and mortified ones.
This divide can be understood as a consequence of the trait that structures the writing of these texts: a dissociation between the dimensions of seeing and saying, which can be analysed in terms of the two following antithetical propositions:
– an utterance whose meaning is confirmed by its final punctuation, allows us to see what it means;
– a sentence that fails to conclude, that is pure saying, is considered obscure: we do not see what it signifies.
An approach oriented by the principle of verisimilitude would bind these propositions together by means of a dialectical movement. However Beckett’s fictional writing follows the opposite path, consecrating their divorce.
The impossibility of reconciling these two registers nonetheless bears witness to the function they continue to accomplish: that of veiling the active presence of an unnameable Void. Beckett’s work of creation gives form to this dimension of the impossible, making it visible in the guise of what the author calls the “pure object”.
SOMMAIRE
INTRODUCTION : ÉNIGME ET RÉCIT
I. STRUCTURE DE L’ÉCRITURE
1. Un lieu non localisé.– 2. La scission.– 3. Image et énonciation
II. ÉNONCIATION
1. L’énonciateur en défaut d’identité.– 2. La voix.– 3. L’impératif de dire et l’impossible.– 4. Monologue.– 5. Équivoque et métonymie.–
a. De l’Un sans Autre à l’hypothèse– b. Atteindre l’envers– c. Progression dans l’infime.– 6. Recherche de la fin
III. IMAGE
1. Un univers fondé et vraisemblable.– 2. Objectivité.– 3. L’image et la chute.– 4. De la pureté grammaticale et géométrique à son échec.–
5. Matérialité de l’écriture.– 6. La tête et le corps.– 7. L’image fantomatique : entre image et énonciation
IV. L’OBJET PUR
1. Retournement de l’image pure.– 2. Visible et invisible : Mal vu mal dit.– 3. L’objet pur.– 4. Un dispositif de suppléance : « Horn venait ».–
5. L’image intérieure comme visibilité pure : « Se voir ».– 6. Inscrire la subjectivité : « La Falaise ».– 7. Regard et énonciation : Le Dépeupleur
CONCLUSION